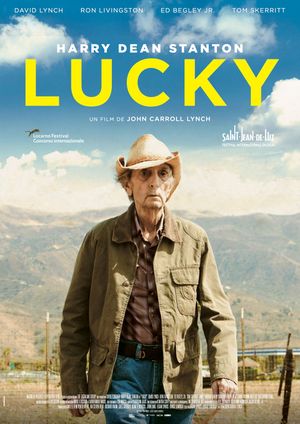Lucky vit des jours tranquilles dans l’Ouest américain. Sa vieillesse, il se refuse à l’assumer, et préfère même la combattre par des exercices de yoga et de fitness. Son allure de cow-boy solitaire et flegmatique ne masque néanmoins pas sa fragilité ; une fragilité qui grandit, de jour en jour, à mesure que la carapace se fissure. Une chute le ramène à sa condition de mortel, et c’est tout un monde d’angoisses feutrées, de craintes inexprimables qui apparaît.
Avec un synopsis pareil, on voit bien comment John Caroll Lynch aurait pu multiplier les effets mélodramatiques. Mais loin de vouloir assombrir son récit par le recours à une esthétique misérabiliste et larmoyante, il préfère évoquer le cheminement d’un homme au bord de la mort avec pudeur, poésie, tendresse et délicatesse. La souffrance intérieure, il la révèle en la voilant, il la touche en l’effleurant, il l’exprime sans la dire. Et c’est peut-être pour cette raison que le film réussit à parler de l’Intime, de ce qui est trop secret pour s’extérioriser, se communiquer, sans risquer d’en atténuer la portée, en diminuer la force.
Pour mettre en scène cette crise existentielle, le réalisateur fait de son personnage un athée qui questionne son rapport à la réalité et sa dimension subjective, la possibilité, ou non, de partager avec autrui des expériences communes, d’être traversé par des questionnements et peurs similaires. Tout le film ne va cesser de naviguer entre les différents personnages pour leur donner la parole, une parole qui à la fois leur est propre, mais qui en même temps entre en résonnance avec le vécu et les sentiments de Lucky. Si l’Intime est à la fois le plus particulier et le plus universel, alors la forme même du film embrasse cette vérité.
Cette crise est aussi une expérience des limites : les limites de la compréhension humaine (la sollicitude, les attentions des autres sont-elles réellement le signe qu’ils comprennent ce qu’il endure et ce qui l’affecte ?) mais surtout de sa propre finitude. Toute la première séquence s’attache à mettre en scène cette idée. On y voit un corps usé par le temps, qui est littéralement morcelé par le montage, avec des gros plans sur chaque partie de son organisme. Lucky s’adonne à des activités physiques pour se maintenir en forme. Ces images troublent notre perception de l’espace, et semblent, sur le plan esthétique, appuyer l’idée d’un être dont l’intégrité, la totalité, l’unité physique, est fatalement menacée par un temps qui éparpille, qui dissémine, qui déconstruit. En l’espace d’une séquence, le réalisateur inscrit dans le cœur même de l’image cette expérience des limites humaines. Surtout, John Caroll Lynch fait le choix de filmer toutes les parties du corps sauf le visage, auquel il substitue une photographie du personnage dans sa jeunesse. Deux temporalités se lient alors dans un même mouvement, mais la juxtaposition de ces deux strates ne peut être qu’artificielles : ce visage en noir et blanc n’est pas ce corps ridé, il ne fait qu’attester de l’impossibilité de recouvrer sa jeunesse perdue.
Cette expérience de la scission à la fois au niveau visuel (le cadre qui « découpe »), temporel (le passé et le présent) et existentiel (la vitalité du corps, l’effort physique comme résistance impossible de l’être au passage du temps, à la dégradation physique) se retrouve par la suite dans la façon dont le réalisateur filme l’espace. Il y a en effet une mise en tension permanente dans le film entre d’un côté une absorption du personnage dans l’espace de la communauté, son intégration sociale, la bienveillance, le caractère cotonneux et protecteur de l’ensemble, et de l’autre ces légers sentiments d’écart, de décalage, qui introduisent des aspérités au sein de cadrages trop lisses et fixes pour ne pas contenir des failles, des fêlures et cassures. John Caroll Lynch suggère l’idée que le personnage n’est pas totalement intégré à ce monde : il peut être légèrement rejeté dans l’arrière-plan du cadre, ou alors ne pas être directement perçu par ses camarades de comptoir. Surtout, le monde qui s’agite autour de lui entre nécessairement, aux yeux du spectateur, en conflit avec ce temps immuable des traditions et des rituels quotidiens que le film présente à travers différentes séquences qui scandent les moments journaliers de la vie du personnage.
En effet, bien que le regard du personnage n’insiste pas dessus, le film montre volontairement une réalité contemporaine en décalage avec l’imaginaire traditionnellement accolé à l’Ouest Américain : les cafés sont tenus par des gérants noirs, les commerces par des latinos. Les homosexuels peuvent s’embrasser sans crainte des représailles. Ces indices d’un temps qui passe et a transformé le monde entre en collusion avec le rêve d’une immortalité qui passerait par une stabilisation, une fixation de l’être dans un éternel présent. Le film dissémine les indices qui mettent le personnage en léger décalage : sa place au comptoir du café est prise, il doit s’asseoir à une table. Le John Wayne de sa jeunesse devient un Juan Wayne. Lucky devient le représentant d’une Amérique profonde qui survit, perdure, mais ne peut totalement se résoudre à sa disparition. Ainsi, la perfection apparente de ce monde qui se résume à une galerie restreinte de personnages attachants à l’exclusion de tout autre visage doit se lire suivant une voie plus négative, ce dont elle ne se fait pas explicitement l’écho, mais qui pourtant contamine l’atmosphère du film par son silence : la peur, la crainte, la fragilité de l’être confronté à sa disparition prochaine. Et cette peur, pour aussi terrible et universelle qu’elle soit, ne peut s’appréhender que par soustraction, par suggestion et allusion, comme ce refus de compléter les mots croisés du dimanche, dernier jour de la semaine, de la Création, de la Vie.
La prise de conscience par Luky de sa mortalité reconfigure son rapport à la réalité. Le film a beau répéter, le deuxième jour, la même séquence d’évènements, les rituels de la veille, tout s’éclaire néanmoins différemment. Le film fait ressentir avec une rare justesse comment des évènements apparemment banals, des conversations anodines, gagnent une densité, une gravité nouvelle, dès lors qu’ils se déploient suivant la trame invisible de la mort, dont la présence cachée mais inoubliable, la menace latente et permanente obligent à tout percevoir selon cette nouvelle perspective.
L’avancée inexorable vers les limites de l’existence, reconfigure le rapport à la réalité et deux scènes se font l’écho de cette transformation spatio-temporelle. Déjà, celle quand il chute et prend conscience de sa vulnérabilité. La mise en scène subjectivise cette impression de malaise, et contraste avec le calme, la douceur de l’enchainement des images auquel le film nous avait jusqu’alors habitués. Ensuite, quand le personnage est attiré par ces lumières rouges à la sortie du bar, cette musique qui l’hypnotise, le guide comme par enchantement. La composition chromatique tranche avec le reste du métrage, et fait plonger le personnage - et le spectateur - dans une veine plus fantastique. La scène qui suit, celle du réveil, situe rétrospectivement les images de la veille entre le songe/cauchemar et la réalité : c’est l’expérience d’un évènement surnaturel (donc en dehors des limites humaines : la mort), qui dérègle l’agencement habituel des actions du personnage. Rien ne peut plus se répéter à l’identique, tout s’éclaire littéralement sous une lumière nouvelle à mesure que la distance avec la Mort se rétrécit.
Aussi, en marchant vers Elle, le personnage se dévoile petit à petit. Certaines passions insoupçonnées, son métier passé, sont révélés, et c’est toute une vie chargée d’un vécu inépuisable et surprenant qui émerge. Les choses commencent à se dire, la communication avec le spectateur peut s’établir. A mesure que le personnage accepte la fatalité de la vie, il s’« ouvre », ce qui est métaphoriquement le signe d’un être de moins en moins soumis aux limites que fait peser la Mort sur son existence. La fin du film, avec cette déambulation en dehors de l’enclos protecteur de la communauté, montre un homme qui accepte sereinement la route qui le conduira jusqu’à la fin de sa vie. Lucky fait face à sa destinée, et il partira en ayant compris, à la vue de ce cactus gigantesque qui s’élève fièrement, que l’on peut « transcender » la Mort, être plus fort qu’elle.
En filmant un combat physique, existentiel et spirituel contre la Mort, John Caroll Lynch signe un premier film émouvant, poétique et léger, qui ne perd néanmoins jamais perdre de vue la gravité de son sujet. Une indéniable réussite !