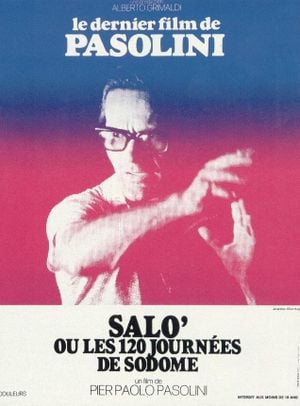On a beaucoup dit de Salo qu'il était une mise à mort de l'artiste : un film sans espoir, sans salut, « théorème mort » pour reprendre les mots de Deleuze, déroulant dans un geste direct et étouffant le triomphe du fascisme et la mise à mort de toute humanité. C'est le film ultime, définitif. Pasolini en est peut-être mort : c'était le terminus d'une vie, d'homme et d'artiste. Dans cette perspective, on peut comparer Salo avec son autre chef-d'œuvre, Théorème, film ouvert sur la foi, récit d'une bourgeoisie ravagée par le plaisir charnel et dévastée par le mysticisme. En un sens, on pourrait penser que Pasolini a fait Salo pour contredire Théorème, dans lequel il restait encore une ouverture, une respiration vers le dehors, et pourrait-on dire, une vitalité de l'Art pour réinventer le monde, et qui débouchait sur cette éblouissante image finale : le corps du bourgeois dénudé, hurlant dans le désert des passions humaines.
C'est cela qui différencie les deux films, cette contingence de l'action qui échoue dans Salo, film très programmatique, entre quatre murs ; plutôt que l'approche de la révolte. Les deux films n'ont pas le même point de vue : dans Théorème, et c'est peut-être sa limite, on est du côté des bourgeois. Dans Salo, le point de vue est plus général et donc plus ambigu. Les films sont tous les deux troublants, et dans chacun d'eux, on nous montre un visage de l'aliénation, mais aussi la figure d'un possible qui se débat.
C'est ce qui fait la grandeur morale de Salo. Chaque plan, et ils sont peu, que Pasolini fait sur le visage d'une des victimes est une sidération, et nous aide à tenir le visionnage : c'est dans les yeux de ceux qui souffrent que l'on voit à nouveau l'humanité s'élever. Car il n'y a pas de prise de conscience, pas de contestation interne apparente. Rien de ce que le peuple fait ne peut atteindre les quatre puissances qui court-circuitent tout. Mais par conséquent, chaque geste est une information supplémentaire, chaque infime indice d’insoumission en voit sa puissance subversive décuplée. Dans Salo, le spectateur, indigné, scandalisé, ballotté entre les points de vue, cherche un mouvement de révolte qu'il n'est pas sûr de trouver, d'un côté parce que Pasolini annihile tout espoir, de l'autre parce que le spectateur fait peut-être lui-même partie des bourreaux. Ce que le cinéaste cherche à nous montrer, c'est aussi ce qui échappe à la tyrannie du présent. Les insoumis seront tués, alors pourquoi faire un film ? Sans doute pour que leur image reste. C'est pour moi le sens profond du geste de Pasolini, qui n'a jamais cessé de scruter ce qui résiste au fascisme en devenir de notre monde. Cela ne tient peut-être qu'à une seule scène, et c'est le génie des grands films que de faire naître un tel éclat d'un moment si réduit, qui irradie et relance tout. Il y a, avant le début de la troisième partie, le Cercle du sang, un autre cercle d'humiliation de l'humanité que dévoile le film : celui de la dénonciation. Les victimes désobéissantes se dénoncent chacune leur tour pour échapper à la punition, jusqu'à ce qu'un homme ne le brise, en levant le poing et narguant du regard le visage de la monstruosité. Son corps s'écroule dans la seconde d'après, criblé de balles. Si le corps tombe, le poing reste levé.
La première règle du code de Salo, c'était celui du jeu, du divertissement de la mort, de la représentation presque esthétique de la souffrance - avec lequel le film joue de manière rigoureuse et polémique, sous les abords d'une fable qui renvoie le programme fasciste à la fois à sa nudité, son ridicule, mais aussi à son insupportable attrait, sa terreur ricanante. Paradoxalement, dans Salo, le fascisme ne se cache pas, il se met en scène. Il se conforte dans sa démence et dans sa vanité alors même qu'il ne cherche plus à cacher ce vers quoi il tend. Mais la mise à mort du garçon au poing levé met à mal ce principe. Point de mise en scène ici : la mort survient comme une délivrance, sans humiliation préalable, dans un élan impulsif du fasciste face à la subversivité du geste. Et pour la première fois, c'est la victime qui se choisit l'insolente liberté de comment tomber. Il est frappant de regarder ce qui naît sur le visage des fascistes face à ce poing qui se lève, le même mouvement de panique et de colère que lorsque, plus haut dans le film, une jeune fille avait imploré Dieu, ou que deux bouleversantes amantes, en pleine étreinte, se murmuraient : "mon amour..."
Dans ce film qui s'en tient à l’implacable examen du présent qu'il invente, Pasolini ne manque pas de cartographier le danger qui menace et qui pourra un jour tuer la tyrannie du fascisme : le corps, tout simplement, qui endure, qui résiste, qui peut se transcender (c'est le travail de la foi), trembler de passion charnelle (c'est le travail de l'amour) et s'élever (c'est ce poing qui incarne toutes les luttes contre l'obéissance destructrice). Il n'est pas vraiment question d'espoir, car en 1975, Pasolini ne croyait plus en rien. Il ne croyait plus aux jeunes, il ne croyait plus au sexe. Il était revenu de tout. Il est plutôt question de menace. Et cette menace lancée au visage de la bourgeoisie fasciste, elle existe, Pasolini la montre. Le film est sans espoir, car jamais cette menace ne débouchera sur une révolte conséquente. Le seul véritable espoir qui subsiste est que ce film existe, pour ce qu'il montre et comment il le montre. C'est dans ce court instant que l'art, pied à terre, survit encore pour quelques secondes, multipliant sa puissance et sa portée. Un jour, le capitalisme fasciste aura non seulement détruit les hommes, il aura détruit l'Art, témoin de ces hommes. Alors Pasolini brise une dernière fois le jeu, renouant avec sa force pure, originelle : lever le poing, très vite, avant qu'on nous liquide. Comme sur une certaine plage d'Ostie, il y a 50 ans. Et comme demain, sans doute - car à le revoir, aujourd'hui, je crois que c'est pour demain que ce film a été fait.