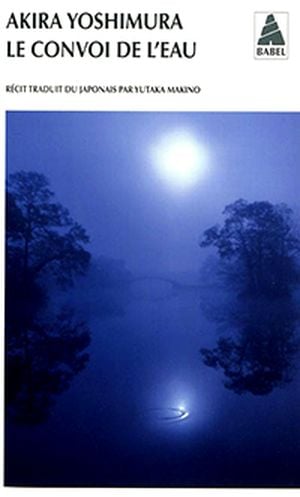Bon, je vais essayer de m’y remettre… Parce que ça me manque un peu, honnêtement. Maintenant, si même je suis seulement capable de rebloguer dans la durée, je ne vais probablement pas me montrer aussi exhaustif que par le passé – je pense de manière générale faire l’impasse sur les BD, notamment. Peut-être réorienter purement vers les littératures de l’imaginaire, aussi ? On verra…
Mais, pour aujourd’hui, retour sur un court roman japonais ne relevant pas de l’imaginaire, pour le coup – même si Yoshimura Akira, que j’ai souvent eu tendance à associer à Ogawa Yôko, probablement pour la bête raison que c’est le même éditeur, Actes Sud, qui les publie en France, prise à l’instar de la seconde les récits (souvent courts) un peu décalés, pas fantastiques ou SF à proprement parler mais du moins… étranges, si la morbidité est probablement l’aspect qui ressort le plus de prime abord. Cela s’était vérifié dès ma première lecture de l’auteur, La Jeune Fille suppliciée sur une étagère, ou dans celui de ses textes qui m’a le plus bouleversé, Voyage vers les étoiles, ou encore, dans un registre un peu différent, dans Mourir pour la patrie.
La morbidité, la froideur clinique aussi, ne sont certes pas absentes du Convoi de l’eau, court roman datant de 1967, et à vue de nez un des plus plébiscités de Yoshimura Akira – en France, du moins. Mais chroniquer ce bref texte n’a rien d’évident : s’il n’a absolument rien d’un thriller, il est tout de même bâti sur une succession de « révélations » qu’il serait regrettable de SPOILER – mais, pour en dire quelque chose, il va me falloir lâcher deux, trois trucs tout de même : vous êtes prévenus. L’autre difficulté, c’est que le sens à donner au roman ne coule peut-être pas autant de source que son symbolisme pourtant initialement très marqué pourrait laisser supposer… Mais mieux vaut ne pas trop en dire à cet égard de toute façon.
Nous sommes dans un coin reculé du Japon – en pleine montagne. À vrai dire un endroit si reculé que se tapit au fond de la vallée un petit village longtemps oublié de tous : il a fallu le crash d’un bombardier pour que l’on se souvienne, ou découvre, que des gens vivaient là-bas. Mais ce microcosme isolé, qui a pu me rappeler Narayama (ou éventuellement mais dans une moindre mesure La Femme des sables, d’Abe Kôbô, roman lu durant l’interruption de ce blog), est en sursis – le reste du pays, certes interloqué par cette découverte, n'y accorde bien vite que peu d'importance : le site est idéal pour la construction d’un barrage, les villageois seront expropriés. Déjà une première équipe se rend sur place – la montagne est si dangereuse qu’ils doivent s’encorder pour y parvenir, ensemble, les ouvriers et les ingénieurs, ces derniers guère appréciés des premiers : la symbolique est pour le moins appuyée – mais pas vaine, ceci dit.
Le camp de base, comme pour une expédition d’alpinisme, s’installe sur les pentes, surplombant le village et ses habitants étranges, aux coutumes forcément un peu barbares. Dans un premier temps, tout est fait pour que ces deux mondes ne se rencontrent pas – à vrai dire, le luxe de précautions à cet égard a quelque chose d’un brin navrant, car on sait très bien que, rapidement, il faudra dynamiter ici, là, et encore là : on sait, tout le monde sait, que le village est condamné. Mais les ouvriers l’observent – de haut, littéralement. Ils ne sont dans l’ensemble pas les plus fins ni les plus ouverts des hommes, encore qu’ils ne soient pas tout à fait indifférents à une certaine forme de beauté rustique et sauvage qui caractérise le village, une beauté pas nécessairement et naïvement innocente, à vrai dire plutôt cruelle, mais peut-être surtout parce qu’ils savent très bien être les agents de sa destruction. Et ils s’en accommodent.
Notre narrateur fait partie des ouvriers. Et c’est ici que je dois recourir, au cas où et un peu absurdement, à la balise SPOILERS. Très vite, nous avons l’impression qu’il y a quelque chose d’un peu étrange, ou d’un peu décalé, dans le regard du narrateur. Véhicule de la plume de Yoshimura Akira, il s’exprime avec une froideur clinique, rigoureuse mais pas sans charme – son regard, pourtant, n’est jamais exactement ce à quoi nous pouvions nous attendre. Quelque chose ne va pas.
Nous comprenons bientôt qu’il est tout récemment sorti de prison – et, assez brutalement, d’ailleurs, nous apprenons pourquoi il y est allé : il a assassiné sa femme, adultère, à coups de bûche (?!), sous le regard terrorisé de leurs filles. Après une peine absurdement courte, il a retrouvé la liberté – ses collègues ne savent pas forcément grand-chose de son passé, peut-être même rien, ils s’en moquent. Mais, dès l’instant que nous, lecteurs, le savons, notre regard à son tour est affecté, qui se décale lui aussi.
Son crime obsède le narrateur – mais pas au sens où il éprouverait du remords, ça n’est pas le cas. La prison ne l’a à vrai dire en rien rédimé (elle n’y parvient jamais, ce n’est au fond pas son but), et son obsession a quelque chose de pathologiquement morbide qui ne surprendra a priori guère chez Yoshimura – notre narrateur a profané la sépulture de sa femme pour en extirper des ossements, qu’il garde sur lui comme une relique criminelle, une délicieuse accusation, un jouet sempiternellement désacralisé (là encore, j’ai forcément pensé à Ogawa Yôko et ses collections bizarres). Il se pose cependant des questions sans réponse – une, notamment : pourquoi son premier et dernier réflexe a-t-il été de s’en prendre à son épouse seulement, et non à l’amant de cette dernière ? Qu’il a totalement ignoré. La « trahison » suffit-elle à expliquer le choix de la victime ? Probablement pas…
Or un drame, dans ce village de montagne coupé du monde, va rendre ces questionnements plus obsédants encore (seconde balise SPOILERS). Le plus navrant dans ce drame est d’ailleurs qu’il n’a rien pour nous surprendre… Forcément, un des ouvriers viole une jeune villageoise. Le village se rend en procession pour dénoncer le crime aux cadres et contremaîtres du camp, ce qui jette comme un froid, mais silencieux – tout est silencieux, ici : ouvriers et villageois ne communiquent guère avec des mots, de manière générale, plutôt avec des gestes, des signes, comme une tribu égarée au fond de la forêt et brutalement accostée par des explorateurs « civilisés ». Le coupable n’a guère à redouter que le silence de ses camarades, d’ailleurs – mais la jeune fille, « déshonorée », se suicide : son frêle corps pendu oscille au vent, comme une accusation muette.
Qui, pour le coup, affecte notre narrateur bien plus que les autres ouvriers. La scène macabre lui rappelle son propre crime. Doit-on y voir pour lui l’occasion de la rédemption, enfin ? Peut-être – mais pas sûr. Car, dans son itinéraire intime, le narrateur a des raisons plus ou moins avouées, et plus ou moins convaincantes.
Qui tiennent d’ailleurs à l’incommunicabilité générale des rapports humains dans le roman, l'incompréhension qui règne sans partage entre les deux communautés. Le village est nécessairement « autre », et ce n’est pas un hasard si le camp sur les pentes fait que les ouvriers « le voient de haut », littéralement. À leur manière rude et très matérielle, ils incarnent la « civilisation » qui s’étend et gagne partout, et ne s’embarrasse guère de l’avis des « sauvages ». Il y a une forme d’hypocrisie latente, sans doute – peut-être accentuée par la froideur clinique du récit du narrateur : parfois, l’ouvrier chausse ses lunettes et prend des notes sur son carnet d’anthropologue, avec une fascination distante, un tantinet déshumanisante parfois (souvent) ; l’admiration pour le village se teinte de connotations rappelant au mieux le « bon sauvage ». Ce qui contribue encore un peu plus à fausser les rapports.
Et, en même temps, il y a la nature environnante – sauvage, belle, cruelle, condamnée. Il y a sans doute une dimension écologiste dans le roman, encore que plus subtile qu’il n’y paraît, en dépit d’une symbolique nécessairement appuyée. Le village fait partie de cet écosystème – les villageois s’acharnent à le perpétuer, jusqu’à la dernière minute. Les explosions de dynamite dans la vallée font s’effondrer les mousses amalgamées aux toitures, mais les villageois les réinstallent sans cesse – sachant pourtant sans doute qu’elles tomberont à nouveau lors de la prochaine explosion. Même si la construction du barrage est encore relativement lointaine, l’environnement est drastiquement chamboulé par la seule présence des ouvriers – et la découverte d’une source chaude, d’abord accueillie avec le sourire, soulève bientôt des questions embarrassantes : ceux qui se baignent n’empiètent-ils pas sur les prérogatives des villageois ? Un questionnement un peu absurde à la veille de l’apocalypse – mais on n’y échappera pas.
Les villageois savent pourtant qu’ils devront partir. Les ingénieurs, puis les employés des assurances, le leur ont dit. Les villageois ne se sont d’ailleurs pas montrés gourmands au regard des indemnités d’expropriation – ce qui intrigue tout le monde : ils ne devraient pas réagir comme ça… Le lecteur, peut-être d’autant plus qu’il est perturbé par les obsessions propres au regard biaisé du narrateur, s’attend à quelque drame ultime, qui achèverait le cercle symbolique initié par l’arrivée des ouvriers dans la vallée. C’est que l’expropriation la plus vitale, ici… est celle du cimetière – un cimetière étonnamment grand pour un si petit village. Il constitue sans doute une part essentielle de son identité, pourtant – et les villageois semblent bien plus préoccupés, au fil des pages, par le déménagement des morts que par celui des vivants. Il faudra bien abandonner cette terre au barrage – les villageois demeurent eux-mêmes en se consacrant aux morts (et tant pis pour Barrès).
Bien sûr, tout ceci, ce regard panoramique, s’imbrique avec le regard essentiellement subjectif, et assumé comme tel, du narrateur. Les ossements de l’épouse adultère entrent en résonance avec les crânes extirpés des tombes du village pour les ranger dans des petites boîtes. Le cadavre de la jeune suicidée oscille au vent, comme les réminiscences du crime du narrateur. Il a sa place dans cette ronde symbolique : il lui faudra finalement intervenir – avec peut-être l’arrogance du colon, et en même temps l’empathie, enfin, d’un homme qui a commis le pire des crimes et en pèse enfin, au moins vaguement, les motivations.
Le Convoi de l’eau est un très beau roman. Sans doute n’est-il pas sans failles, et certains rechigneront peut-être à sa symbolique parfois lourdement appuyée… Elle contribue pourtant indéniablement à l’ambiance remarquable du récit, d’une morbidité sourdement et délicieusement dérangeante. Dans une critique pour Le Monde, René de Ceccatty faisait le lien, étonnant de prime abord, avec le roman gothique, et ça me paraît finalement assez pertinent. D’autant qu’il plane sur tout cela une inquiétude assez terrible et en même temps savoureuse – c’est insidieux, là encore, mais cela fait au fond pleinement partie de cette morbidité caractéristique. La plume est belle, par ailleurs – sobre, pour le coup, elle n’en fait jamais trop, mais elle a une fluidité (forcément) très à-propos, telle que la rend le traducteur Yutaka Makino. Elle rend au mieux le récit un peu pervers et pourtant touchant du narrateur – elle n’excusera pas son crime, parce que ce n’est pas le propos, mais elle lui rendra en définitive un semblant au moins d’humanité. Le village n’en disparaîtra pas moins sous les flots.