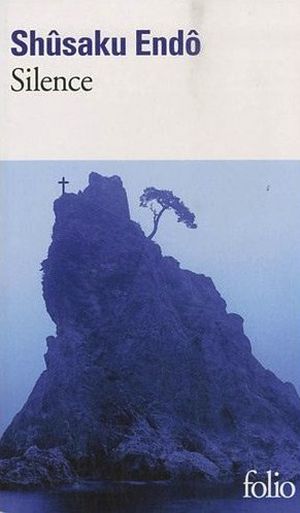Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/02/silence-de-shusaku-endo.html
DU FILM AU LIVRE
La sortie toute récente encore de Silence, dernier film en date de Martin Scorsese, et un projet qui remonte à fort longtemps, aura au moins eu cet avantage, indépendamment de ses qualités propres : rappeler à notre bon souvenir le roman de Shûsaku Endô dont il est l’adaptation (il y en avait déjà eu une, japonaise, pas vue) – en témoigne cette réédition datée de décembre dernier, avec forcément l’affiche du film en guise de couverture.
Cela faisait quelque temps que je comptais lire ce livre, probablement le plus célèbre de son auteur – une occasion toute trouvée, donc… et, dois-je avouer, que le film de Scorsese soit toujours à l’affiche a pu précipiter quelque peu cette lecture. À vrai dire, je me tâte – je ne sais pas si j’ai envie de le voir ou pas, je ne sais pas si je peux m’enquiller ces deux heures quarante ou pas, moi qui ai depuis fort longtemps déserté les salles de cinéma… Mais je me pose au moins la question.
Lire le livre ne m’a en fait pas permis d’apporter une réponse à cette question – mais peut-être avant tout, cette fois, parce qu’il s’agit d’un très bon roman, et dont je redoute d’autant plus l’adaptation, forcément périlleuse ? J’ai beaucoup aimé Scorsese, fut un temps – nettement moins ces dernières années, la plupart de ses projets les plus récents ne m’ayant pas emballé plus que ça… Peut-être à tort, hein. Mais, ici, outre le nom du réalisateur et ses connotations, il me faut sans doute composer avec la réception du film, ou plus exactement avec les points qui semblent avoir été mis en avant dans ces divers retours – je parle bien sûr de retours un minimum sérieux, hein : on peut évacuer d’emblée la tanche cosmique Durendal… même si je dois reconnaître avoir découvert (émerveillé) ledit guignol au travers de la réponse qui lui avait été faite sur Sens Critique, démontrant assurément, au-delà de ses goûts de chiottes éventuellement discutables, qu’il n’avait absolument rien panné à ce dont il parlait avec tant d’assurance.
Reste que le film a d’emblée suscité une image collective, peut-être en forme de préjugé, mais qui m’intrigue d’autant plus… qu’elle est passablement éloignée du contenu du roman. Vraies critiques qui portent authentiquement, à l’encontre d’un Scorsese qui se serait « approprié » le livre (ce qui est dans l’ordre des choses), mais pour le tirer dans une direction tout autre, et à mon sens moins enthousiasmante ? C’est possible…
Je n’exclus pas pour autant que des critiques aient pu se montrer chatouilleux devant le film, pour la seule et mauvaise raison qu’il était « chrétien » (ce qu’est le livre… mais d’une manière bien plus complexe que ce que l’on pourrait croire, et on ne peut plus éloignée de tout prosélytisme catho-nauséabond).
Et c’est le moment de l’aveu dans un soupir, juste histoire que les choses soient claires : je ne suis pas catholique – je me définis comme agnostique, mais sans cacher que je fais plus que pencher fortement vers l’athéisme ; précaution langagière donc, mais le fait est que je ne crois en aucun dieu. Surtout, je ne comprends tout simplement pas les idées de « révélation » et de « culte », la simple idée d’adorer un « créateur » pour cette seule raison, la conviction de la bonté de cet être supérieur dans un monde qui semble chaque jour un peu plus témoigner de ce qu’il ne peut être bon, sans même parler, bien sûr, du fanatisme exclusif amenant nos prétendus parangons de vertu aux comportements les plus atroces et scandaleux sans que cette contradiction fondamentale ne les touche en rien… Tout cela me dépasse totalement…
Qu’importe ? Eh bien, j’aurai sans doute l’occasion d’y revenir, mais, si je ne sais pas ce qu’il en est du film de Scorsese, le roman de Shûsaku Endô ne s’adresse pas spécifiquement aux catholiques ou plus généralement aux chrétiens, et il est parfaitement en mesure de faire vibrer quelqu’un qui, comme moi, n’a jamais pu se faire à l’idée d’adhérer à une foi quelle qu’elle soit – le contexte a bien sûr son importance, mais le livre, en questionnant justement l’universalisme, l’idée même d’une religion universelle de salut, déploie peut-être d’autant plus quelque chose d’universel. Pourquoi ces développements, alors ? Parce que j’ai trop lu de ces réponses bornées, chez les camarades, qui font dans le réflexe pavlovien dès qu’ils lisent ou entendent le mot de « Dieu », et d’autant plus, en France, quand c’est de christianisme ou de catholicisme que l’on parle. Il y a assurément des raisons à cela, raisons que je partage plus qu’à mon tour – mais faire la part des choses me paraît davantage appréciable… Et je suis convaincu qu’au milieu des atrocités qu’elle a sempiternellement suscité, la religion, quelle qu'elle soit, peut – parfois – être belle, et les croyants admirables.
Quoi qu’il en soit, mais donc d’autant plus en se focalisant sur la dimension chrétienne du film, on lui a énormément reproché de se complaire dans la description des persécutions atroces infligées par des Japonais fourbes à des Japonais tellement plus gentils parce que chrétiens et à des prêtres portugais que leur seule teinte de peau placerait d’une certaine manière au-dessus des autres… Concernant ce dernier point, le livre apporte là encore une réponse autrement subtile. Mais le fait à mettre en avant dans ce compte rendu, sans doute, c’est que le roman de Shûsaku Endô ne se complait certainement pas dans l’exploitation limite mondo et outrancièrement racoleuse des supplices sadiques infligés par de zélés tortionnaires nippons… Pas du tout, en fait : ces horreurs sont bel et bien évoquées, et sans fard – elles sont des faits historiques, que l’on ne saurait nier en tant que tels, ou balayer pour la seule raison que leurs victimes auraient été de bêtes croyants, alors finalement bien fait pour leur gueule, etc. Mais, quand Endô traite de tout cela, c’est sans complaisance aucune, et sans qu’il s’y attarde vraiment. On a pu comparer le film de Scorsese à La Passion du Christ de Mel Gibson, comme un nouvel avatar de navrant snuff bigot… Je ne sais pas ce qu’il en est du film, donc – mais je peux vous assurer que le roman, en tout cas, c’est tout sauf ça. Vraiment. L’exact opposé, à tous les points de vue.
Ceci étant, on ne peut sans doute se passer, dans quelque perspective que ce soit, de mentionner Silence comme un film catholique – même en s’inscrivant dans la filmographie récente du réalisateur de La Dernière Tentation du Christ, qui, on s’en souvient, n’avait pas exactement ravi les catho-fafs à sa sortie… Silence n’en a pas moins connu sa première au Vatican. Mais, en fait, La Dernière Tentation du Christ est sans doute une référence à garder en tête – non qu’elle « explique » à proprement parler Silence, mais, à la lecture de ce roman, d’un auteur catholique revendiqué, on comprend fort bien que Martin Scorsese ait eu de longue date l’envie d’en tirer quelque chose à l’écran ; et, en outre, Silence n’a rien d’un roman flattant les chrétiens et leurs convictions : à l’époque de sa sortie, en 1966, il avait semble-t-il passablement déplu aux communautés chrétiennes japonaises, qui en déconseillaient (au mieux) la lecture, et, en fouinant sur le ouèbe, entre critiques et commentaires du livre et du film, je suis tombé sur nombre de chrétiens affichés tout à fait contemporains qui en disaient pis que pendre, y voyant une insulte à leurs convictions… Et, au fond, cela n’a rien d’étonnant, à voir le propos essentiel du roman, qui est donc autrement profond. Il est d’autant plus appréciable d’en lire des recensions chrétiennes plus subtiles, j’imagine – car il y en a, heureusement, et en nombre.
ENDÔ, ROMANCIER CATHOLIQUE
Mais retournons donc aux sources – avec tout d’abord quelques mots concernant l’auteur, Shûsaku Endô. Je dois reconnaître que, Silence mis à part, je n’en connaissais absolument rien – il ne me paraît pas, à cet égard, avoir eu la popularité internationale de certains de ses contemporains, des Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Kenzuburô Ôe… Ou « me paraissait » ? C’est peut-être plutôt en effet une fausse impression de ma part : le fait est qu’Endô a rencontré un certain succès de son vivant, et qu’il a été abondamment traduit, y compris en français – une douzaine de volumes recensés dans la bibliographie en fin d’ouvrage, ce qui n’est certes pas rien ! Bon, après, ces traductions peuvent être problématiques, et j’y reviendrai juste après…
Mais Endô, dans le monde littéraire japonais, avait une particularité : il était catholique. Un héritage de sa mère, très dévote dans cette dimension hétérodoxe, qui l’a fait baptiser en 1935, à l’âge de douze ans, sous le nom de Paul. On se doute que cette singularité pouvait être difficile à assumer dans le Japon militariste des vingt premières années de Shôwa, dont l’idéologie officielle mettait en avant l’empereur de lignée directe et ininterrompue remontant à la déesse solaire Amaterasu… Ceci, bien sûr, sans préjuger des particularités de la vie spirituelle au Japon, portées le cas échéant au syncrétisme et aux assemblages complexes empruntant éventuellement à des fois très diverses, mais perçues comme n’étant pas contradictoires – en fait, Silence se révèle particulièrement instructif dans cette optique, à sa manière ; et, par ailleurs, des chrétiens japonais d’alors pouvaient très bien s’accommoder des exigences du shinto d’État – Tetsuya Takahashi en fournit nombre d’exemples surprenants mais d’autant plus éloquents dans son essai Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni. Il ne faut donc pas exagérer les conséquences de ce statut particulier, dans quelque sens que ce soit. Mais, oui, on peut sans doute y trouver une origine à ce sentiment semble-t-il récurrent dans l’œuvre d’Endô, d’être toujours « en terre étrangère », et ce où qu’il se trouve… Par contre, au cas où, je doute fort que les persécutions subies par les chrétiens dans Silence doivent être mises en rapport avec d’éventuelles brimades dans la biographie de l’auteur – la distance est telle que la comparaison devient d’une certaine manière indécente…
Toutefois, il ne s’agit pas ici d’une simple anecdote biographique : sa condition de chrétien et de catholique était bel et bien un élément déterminant de sa vie, mais tout autant de son œuvre – en fait, tout au long de sa carrière, il semble être systématiquement revenu sur cette question, y apportant éventuellement des réponses qui pouvaient varier avec le temps : Silence en est probablement le plus célèbre exemple, mais bien d’autres textes, romans ou nouvelles, creusaient déjà la question avant et continuèrent à le faire après… Au point de questionner la foi en elle-même, notamment dans ces deux dimensions éventuellement contradictoires, celle de l’universel et celle de l’intime, qui portent en définitive le roman.
Ici, Endô s’inscrit donc peut-être davantage dans une tradition littéraire européenne plutôt que japonaise – même si son œuvre tourne essentiellement autour du Japon et des Japonais, autant dire de « l’âme japonaise », et si, à n’en pas douter, il participait peut-être jusque dans cette singularité de la foisonnante vie littéraire nippone d’après-guerre. Il n’en reste pas moins que, jeune homme, diplôme universitaire en poche, Endô s’est rendu en France pour étudier tout particulièrement la littérature catholique contemporaine, qui le fascinait (l’expérience n’a cependant pas pu être bien longtemps prolongée, du fait de problèmes de santé ayant contraint l’auteur à retourner au Japon, où il devrait resté alité pendant un an…) ; parmi les auteurs français (dont je ne sais peu ou prou rien, inculte de moi…) qui le passionnaient, Mauriac en tête, Bernanos et Claudel également – mais si c’était là ses lectures d’alors, c’est surtout avec un autre écrivain catholique qu’on le comparerait par la suite : Graham Greene – tous deux, bien conscients de cette parenté, s’admiraient réciproquement et louaient volontiers les ouvrages de l’autre, à ce qu’il semblerait.
Dans ces traits originaux se définit une œuvre, avec sa part d’obsession : les mêmes questions primordiales seront sans cesse davantage creusées – pour obtenir des semblants de réponses quant à elles variables… et parfois très déconcertantes ; assurément, Silence, paru en 1966, récompensé par le prix Tanizaki, et le plus grand succès de l’auteur, en est un témoignage marquant – et l’occasion d’explorer des thématiques douloureuses pour l’écrivain chrétien, dont la vie entière, à l’instar de celle de son héros, semble être un combat forcément frustrant contre sa foi… ou contre lui-même. Aussi ce roman chrétien n’est-il pas forcément toujours prisé des chrétiens… En fait, à sa sortie, et en dépit (ou en raison ?) de son succès, les chrétiens japonais se voyaient donc déconseiller de le lire ! Les choses ont changé, sans doute – mais je n’en suis que davantage perplexe quand je lis çà et là que le film de Scorsese serait prosélyte et bêtement bigot… Que ce tableau corresponde bien à une réalité du film, ou à un fantasme pavlovien ; mais c’est bien tout le problème.
SILENCE EN FRANÇAIS
Endô a donc été beaucoup traduit – y compris en français. Mais il faut noter, cependant, ce que je ne peux m’empêcher de trouver regrettable, que nombre de ces livres (sinon tous ?), et en tout cas le présent Silence, ont été traduits en français… à partir de l’anglais.
Pas un cas unique, certes : on dit souvent, à titre d’exemple éloquent, que c’était après tout le cas pour Mishima, qui avait lui-même fait ce choix – par convenance personnelle ; on le dit, et je ne suis pas le dernier à le dire… mais j’avoue avoir du coup, par curiosité, jeté un œil à ma collection d’ouvrages de Mishima (romans, nouvelles, essais, théâtre…), et, en définitive, les traductions du japonais y sont majoritaires ; bon…
Peut-être faut-il prendre ici en compte la longévité des auteurs ? En effet, Silence, roman paru au Japon en 1966, a été traduit en français, depuis l’anglais donc, par Henriette Guex-Rolle, en 1992 – bien plus tard, oui, mais Endô était toujours vivant, il ne mourrait qu’en 1996. Je ne sais pas…
Mais je dois avouer m’être montré d’autant plus méfiant à l’égard de cette traduction – dans les premiers chapitres, sans forcément pouvoir relever quoi que ce soit de bien précis, j’avais un sentiment de lourdeur globale, voire de maladresse… et suspectais plus qu’à mon tour des approximations d’ordre culturel (ainsi sur la nature des samouraïs), à tort ou à raison. Il est d’ailleurs quelques occasions où l’intermédiaire de l’anglais s’affiche un peu absurdement – ainsi quand le prêtre portugais, s’entretenant avec un Japonais, lui parle de la fête d’ « Halloween »… Globalement, toutefois, c’est passé, et mes préventions initiales m’ont ensuite largement abandonné. Par ailleurs, il y a indéniablement de beaux passages dans ce texte français – je vais essayer d’en donner une idée tout à l’heure.
Dans un autre registre, mais c’est peut-être pour l’anecdote, un parti-pris m’a un peu étonné – mais sans doute à tort, une fois de plus, témoignant seulement cette fois de mon incompétence en la matière… Simplement, les noms (religieux ?) des personnages portugais du roman, semble-t-il bel et bien portugais dans la version anglaise du moins, dans la version japonaise aussi je suppose, sont ici francisés : Sebastião Rodrigues, le héros, devient Sébastien Rodrigues ; de même pour son camarade Francisco Garrpe, dès lors François – tandis que leur objectif supposé, Cristóvão Ferreira, devient Christophe. Mais peut-être est-ce l’usage ? Il est vrai, pour citer quelqu’un qui revient comme de juste régulièrement dans ces pages, que nous disons « François Xavier », sans vraiment envisager de préférer à cette dénomination « Francisco Javier » ou même « Frantzisko Xabierkoa » … Je suppose que c’est là la raison de ce procédé dans le roman – mais si quelqu’un pouvait m’éclairer à ce sujet, ce serait avec grand plaisir.
LES CHRÉTIENS AU JAPON
J’en arrive au roman ! Euh, ou presque… Un peu de contexte, tout d’abord : ça s’impose.
Le premier contact, au Japon, avec des Européens, a eu lieu en 1543 – et ce sont tout d’abord des Portugais qui se sont rendus sur place. Le commerce s’est assez vite développé – les marchands occidentaux avaient notamment des fusils dans leurs bagages –, et, bientôt, l’évangélisation a suivi. Saint François Xavier, « l’apôtre des Indes », était très enthousiaste à l’idée d’implanter le christianisme au Japon : il y voyait un terreau particulièrement favorable, peut-être le plus favorable de tout l’Extrême Orient. Un sentiment qui semble s’être tout d’abord vérifié : les missionnaires, notamment les Jésuites, portugais mais aussi très vite espagnols, ont rencontré sur place un certain succès, et les conversions progressaient constamment – y compris, fait crucial, parmi les daïmyos…
À noter que, parmi les puissances européennes, deux autres étaient très impliquées dans la région, protestantes quant à elles : les Anglais et surtout les Hollandais ; mais, globalement, ces protestants avaient moins d’ambition évangélisatrice – incomparablement moins en tout cas que les représentants sur place de la Compagnie de Jésus ; certes, l’opposition des deux camps pouvait avoir des conséquences parfois mesquines sur le sol japonais… où l’on ne comprenait probablement pas très bien ce qui pouvait opposer catholiques et réformés. Mais les Hollandais sont probablement ceux qui s’en sont le mieux tirés : focalisés sur le commerce, ils ont conservé le privilège d’échanger avec le Japon alors que celui-ci se coupait du monde, durant l’ère Edo (le roman s’en fait d’ailleurs l’écho, comme de bien d’autres de ces aspects).
Mais c’est une période bien particulière de l’histoire japonaise – la fin de l’époque féodale, du Moyen Âge au sens le plus strict (voyez ici), le Sengoku où s’affrontent de grands seigneurs ravageant le pays… De ces luttes endémiques, qui, malgré des accalmies shogunales non négligeables, perturbaient régulièrement le cours des événements depuis la fin du XIIe siècle, la bascule étant rapportée avec précisions dans le « cycle épique des Taïra et des Minamoto », c’est peut-être l’apogée – justement parce que de grands seigneurs se succèdent, qui entendent y mettre fin.
On nomme généralement trois chefs de guerre successifs : le premier est Nobunaga Oda – lequel s’implique dans notre affaire, dans la mesure où, ayant maille à partir avec les moines bouddhistes, pas forcément les derniers responsables du chaos ambiant, il tend à favoriser les conversions, ou du moins à se montrer plutôt bienveillant à l’égard des chrétiens. Son successeur, Hideyoshi Toyotomi, n’a pas le même sentiment : lui se montre hostile aux chrétiens, et c’est sous sa domination qu’apparaissent les premières persécutions organisées – des crucifixions, notamment, par une ironie dont les Japonais semblaient friands… Puis le pouvoir passe à Ieyasu Tokugawa, qui emporte enfin la partie notamment lors de la célèbre bataille de Sekigahara, en 1600, et fonde un nouveau shogunat – marquant le point de départ de l’époque Edo, qui durerait jusqu’en 1868.
Or les shoguns Tokugawa, à l’instar de leur prédécesseur, se méfient des chrétiens – et peut-être plus globalement de l’étranger ? Les mesures s’enchaînent durant les premiers règnes : Ieyasu lui-même, d’abord indifférent à la question tant il sait combien le commerce avec les Européens lui est profitable, change de politique à mesure qu’il soupçonne le potentiel subversif de la foi chrétienne implantée au Japon – et c’est ainsi qu’il expulse les missionnaires chrétiens en 1614 ; son successeur, Hidetada, lance une nouvelle vague de persécutions, mais son « règne » est bref ; c’est Iemitsu, le troisième shogun, qui est essentiel relativement à cette dimension de l’histoire japonaise. Il prend en main le Bakufu en 1622, et, dès 1624, ordonne l’expulsion de tous les Espagnols. Suit en 1637-1638 la rébellion de Shimabara, non loin de Nagasaki (le principal port, et bientôt le seul, où les Européens débarquaient et commerçaient), sur l’île de Kyushu – la région, de tout le Japon, où le christianisme s’était le plus implanté ; les causes de la rébellion sont complexes, et l’argent et le pouvoir local y ont au moins autant leur part que la foi, mais le résultat demeure : après avoir subi de surprenants et inquiétants revers, les troupes shogunales triomphent, et se livrent à un atroce carnage dans les rangs des vaincus – la répression est impitoyable. C’est un événement déterminant dans l’histoire du Japon : en découle presque aussitôt l’expulsion des Portugais, à l’instar des Espagnols avant eux, et, en 1640, c’est tout bonnement la fermeture du Japon qui est décidée…
Laquelle n’est en fait pas totale : comme avancé un peu plus haut, les Hollandais conservent un accès, limité, mais non moins important, dans le port de Nagasaki – il faut dire que ces commerçants habiles avaient usé de leurs canons contre les rebelles de Shimabara, à la demande du Bakufu…
C’est à cette époque que débute le roman.
POURQUOI CES PERSÉCUTIONS ?
Reste cependant un point à envisager au moins brièvement : pourquoi ces persécutions ? La question est complexe, et je ne maîtrise pas assez bien le sujet pour m’avancer vraiment dans une réponse bien établie…
Il apparaît assez clairement que le mobile n’est pas religieux à proprement parler : aussi horribles soient-elles, les persécutions ne sont pas vraiment le fait de zélotes fanatiques – là encore, le Japon a une position bien particulière, en tant que telle on ne peut plus éloignée de ce que nous avons connu en Europe ainsi qu’au Moyen-Orient, où s’affrontaient des religions universelles de salut nécessairement exclusives…
Ce sont sans doute davantage des raisons politiques qui ont joué. Ieyasu Tokugawa, d’abord pas spécialement hostile aux chrétiens, aurait viré de bord en prenant conscience de certaines particularités de la foi chrétienne – en fait une forme de « double allégeance » qui, avec ses ambiguïtés, avait bel et bien eu des conséquences tragiques en Europe au fil des siècles : les chrétiens risquaient d’être loyaux d’abord à l’Église, ensuite seulement au shogun… Et c’était une éventualité bien trop dangereuse pour qu’on la laisse se développer – surtout, bien sûr, quand c’était les pouvoirs locaux qui se convertissaient ! Des daïmyos éventuellement hostiles au Bakufu – dans l’île de Kyushu, on comptait nombre de ces fiefs « extérieurs », qui avaient combattu dans le « mauvais » camp à Sekigahara, ou ne s’étaient du moins ralliés que bien tardivement aux Tokugawa… En fait, c’est sans doute une dimension essentielle de la rébellion de Shimabara.
Mais cela allait peut-être plus loin ? Parler de « colonisation » à l’époque est peut-être un peu ambigu, encore que les exactions des conquistadores en Amérique aient déjà assurément démontré combien la conquête européenne et chrétienne pouvait s’avérer redoutable autant que sanguinaire… Mais l’idée était sans doute là : avec les marchands venaient les prêtres, mais avec les prêtres viendraient les armées – la conversion suscitant en outre une forme de « cinquième colonne », pour emprunter un autre terme résolument anachronique cette fois, qui aurait facilité la tâche d’éventuels envahisseurs ? Le Japon, pays jamais conquis – le « vent divin » contre les Mongols… – ne pouvait se permettre de courir un tel risque. Or je me souviens – mais où l’avais-je lu ? Dans un de mes bouquins d’histoire du Japon, sans doute, mais lequel ? – de cette anecdote où des Espagnols, je crois, se montraient d’une certaine candeur en l’espèce, montrant fièrement à des samouraïs interloqués une carte du monde, où les possessions espagnoles s’étendaient toujours davantage, dans la foulée du christianisme… De quoi inquiéter le pouvoir japonais – à bon droit.
LES PRÊTRES PORTUGAIS ET L’APOSTASIE
Quoi qu’il en soit, quand le roman débute – par un « avant-propos de l’auteur » qui n’a en fait rien d’un avant-propos, on est déjà dans le récit –, le Japon semble perdu pour les chrétiens. Les prêtres européens se sont vu formellement interdire l’accès au territoire, et ceux qui sont restés malgré tout, contraints à la clandestinité, envoient épisodiquement et au péril de leur vie des rapports terrifiants sur les persécutions subies par les chrétiens du Japon…
En fait, en ouvrant ainsi le roman, Shûsaku Endô livre d’emblée un épisode atroce de la répression anti-chrétienne, d’un sadisme ahurissant – mais avec donc une certaine distance, qui, à sa façon, permet ensuite au roman de se développer, biaisé sans doute par cette première approche, mais en tirant aussi profit, dans le sens où les tableaux ultérieurs, directement vécus par le héros du roman, ne seront jamais aussi détaillés dans ce qu’ils pourraient avoir de scabreux et sordide.
La Compagnie de Jésus n’est pas folle : la situation étant ce qu’elle est, et mission évangélisatrice ou pas, elle ne compte pas risquer ses précieux prêtres dans une aventure d’emblée condamnée à l’échec – c’est sans doute regrettable pour les chrétiens japonais délaissés, car il y en a bel et bien, mais que voulez-vous…
Trois jeunes prêtres portugais, ardents comme de juste, ne sont pas de cet avis – on en retiendra surtout l’un d’entre eux, Sébastien Rodrigues, qui est le héros du roman (il s’inspire semble-t-il d’un personnage historique du nom de Giuseppe Chiara, un jésuite italien quant à lui). Ces trois jeunes hommes ont un point commun : ils ont eu pour professeur un très fameux théologien et missionnaire, du nom de Christophe Ferreira – un homme intelligent, charismatique et bon, dont l’enseignement les a profondément marqués. Or Ferreira avait par la suite été envoyé au Japon, en pleines persécutions ; contraint à se cacher, il était néanmoins resté sur place, et avait régulièrement écrit aux jésuites (à leurs bases d’opération de Goa et Macao) pour leur décrire les souffrances des fidèles nippons…
Puis plus rien.
Peut-être le bon père était-il mort ? Un martyr de plus aux mains des cruels Japonais ? Il y a cependant une éventualité bien plus embarrassante : la rumeur court en effet qu’il serait toujours vivant… mais parce qu’il aurait apostasié. Le jésuite aurait renié le Christ – pas seulement en marchant sur son effigie, « test » dit de l’efumi classiquement employé pour démasquer les chrétiens (mais le roman montrera avec habileté toute la fourberie de cette méthode !) ; non, bien plus : il aurait abandonné son titre de prêtre, il aurait épousé une Japonaise, il vivrait libre au Japon, proche des autorités, et rédigerait même des pamphlets condamnant le christianisme comme une religion fausse et démontrant que sa tentative de l’implanter au Japon était absurde, pernicieuse et subversive !
Cela, nos jeunes prêtres ne peuvent le croire – calomnie ! Le père Ferreira n’aurait jamais renié sa foi ! Il n’est sans doute pas anodin, dans le propos du roman, que ce soit la suspicion d’apostasie chez un prêtre portugais qui justifie l’odyssée de notre héros – plutôt que les souffrances des fidèles autochtones… En fait, la question de l’apostasie est centrale dans le roman – bien avant les persécutions, qui tiennent plus du cadre, voire du prétexte, qu’autre chose. L’apostasie hantera sans cesse le héros – jusqu’à ce que cette rumination lui impose de choisir enfin.
Mais nous n’en sommes pas encore là : les trois bouillants missionnaires obtiennent bel et bien l’autorisation de tenter l’entreprise risquée d’entrer clandestinement au Japon, afin d’enquêter sur cette bien triste affaire. Ils quittent Lisbonne, pour un bien long voyage – ce n’est qu’après plusieurs mois, peut-être même des années, que deux d’entre eux, Sébastien Rodrigues et François Garrpe, foulent enfin le sol du mystérieux Japon… d’autant plus mystérieux qu’au fond ils n’en savent pas grand-chose, s’ils en ont semble-t-il appris la langue.
LES FIDÈLES JAPONAIS… ET LEUR CHRISTIANISME ?
Avec l’aide d’un répugnant personnage du nom de Kichijirô – répugnant car, au-delà du soupçon fondé qu’il pourrait bien être un apostat, ce personnage « faible » et se drapant dans cette faiblesse pour justifier sempiternellement sa mesquinerie suscite le plus profond dégoût chez Rodrigues, et sans doute aussi chez le lecteur ainsi pris à parti quelles que soient par ailleurs ses convictions –, les deux prêtres accostent à Kyushu, pas si loin de Nagasaki, la région du Japon où le christianisme était le plus implanté. Que l’odieux Kichijirô soit là leur importe bien plus qu’ils n’osent se l’avouer : le fait est qu’ils sont venus sans guère de préparation, pas bien certains de comment trouver des chrétiens dans la région sans révéler leur présence à leurs nombreux ennemis…
Mais ils rencontrent bien de ces « chrétiens cachés », ainsi qu’on les appelle (kakure kirishitan). Des paysans d’une pauvreté affligeante, survivant tant bien que mal dans une région si rude… Pour les fringants jésuites portugais, c’est assez déconcertant ; sans doute ne s’attendaient-ils pas à un tableau réjouissant, mais ça…
En même temps, ces pauvres gens n’en sont que plus admirables d’avoir conservé leur foi contre vents et marées ! Et les pauvres ne sont-ils pas le vrai peuple du Seigneur ? Oui, par certains côtés, les jésuites n’en admirent que davantage ces gens simples et bons – qui font preuve d’un courage auprès duquel le leur pâlit dans une certaine mesure… Un personnage tout particulièrement suscite ce profond respect (peut-être pas exempt d’une forme de condescendance ?) : Mokichi – comme une antithèse à Kichijirô…
Mais la question doit bientôt se poser, à laquelle les prêtres n’étaient pas forcément préparés – alors même que leurs prédécesseurs au Japon avaient signalé le fait (saint François Xavier lui-même, sauf erreur) : ces paysans sont-ils vraiment des chrétiens ? Chez eux, le culte s’est adapté – d’autant plus depuis que ces brebis ont perdu leurs nécessaires bergers européens… Dans toutes autres circonstances, on aurait pu les qualifier d’hérétiques – car leur foi « simple » se mêle de superstition, leur rapport aux représentations du Christ et de la Vierge Marie vire à l’idolâtrie (tout particulièrement, en fait, concernant Marie : chez ces chrétiens, elle est parfois plus importante que le Christ), et la spiritualité locale infuse dans le pur christianisme des prêtres – Jésus, Marie, prennent au fil du temps de plus en plus l’allure de bouddhas ou de kamis (par exemple, Marie et Kannon sont associées)… Des traits qui se perpétueront dans les quelques rares communautés qui parviendront à survivre, cachées donc, tout au long de l’ère Edo, jusqu’à ce que la Restauration de Meiji autorise à nouveau le christianisme au Japon : on constatera alors tout ce qui séparait ces « anciens » chrétiens », après plus de deux siècles de culte clandestin et autochtone, et les « nouveaux chrétiens » convertis à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle !
Mais les prêtres jésuites n’en sont certes pas là – et c’est globalement l’admiration qui domine. Se pose ici la question du point de vue : le roman varie étrangement à cet égard, mais avec pertinence – l’ « avant-propos » qui n’en est pas un a déjà été évoqué, et le roman se conclut sur des sortes d’ « annexes » qui n’en sont pas davantage ; mais l’essentiel du roman se scinde en deux parties autrement volumineuses : dans la première, nous lisons de longues lettres de Sébastien Rodrigues à destination des supérieurs de son ordre – sans vraie garantie qu’elles leur soient jamais parvenues : elles tiennent à vrai dire plus du journal intime que de la correspondance… Dans la deuxième partie du roman, après l’événement que vous supposez, la narration passe à la troisième personne.
Mais, dans les deux cas, le point de vue reste celui du jeune prêtre… et c’est comme de juste un point de vue biaisé : c’est pourquoi, dans le roman, les chrétiens japonais sont tous admirables (Kichijirô étant l’exception – mais quelle exception ! En même temps, dans son rôle tout trouvé de Judas, il n’est pas sans une certaine grandeur paradoxale…), tandis que leurs persécuteurs, conformément à leur fonction, sont détestables – y compris, ou peut-être d’autant plus, quand ils empruntent une façade bonhomme : on peut sans doute balayer avec mépris la méchanceté crasse de celui qui ne sera jamais désigné autrement que par son office, « l’interprète » ; mais le cas du « commissaire » Inoue est tout différent – le vieil homme, apostat dit-on, qui supervise les persécutions dans la région, et contre lequel on avait tout particulièrement mis Rodrigues en garde à la veille de son départ pour le Japon : un démon ! Mais un démon intelligent, habile, qui donne d’abord l’impression d’être ouvert, et même sympathique… Un démon dont la fonction essentielle sera d’obtenir l’apostasie des prêtres étrangers. Mais il s’agit donc d’un point de vue – et parfaitement légitime dans l’optique narrative du roman ; je sais que l’ahuri Durendal a dit bien des bêtises à ce propos, gonflées de sa part qui plus est (le gag chinois de sa chronique de Lucy, mon Dieu, si j'ose dire...), mais ne sais donc pas ce qu’il en est dans le film de Scorsese – ça ne doit pas être facile à mettre en scène, tant c’est bien plus subtil (et risqué) qu’il n’y paraît, donc…
…
Plaçons ici, au cas où, la balise SPOILERS, même si je ne suis pas certain qu’elle ait sa raison d’être ; une précaution, quand même…
DIFFÉRENTS CHRÉTIENS, DIFFÉRENTS TOURMENTS
Et reprenons. Le temps n’est pas à l’admiration hébétée : le Japon est pour les chrétiens, portugais ou japonais, un cauchemar, un enfer. Le Bakufu, dans son entreprise de répression du christianisme, déploie les moyens et les méthodes d’une police secrète dans quelque État totalitaire du XXe siècle. Les contrôles sont systématiques et permanents – ils peuvent frapper d’un jour à l’autre, et ne manqueront pas de le faire. Que les paysans y échappent – parfois… – tient déjà du miracle. Alors les prêtres portugais ? Impensable : ils seront pris, tôt ou tard...
Et ils ne seront pas les seuls à en payer le prix – or ils s’en rendent compte, et c’est tout le propos. La fleur au fusil, si j’ose dire, nos jésuites ont débarqué dans un Japon sauvage et hostile où ils pensaient constituer des modèles d’un grand secours pour les chrétiens qui restaient sur place, d’une part, et d’autre part, où ils étaient certains de trouver à dénoncer comme telle la calomnie portant sur l’apostasie du père Ferreira. Ils doivent cependant finir par admettre que cela ne sera pas le cas : pour les paysans, et ce quand bien même ces derniers ne diraient jamais une chose pareille, et sans doute ne le penseraient même pas, ils sont une menace – et, très vite, ce n’est pas la question de l’apostasie du père Ferreira qui se posera, mais celle de leur propre apostasie, pointant à l’horizon…
Mokichi, l’admirable Mokichi, et d’autres avec lui, meurent pour eux dans les terribles supplices que leur infligent les hommes du « commissaire » Inoue. Et Kichijirô, son antithèse, joue nécessairement son rôle de Judas auprès d’un Rodrigues de plus en plus porté il est vrai à se voir lui-même comme le Christ…
Mais à une différence près : Rodrigues souffre sans doute dans son âme, mais ce sont les paysans qui souffrent dans leur chair. Les tourments infligés par Inoue et ses sbires sont en effet de deux ordres : les tortures physiques d’un raffinement sadique insoupçonnable, et les massacres, c’est bon pour les paysans japonais – mais ils n’ont aucune intention de tuer les prêtres, même après les avoir fait souffrir : ce qu’ils veulent, c’est leur apostasie. Ils ne se satisferont de rien d’autre.
Et l’apostasie, c’est bien plus que le rite de l’efumi consistant à fouler l’image du Christ ou de la vierge ! Un piège pour paysans… Leurs bourreaux savent très bien que ce simple geste n’est pas forcément en soi révélateur – si le refus de le commettre l’est assurément. L’apostasie qu’ils attendent des prêtres va au-delà – et si, dans leur sadisme cette fois d’ordre psychologique, ils comptent bien contraindre Rodrigues à poser le pied sur l’effigie de son Dieu, ils veulent en obtenir bien davantage : dans la parole autant que dans la pensée, le prêtre devra renier sa foi de bout en bout.
Et c’est ici qu’interviennent, dans l’optique égocentrée du père Rodrigues, les tourments physiques infligés aux pauvres paysans qui se croient chrétiens sans l’être forcément… Le chantage se met en place : si le bon père prêche le culte d’un dieu de bonté, peut-il rester insensible aux gémissements de ses ouailles, qui souffrent incomparablement plus que lui, et à cause de lui ? Poussera-t-il le fanatisme hypocrite à ce stade de l’indifférence aux souffrances de ceux qu’il prétend aimer et servir ? Un mot suffirait – un mot ! N’osera-t-il donc pas le prononcer… et pourtant continuer à révérer en façade un Dieu qui s’est fait homme pour souffrir à la place des hommes ?
Dieu…
Rodrigues s’adresse à Lui…
Et n’en obtient pas de réponse.
LE SILENCE DE DIEU
C’est bien cette idée du silence de Dieu qui impose son titre au roman.
Mais elle y apparaît très vite – nul besoin d’attendre pour cela les tourments extérieurs infligés par le « commissaire » Inoue au père Rodrigues, ou plus exactement les tourments l’affectant directement : le constat des souffrances des chrétiens japonais y suffit déjà – et peut-être même leur seule pauvreté, avant leur persécution.
Le roman bascule sans doute quand Rodrigues perçoit enfin de visu le contenu exact de la répression antichrétienne – quand il quitte le village où il avait d’abord été accueilli, et où les deux chrétiens dont il se sentait le plus proche ont péri dans un supplice aussi grandiloquent qu’ignoble ; parmi eux, l’admirable Mokichi :
« Et soudain résonna en moi le mugissement de la mer tel que nous l'entendions, Garrpe et moi, dans notre cachette solitaire. Le bruit de ces vagues, roulant dans l'ombre, comme un tambour voilé, le bruit de ces vagues, déferlant sans raison, la nuit durant, refluant et brisant à nouveau au rivage. La mer implacable qui avait baigné les corps de Mokichi et d'Ichizo, la mer qui les avait engloutis, la mer qui, après leur mort, se déroulait à l'infini, pareille à elle-même. Tel le silence de la mer, le silence de Dieu. Silence sans démenti.
« Non ! Non ! je secouai la tête. Si Dieu n'existe pas, comment l'homme pourrait-il supporter la monotonie de la mer et sa cruelle indifférence ? (Mais en supposant... je dis bien en supposant.) Au plus profond de mon être, une autre voix murmurait pourtant. En supposant que Dieu n'existe pas...
« Terrifiante idée ! S'il n'existe pas, tout est absurde. Absurde le drame de Mokichi et d'Ichizo, attachés aux poteaux et balayés par la mer. Absurde l'illusion des missionnaires qui ont passé trois ans en mer pour arriver jusqu'ici. Et moi... rôdant dans ces montagnes désertes... absurde ma situation ! Arrachant des brins d'herbe, j'en mâchai, chemin faisant, luttant contre les pensées qui nouaient ma gorge comme une nausée. Je ne le savais que trop, le plus grand crime contre l'Esprit, c'est le désespoir, mais du silence de Dieu je ne pouvais sonder le mystère. »
Oui : nous n’en sommes pas au tiers du roman, et le prêtre, déjà, ne se contente pas de faire part, dans une lettre censément destinée à ses supérieurs de la Compagnie de Jésus, de ses interrogations quant au silence de Dieu – cela va plus loin : d’une certaine manière, son inconscient l’incite d’ores et déjà à envisager l’hypothèse qui semble la plus logique eu égard à ce fait incompréhensible autrement – et ce serait que Dieu n’existe pas…
Le questionnement se fera toujours un peu plus envahissant : Rodrigues, capturé, constate son impuissance – ses prières, les prières des chrétiens japonais, nul n’y répond : les fidèles souffrent, leurs gémissements l’empoisonnent toujours davantage, mais nulle réponse, jamais, et nul sens à tout cela. Le Dieu de bonté des chrétiens, tant bien que mal implanté dans les cœurs simples des paysans de la région de Nagasaki, observe la scène terrible sans un mot, les bras croisés – à supposer même qu’il existe, et il y a de quoi en douter…
Qu’est-ce qui, en effet, pourrait bien justifier ces atrocités ? La seule promesse du paradis destiné aux martyrs ? Mais les martyrs endurent mille morts ! Leur foi intarissable les dissuade d’apostasier – mais cette foi est-elle seulement celle qui leur garantira l’accès au paradis ?
Le silence de Dieu, encore et toujours – Rodrigues prie, supplie, mais Dieu se tait, et les chrétiens condamnés au supplice de la fosse gémissent… Quand bien même il avait eu pour réflexe premier de « nier » inconsciemment la source de ces gémissements – cela devait être quelque garde, posté là pour s’assurer de ce que le prêtre, cet homme si important, ne s’évaderait pas, et qui s’était endormi… Rodrigues ramenait ainsi tout à lui – comme de juste : c’est peu ou prou ce qu’il a toujours fait – et non sans un certain orgueil, le bon père s’assimilant plus que jamais à « cet homme » qu’était le Christ, et à son visage mythique qui demeurait si beau jusque dans la souffrance, bien loin des grotesques idoles des Japonais... et de leurs traits déformés par le supplice. Rodrigues ignorait donc ce qu’il en était, hors de sa cellule plongée dans les ténèbres ; il a fallu qu’on le lui dise – ses « bourreaux », en fait avant tout les bourreaux des Japonais – pour qu’il comprenne et admette que ce bruit de fond n’était pas un ronflement…
Mais Dieu, lui, savait. Il sait tout !
Il sait… mais il ne dit rien.
Plaçons ici une balise MÉGA-SPOILERS, au cas où – ça vaut jusqu’à la fin de cette chronique.
LA DERNIÈRE TENTATION DE RODRIGUES
En effet, un jour, Dieu parle enfin… si c’est bien lui ?
De manière significative, cette manifestation a lieu au moment où le « commissaire » Inoue se décide enfin à confronter Rodrigues à son possible supplice de manière concrète – en usant de la première étape habituelle, avant l'épreuve de la fosse, qui est le rite de l’efumi. Le prêtre foulera-t-il la planche où est représenté le Christ ? Il sait très bien ce qu’il en est de la valeur de ce « test »…
Il sait aussi, alors, que son prédécesseur Christophe Ferreira, qu’il adulait tant, avait bel et bien apostasié – nulle calomnie, ici ! L’impensable était vrai. Il a rencontré l’ex-prêtre, et s’est longuement entretenu avec lui – du silence de Dieu, notamment. Et, comme lors d’autres entretiens, avec le « commissaire » Inoue cette fois, ou son larbin l’interprète, ils se sont posés la question de l’implantation du christianisme dans le « marais » japonais… Ferreira incite Rodrigues à apostasier ainsi que lui – parce que leur cause est mauvaise et absurde, et parce que leur obstination génère les souffrances des paysans et les entretient. Ils peuvent, ainsi que ces derniers, révérer abstraitement un Christ qui serait avant tout l’homme ayant souffert pour les hommes… Mais les souffrances des hommes sont bien trop concrètes – et il suffirait d’un mot de leur part pour y mettre fin ! Ne serait-ce pas là le vrai sacrifice du chrétien ?
Le père Rodrigues est devant la planche de l’efumi. Et, lui qui n’osait plus interroger son Dieu mutique, il entend pourtant alors une voix – dans son crâne, mais qui lui paraît jaillir de la représentation grotesque figurant sur la planche : « Apostasie ! »
Le prêtre foule l’image de son sauveur.
UN ROMAN CHRÉTIEN, MAIS TOUT SAUF BIGOT
Un roman chrétien, Silence ? Oui, sans doute – dans la mesure où, si elles peuvent faire vibrer tout un chacun, les questions posées par le livre jaillissent d’un contexte catholique et lui sont intimement liées.
Mais pas un roman bigot – certainement pas. On comprend, à la lecture, que les chrétiens japonais de 1966 aient pu se faire « déconseiller » l’ouvrage. On comprend aussi qu’aujourd’hui encore, des chrétiens puissent se sentir mal à l’aise à la lecture de Silence, voire sombrer dans la colère. Fouinant sur le ouèbe, je suis tombé aussi bien sur des articles intelligents que sur des commentaires idiots – normal... Mais, dans de nombreux cas de part et d'autres, cette fin fait polémique… Est-ce Dieu qui parle à Rodrigues ? Ou bien lui-même – son inconscient plus ou moins lâche ? D’aucuns avancent que cela pourrait être Satan… Et l’apostasie du père ? Elle en irrite un certain nombre : c’était le héros, et un héros chrétien, il ne devait pas céder ! Je suis même tombé sur une discussion où un lecteur américain supposait que le gouvernement japonais, qui avait « financé les études » de Shûsaku Endô, avait dû aussi le payer pour qu’il écrive cette fin répugnante de propagande antichrétienne. Misère…
Cependant, le roman ne s’arrête pas avec l’apostasie du père Rodrigues. Demeurent quelques chapitres, plus ou moins en forme d’annexes, et qui témoignent des trente ans que l’ex-jésuite a encore passé au Japon, en résidence surveillée, sous un nom japonais. On en retiendra surtout le journal tenu par un commerçant hollandais… qui, effectivement, n’a pas grand-chose à faire de l’évangélisation : le protestant, contrairement à ses rivaux espagnols, portugais, etc., peut toujours commercer avec le Japon ; dans ses cahiers en forme de « livre de raison », il fait sa comptabilité, et note quelques anecdotes ici ou là, mais sans s’y étendre – les apostats anciennement catholiques y figurent, mais au fond il n’a rien à en dire… Il se contente de s’assurer que ses hommes respectent bien la législation antichrétienne du shogunat – et avec un certain zèle. Pages d’un romancier catholique ?
L’UNIVERSEL ET L’INTIME
Mais Silence interroge donc le christianisme, et sous deux angles qui sont indissociables pour le père Rodrigues (et pour Endô ?), quand bien même ils paraissent tout d’abord opposés, voire contradictoire. En effet, il faut tout autant s’y poser la question de l’universel et de l’intime.
C’est parce que le christianisme se pose en religion universelle de salut que l’évangélisation même peut – et doit – être envisagée. Pour le père Rodrigues en partance pour le Japon, convaincu de la pureté de la foi de son prédécesseur le père Ferreira, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : le message du Christ s’adresse à tous les hommes, même ceux qui, pour quelque raison étrange, vivent aux antipodes de l’Europe – et le Christ a souffert pour ces hommes aussi bien que les autres !
Mais, là-bas, le tableau se fait bientôt tout autre : ce sont les hommes qui souffrent, et pour un Christ qu’ils ne conçoivent pas très bien… Ils aiment en lui, justement, l’homme qui a souffert – un réconfort dans ce monde si rude. Mais ils l’adorent presque comme une idole, ou d'une manière vaguement bouddhique, et de même pour la Vierge Marie : leur foi, constate Rodrigues, n’est déjà plus tout à fait celle des chrétiens.
Le christianisme peut-il seulement s’implanter, et dans la durée, dans ce pays de mœurs et de culture si différentes ? Rodrigues veut le croire – mais Ferreira n’y croit plus. Le « commissaire » Inoue, ce « démon » qui mène d’une poigne de fer les persécutions contre les chrétiens japonais, est si habile à provoquer l’apostasie parce qu’il n’a rien d’un fanatique imbécile : il sait, lui, et entend le faire comprendre à Rodrigues, que le Japon n’est pas ce qu’il croit – mais c’est un « marais », et l’arbre chrétien, simplement privé de ses racines, ne pourra dès lors pas s’y épanouir. La religion universelle ? C’est un leurre – une hallucination, détachée des faits… et en tant que telle parfaitement absurde. Par ailleurs, foncièrement hypocrite dans une perspective réaliste des relations internationales...
La foi doit dès lors se replier sur son autre dimension : l’intime. Désencombrée des rites et de sa dimension sociale, la religion s’exprime en l’individu lui-même – ce n’est peut-être même que là qu’elle peut constituer une réalité vécue. Et, au fond, cette foi-là pourrait très bien s’accommoder du contexte japonais… Mais elle y perd paradoxalement son universalité, et tout son décorum. Peut-être est-il pourtant envisageable d'en extraire une autre forme d'universalité ? Dans un sens, la simple existence du roman semble en témoigner...
La foi intime, par ailleurs, peut certes relever de la conviction fanatique – mais, chez le père Rodrigues, constatant les souffrances de ceux qu’il devait considérer comme étant les siens sans être toujours bien en mesure de les appréhender comme tels, le caractère intime de la croyance chrétienne tourne bientôt à la rumination, et il n’y a dès lors plus qu’un pas, vite franchi car si perturbant et en tant que tel séduisant, avant la remise en question… Le silence de Dieu y est propice – et ce n’est pas le moindre paradoxe en cette affaire.
LA FAIBLESSE DE L’HOMME ?
Peut-être faut-il alors envisager rapidement une dernière question ? Elle revenait de manière plus ou moins marquée dans les commentaires que j’ai pu parcourir en fouinant un peu sur les réseaux… Peut-être tout particulièrement chez les plus hostiles ? C’est la question de la faiblesse de Rodrigues – incompréhensible pour ceux qui s’en tiennent au rejet viscéral de l’apostasie du héros. Mais, à tout prendre, Rodrigues n’est pas toujours un personnage très sympathique… Et, oui, il est peut-être « faible », mais d’une certaine manière seulement.
Là réside une certaine habileté de l’auteur : quand Rodrigues apostasie, le lecteur non chrétien tel que moi-même peut sans doute avoir comme une réaction de vague dégoût… en parfaite contradiction avec la thèse que ledit lecteur agnostique était amené à se forger depuis le départ ! Nous sommes très tôt convaincus de ce que l’apostasie est le choix à faire – mais quand Rodrigues fait ce choix, nous sommes portés à le rejeter avec un vague mépris… Alors même que la distance devrait nous inciter à y voir le plus héroïque de ses gestes, et peut-être même le seul ?
Mais le jésuite doit sans doute ici être envisagé en parallèle de la première et de la plus problématique de ses ouailles : Kichijirô. Le répugnant bonhomme avec lequel il embarque pour gagner clandestinement le Japon est bel et bien un « faible » ; ou, plus exactement peut-être, il s’affiche en tout cas comme tel, et sans cesse : il geint, il pleure, « je suis faible », « ce monde est trop dur pour les gens comme moi », « vous au moins vous êtes forts mais moi »… Ad nauseam. Ce qui n’incite sans doute pas le lecteur à le prendre en sympathie, et peut-être même pas en pitié. Encore moins sans doute quand, dans son village, il roule des mécaniques pour être ce « héros » qui a guidé les prêtres portugais…
Mais la « faiblesse » de Kichijirô va bien plus loin que ces seules postures – ainsi quand il dénonce Rodrigues, lequel à vrai dire s’y attendait… mais n’a rien fait pour s’en prémunir. C’est peut-être orgueil de sa part, d’ailleurs : comme avancé plus haut, notre jésuite se verrait bien en Jésus… Et Jésus doit avoir son Judas : le Japonais peureux est tout désigné pour incarner ce rôle honni. Finalement, Kichijirô vendant Rodrigues pour 300 ryô vaut bien Judas et ses trente deniers – et les collines désolées des environs, encore qu’un peu mornes pour cela, peuvent bien constituer un ersatz noyé sous la brume des jardins de Gethsémani…
Sauf que les circonstances amènent Rodrigues à envisager tant Kichijirô que son modèle biblique supposé d’un tout autre œil – c’est qu’entretemps le prêtre a fait le constat inadmissible du silence de Dieu. Et, après tout, pourquoi le Christ a-t-il laissé faire Judas ? L’orgueil ? Non, pas chez cet homme qui était Dieu, c’est impossible… En fait, il n’a peut-être pas simplement « laissé faire » : il y a encouragé son disciple maudit – « Fais ce que tu as à faire, et fais-le vite. » Judas avait son rôle dans cette tragédie – un rôle plus complexe que celui d’un vulgaire traître cupide : sa trahison était peut-être loyauté, nécessaire à la Passion et donc à la rédemption de l’humanité.
Et Kichijirô ? Le « faible », qui un instant s’affiche chrétien et la seconde d’après saute à pieds joints sur l’efumi, en répétant toujours ce même schéma, n’a-t-il pas quelque profondeur supplémentaire ? Première des ouailles du père Rodrigues, il sera aussi la dernière – qui reviendra sans cesse à la prison, proclamant à la face des gardes que oui, il est bien chrétien… mais sans jamais en faire les frais ? Plus encore, Kichijirô incarnera ce rôle même après l’apostasie de Rodrigues – lequel aura beau lui rappeler sans cesse qu’il n’est plus prêtre, et même plus chrétien, qu’importe ! Kichijirô, lui, avec toutes ses trahisons, demeure à l’en croire chrétien – et il n’en réclame que davantage l’absolution de ce père qu’il a vendu et qui n’est plus à même de la lui accorder…
Kichijirô, au final, n’est-il pas le véritable chrétien du roman ? Ou du moins celui qui compte…
DIRE ?
Silence est bien un très bon roman – beau, subtil et fort. Il dépeint un tableau poignant et déprimant avant que d’être horrible, et n’a absolument rien à voir avec l’image parfois répandue à la suite de la sortie de son adaptation par Martin Scorsese : roman chrétien mais tout sauf bigot (au point même d’être éventuellement suspect aux yeux de certains « fidèles », d’ailleurs), roman intime et psychologique bien loin de tout caractère de « roman d’aventures » (qualificatif employé en quatrième de couverture, allons bon), et interrogation subtile de la foi à mille lieues du snuff-martyrologe que l’on a parfois prétendu, c’est une lecture hautement recommandable et à même de parler à tous, qu’importe la religion.
Roman chrétien ? Oui – mais tout autant et peut-être davantage roman humaniste ; car si Dieu se tait, les hommes, quant à eux, ont bien des choses à dire – et qui font autrement sens.
Et le film ? Peut-être… On verra… Ou pas.