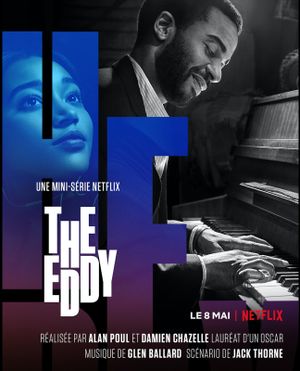Comme souvent, quand on aime beaucoup une chose, on ne s’en aperçoit pas tout de suite. Faut dire que The Eddy cache bien son jeu. Alors que ses consœurs séries de Netflix mettent le paquet sur les premiers épisodes, en empilant les intrigues, en balayant le plus vite possible tous les personnages, la proposition de Jack Thorne et Damien Chazelle termine son épisode pilote sur l’impression de n’avoir rien vu, rien compris, rien saisi.
C’est que The Eddy prend son temps. Grâce aux huit heures que lui offre Netflix, le réalisateur peut se permettre de repousser assez loin les enjeux dramatiques —en gros dans les quatre derniers épisodes— pour enfin se concentrer sur ce qui l’intéresse vraiment qu’il n’était parvenu à faire ni dans Whiplash ni La La Land : filmer le jazz.
Le jazz ne se limite pas à une prestation, d’un groupe de musiciens, dans une salle de concert. Il vit avant tout dans des clubs —ce qui donne déjà une autre ambiance— mais pas seulement. Il s’immisce dans chaque interstice de la vie, comme quand Farid et Elliot s’engueulent à propos de la compta, qu’Elliot plaque trois accords au piano, Farid arrange mode et tempo (« essaie en majeur », « plus rapide ») et saisit sa trompette. Ou quand Maja et Elliot jouent au vieux couple, qu’Elliot s’assoit au clavier, Maja arrête de faire semblant d’arranger la table de chevet, le rejoint et ils tâtonnent ensemble les paroles de ce qui sera le thème musical de la série, « The Eddy ». Ou encore, quand Jude tape cette salière sur la table de ce bar cubain, fredonne quelques notes et que les musiciens assis à côté montent sur scène pour l’accompagner.
La musique est dans la continuité de la vie. Elle surgit et disparaît comme une dispute avec sa fille rebelle ou comme se faire trancher la gorge en sortant les poubelles. Les choses sont disposées les unes à la suite des autres de façon linéaire, en presque temps réel. Il n’y a pas de pic narratif mais des moments plus intenses et rendus intenses uniquement par la sédimentation de tous ces passages de rien —disons de pas grand chose— qui les ont précédés. Il fallait donc bien huit heures de série pour espérer filmer quelques moments de jazz.
-
En abandonnant les enjeux scénaristiques dans sa première moitié, la série nous donne à voir autre chose, qu’on avait plutôt l’habitude de trouver au cinéma : de la mise en scène. Au lieu de passer mille ans à fignoler une histoire pour ensuite l’illustrer avec des corps qui bougent comme font habituellement les séries, Damien Chazelle semble avoir disposé les éléments d’un spectacle dont il n’avait plus qu’à capter le son et l’image. Pour le dire vite, il a pris l’argent de la série pour en faire un club de jazz.
Il ne filme donc plus une intrigue mais des corps en tant que corps, des lieux en tant que lieux. Les corps de deux adolescents qui badinent sur la pelouse des Buttes Chaumont, se balancent des bribes de phrases en franglais, parlent en même temps, tout en essayant de se donner une contenance. On ne l’avait jamais aussi bien vu et pourtant, du souvenir qu’on en a, c’est bien exactement comme ça que ça se passe.
Par l’attention minutieuse portée aux lieux, la mise en scène arrive à nous donner la sensation de l’espace. Un long plan séquence de cinq minutes ouvre la série et nous fait comprendre toute l’organisation intérieure du fameux club de jazz. On peut d’ailleurs s’arrêter deux secondes pour relever la virtuosité de ce plan qui dynamise l’image en glissant d’un cadre à un autre, et propose une variété impressionnante de valeurs de plans (serré sur la pelle à glaçons de Sim, large sur les musiciens, d’ensemble sur le reste de la salle).
Puis en dédiant chaque épisode à un personnage différent, on entre dans l’intimité des appartements de chacun. De l’immeuble fin XIXème pour Elliot à la maison de ville d’Amira, des Grands Ensembles où vivent Sim et Paplar (avec papier peint d’origine), aux appartements de Maja et Katerina, la série dresse une cartographie passionnante des intérieurs parisiens.
-
Dans sa deuxième partie The Eddy perd son originalité. On retrouve des enjeux dramatiques complètement débiles autour de la mort de Farid, liée à un gang ukrainien, dirigé par un promoteur mafieux : du grand n’importe quoi. Les longs plans-séquences musicaux sont remplacés par un découpage beaucoup plus classique ; on a même droit à du montage alterné entre la musique jouée sur scène et la vie des personnages en dehors du club, c’est à dire un éclatement du continuum espace-temps qui faisait toute la force des premiers épisodes.
Damien Chazelle, qui avait eu pourtant la bonne idée de filmer des musiciens, s’évitant ainsi les tristes performances d’acteurs, se retrouve avec une Leila Behkti qui en fait des caisses. Dans le rôle ultra-classique de la « mère courage » elle trouve l’excuse parfaite pour jouer à faire l’actrice. Le scénario reprend définitivement le dessus quand Elliot se retrouve à gérer au même endroit au même moment la démission de ses musiciens, la crise d’ado de sa fille et la faillite du club. L’artificiel a repris le pas sur le réel.
-
Ce qui n’est pas artificiel en revanche, c’est la fidélité touchante de Damien Chazelle pour le jazz, un genre complètement déclassé, minoritaire, qui se pratique en sous-sol, survit dans une économie précaire. Dès le deuxième dialogue de la série, Benjamin Biolay en producteur annonce la couleur : « J’ai un tout petit label moi, je gagne même pas d’argent ». Puis quand Farid revient de son rendez-vous avec le banquier : « Ils disent que le club c’est trop risqué, et pas assez français ». Il faut attendre la publicité d’un fait divers sordide pour que la salle se remplisse le temps d’une soirée.
Ce désir de mettre en lumière ce monde souterrain est beau. Il l’est d’autant plus que ce dévoilement n’est pas une vulgarisation. Quelques passages difficiles ne nous sont pas épargnés : l’hommage musical dans le jardin d’Amira se termine dans une transe de free jazz assez éprouvante. L’épisode sept nous offre une minute complète d’enregistrement d’une piste de batterie mise à nue.
Mais au-delà de la musique elle-même, c’est à l’esprit du jazz que Damien Chazelle est fidèle. Il nous donne à voir ce qu’on pourrait appeler l’ethos du jazzman, c’est-à-dire la façon qu’ont ces gens d’être au monde, leur tempérament, que nous allons essayer de cerner dans les quelques paragraphes qui suivent.
-
D’abord ils sont marginaux. Ils n’habitent pas les logements élégants du centre de Paris mais plutôt sa périphérie. Les retrouvailles entre Jude et son ex ne se déroulent pas au Jardin des Tuileries mais au-dessus des rails de chemin de fer Porte de la Chapelle. Le même Jude on retrouvera, stone, au fond des chiottes crasseuses du club de jazz. S’il leur arrive de fréquenter le faste d’un mariage bourgeois, c’est pour mieux baiser derrière un paravent minable dans les loges avant le concert.
Il y a quelque chose de l’adolescence chez ces personnes-là, dans leur rupture avec la famille bien sûr (Elliot a quitté sa fille, Maja ne veut plus voir sa mère, Amira et Farid ont rompu les liens également) ; mais aussi parce qu’ils semblent chercher leur place et c’est comme si toutes les bifurcations étaient encore possibles. Maja peut bien partir en tournée avec un mauvais chanteur, après tout pourquoi pas ? Qu’est-ce qui la retient ? dira-t-elle. Ils vivent au jour le jour. Ils ne se projettent pas, ils ne capitalisent pas sur l’avenir. La seule chose qui les intéresse c’est de jouer du jazz, comme un adolescent à des jeux vidéos.
Enfin ils vivent à la marge parce qu’ils sont étrangers. Peut-être d’ailleurs ont-ils émigré précisément pour fuir leur famille et leurs responsabilités, peut-être pour expérimenter le spleen du pays, peut-être pour vivre caché. Ils avancent en sous-citoyens, dans un pays qui les maltraite à la préfecture, leur refuse une carte d’invalidité et ne reconnaîtra jamais leur talent.
Car voilà le second caractère de l’ethos du jazzman : c’est que ces gens marginaux forment pourtant une élite, de clochards célestes, de princes déchus, d’aristocrates déclassés. Ils sont intelligents, fins, sophistiqués : Elliot n’a pas de preuve d’amour pour Maja mais il lui écrit des chansons. Il ne lui promet pas l’entente cordiale mais un partenariat. Il dit que ça ira mieux entre eux ; elle sait qu’il n’en sera rien. Ce sont des personnalités, des individus fiers et égoïstes comme on en croise rarement sur les écrans.
On n’a plus l’habitude de voir des gens si sérieux, si appliqués dans ce qu’ils font. Il y dans la vie ceux qui pensent que rien n’est grave, que oh, ça va, faut se détendre un peu. Et d’autres qui répètent des heures durant le même morceau de musique, qui sont pas là pour rigoler.
Leur application monomaniaque pour la musique a quelque chose de mystique, de spirituel et me rappelle les skateurs de 90’s, le film de Jonah Hill. Dans les deux cas, les univers décrits me sont a priori plutôt antipathiques. Ils sont habités par un esprit viril, une verticalité qui ne me ressemblent pas. Mais la dévotion totale des personnages pour leur art me les rend touchants et proches.
Cette passion c’est ce qui les anime, ce qui les garde en vie. Tout le reste est accessoire. Même la famille passe au deuxième plan. S’il faut mentir à la police, blanchir de l’argent ils le font, tout ça n’a aucune importance tant que le club reste ouvert. Elliot n’a jamais mis le nez dans la comptabilité parce qu’il était trop occupé à faire de la musique.
Pourtant lorsqu’il doit faire les comptes il s’y met, parler à la police il le fait, chercher sa fille disparue dans la nuit. Le jazzman est monomaniaque mais il se soigne. Quand la vie le contraint, il ne rechigne pas, ne se révolte pas (pas le temps pour la révolte) il accepte sa condition minoritaire. Il faut jouer du Mika pour un mariage ? Ainsi soit-il. Si le club est fermé, jouons dans la rue !
Elliot refuse de se produire en public mais la vie l’oblige. S’il veut préserver l’unité du groupe il devra s’y soumettre. Et à la fin il joue, la vie l’emporte, happy ending à l’américaine, c’est Netflix qui gagne. Il n’est plus question d’ethos mais d’éthique : il faut savoir composer entre un désir d’absolu et la dimension matérielle et irréductible de la vie. Merci les gars, le temps de quelques épisodes on se sera pris à rêver d’une série de pure mise en scène, constituée uniquement de corps, de lieux et de musique. Merci d’avoir rendu ce rêve possible, d’avoir entrouvert cette porte.