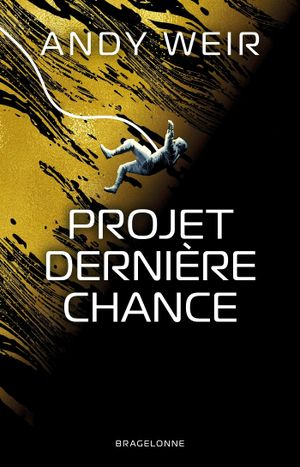Ce qui est paradoxal dans le genre de la « Hard Science », c’est que les auteurs y recherchent un « réalisme » scientifique parfois obsessionnel – à partir de données que l’on veut précises et correctement détaillées – alors qu’à peu près tout le reste – les personnages, les motifs, les relations humaines, les dialogues, l’arrière-plan social, psychologique et géopolitique – est d’une pauvreté assourdissante, terriblement artificiel, tombant très vite dans la caricature sans couleurs et sans pertinence, ce qui évacue immédiatement ce qui a été gagné sur le plan des descriptions physiques et biologiques.
On ne fait pas un roman en essayant de fourrer de la vulgarisation scientifique à tout-va, aussi précise soit-elle (ce qui n’est pas toujours le cas). Ce serait un peu comme faire un film en mettant tout l’effort sur les costumes, des costumes pensés au millimètre près, fruit d’une recherche historique de plusieurs années, alors que tout le reste, du scénario au jeu des acteurs, serait digne d’un film tourné par des lycéens fauchés, dépourvus d’idées et peu dégourdis.
Dans Project Hail Mary (littéralement Projet Ave Maria, traduit en français par Projet Dernière chance), tout sonne faux. Tout est en carton. Tout est superficiel. Le pauvre Andy Weir, ingénieur informaticien reconvertit en gros vendeur de mélasse, ne sait pas écrire. Pire que ça, il n’a aucune expérience des relations humaines et l’âge mental social d’un collégien.
Les personnages n’existent pas. Ce sont de pures fonctions. Ils n’habitent aucun monde. Ils n’ont aucune consistance et reflètent en permanence les clichés vulgaires d’un pseudo-écrivain qui vit dans un sas dépressurisé où le monde réel – sa complexité, sa diversité, ses tensions et ses impuretés – n’existe pas. Tout le monde a le même statut social. Les gens sont riches, diplômés en science, occidentalisés et citoyens du monde, toujours là pour sauver l’humanité alors qu’ils n’expriment qu’une bien médiocre version de l’humanité, une humanité de bureau et de laboratoire, fonctionnelle et qui se fiche éperdument de l'humanité concrète. Ils viennent du monde entier mais n’ont aucune spécificité, aucune saveur, aucun ancrage, aucun trait qui les distingue les uns des autres à part des saillies caricaturales qui semblent issus d’un navet hollywoodien des années 80 (L’astronaute russe qui boit de la vodka, le chinois sérieux, les enfants super passionnés en classe qui sont curieux et intelligents, et le personnage de Stratt qui accumule tant d’incohérences idiotes qu’il dépasse l’entendement).
Le personnage principal n’a rien à faire là où il se trouve, mais au lieu d’en tirer un effet comique, l’auteur nous le présente comme un héros invincible, qui a réponse à tous les problèmes d’écolier qu’il se pose à lui-même. Pour lui donner du relief, il le fait parler comme un adulte attardé, affublé d’une casquette à l’envers, qui se prendrait pour le gars cool qu’il n’a jamais été au lycée, dans les années 80. Plus qu’affligeant, c’est très souvent embrassant. Blagues lourdingues, vocabulaire éculé, insultes et mots vulgaires, expressions ringardes (« gosh darn ») et complètement inadaptées, qui tombent comme un cheveu sur la soupe pour essayer de se donner des airs de mec dans le coup (Le personnage traite par exemple son collègue extraterrestre de connard (jerk), sans aucune raison, passant pour une personne instable atteint du syndrome de Tourette.) On veut parler de kiki, de caca, de prout prout, pour se donner l’air cool et détendu, mais évidemment, le résultat, c’est que tout ça sombre dans la bêtise la plus crasse.
J’ai l’habitude de distinguer trois dimensions dans l’art de l’écriture. Celle du langage, celle de la fiction, et celle de la philosophie. Pour faire très vite, le volume et l’épaisseur de la langue utilisée, le vocabulaire, la justesse des mots, le rythme, la diversité des registres, la poétique, appartiennent à la première dimension qui permet de coudre un vêtement expressif plus ou moins ample, plus ou moins chaud. L’art de dessiner des personnages, de les faire vivre, de les mettre en situation, tout comme l’art de construire une histoire riche, qui propose une diversité de points de vue et multiplie les interprétations possibles appartient à la deuxième. Enfin l’art de se placer à un niveau existentiel suffisamment dense, en soulevant des dilemmes moraux, métaphysiques, politiques, anthropologiques, permettant d’éveiller le lecteur à des questions essentielles, un tant soit peu profondes, appartient à la troisième. Les trois dimensions interagissent évidemment fortement.
Le Projet Dernière Chance échoue lamentablement à tous les niveaux. La seule réussite se situe dans son idée générale de récit, qui permet de tenir, à grand-peine, une centaine de pages sans trop froncer les sourcils. Un vague début de trame plutôt bien pensé qui, au final, est terriblement mal exploité, voire totalement gâché. Pour tout le reste, on se situe à trois cents kilomètres sous terre et j’ai senti une forme de honte à lire les inepties narratives de Weir, peuplées d’incohérences grotesques, et à me faire asperger de sa pauvreté verbale et de ses métaphores lamentables (« comme un Caprisun pour adultes »). J’ai eu la même impression de platitude que devant une publicité ou un programme de télévision médiocre. Même un Comic moyen propose de meilleurs dialogues que ça.
Le personnage résout tous les problèmes, il n’affronte aucun obstacle, il a réponse à tout. Il apprend une langue extraterrestre en une semaine. Il est tout-puissant et infantile. C’est exaspérant.
Tout comme dans son livre « The Martian », Weir fait tout pour éviter d’avoir à faire cohabiter plusieurs personnages à la fois (ce dont il est incapable puisque cela suppose des interactions) et, lorsqu’il y est obligé, faute de tomber dans la psychose totale, il produit une copie de son personnage principal, ou alors un personnage objet qui ne sert à rien.
Le pauvre Rocky, l’extra-terrestre, est affligeant de fadeur et d’immaturité. Il ne sert à rien qu’à mettre en valeur les fantasmes du personnage principal, version romanesque de Weir qui, décidément, doit avoir des problèmes de socialisation dans sa vie d’ancien ingénieur nouveau millionnaire (la manière dont le personnage finit me semble être beaucoup plus qu’un symbole).
L’auteur semble n’avoir jamais eu de relations avec des êtres différents, qui entrent en conflit avec lui, qui ne pensent pas comme lui, qui lui posent des problèmes. C’est à croire qu’il vit seul dans un simulateur sophistiqué, ou dans une émission du genre Truman Show.
On trouve au milieu du livre cette phrase prophétique : « Lorsque l’esthétique ne compte pas, on obtient les couleurs produites par le processus industriel ». En effet. Une belle bouillie industrielle que ce livre gris comme les blagues minables de son auteur.
Je n’ai pas lu The Martian (Seul sur Mars), son précédent livre. J’ai seulement vu le film de Ridley Scott qui m’a paru un condensé de nullité sans âme. On peut déjà prévoir que le film qui va sortir de cet étron sera tout aussi insipide et vulgaire (et pourtant meilleur que ce livre atroce).