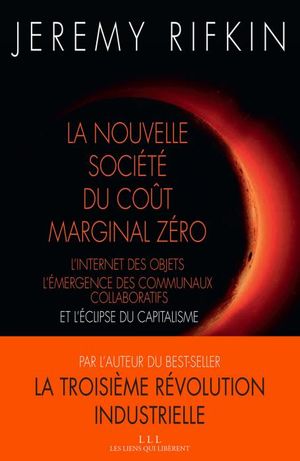Et si l’économie capitaliste telle que nous la connaissons était en passe d’être dépassée par une autre forme d’économie dans les prochaines années ? Et si les technologies et les mentalités nécessaires pour s’extraire d’un système qui a montré ses limites tant au plan social qu’environnemental étaient déjà présentes parmi nous, et déjà exploitées par des millions de personnes ?
Dans l’histoire de l’humanité se sont succédé plusieurs « matrices énergie / communication », autrement dit des modèles de société tournant autour d’une source d’énergie principale et d’un moyen d’échanger des informations. Dans l’Europe féodale, par exemple, on utilisait du muscle et du bois, avec une communication essentiellement orale. A l’ère industrielle, l’arrivée du charbon a fait augmenter la quantité d’énergie disponible, et la machine à vapeur a relié des villes éloignées entre elles, intensifiant considérablement les échanges. Au XXe siècle, le pétrole et l’ordinateur ont permis la création des grandes sociétés mondialisées. Ces deux dernières matrices n’ont pu voir le jour que grâce à une intégration très horizontale et centralisée du processus de production, avec d’importantes économies d’échelle (on pense par exemple aux énormes réseaux de voies ferrées aux États-Unis, qui ont coûté une blinde). C’est ainsi que l’économie capitaliste que nous connaissons s’est imposée comme modèle dominant, épaulée notamment par les États.
Mais ce système économique porte en lui les germes de sa destruction. En effet, il repose sur le principe de concurrence entre entreprises : chacune a intérêt à réduire le prix de ses produits pour attirer les clients, en diminuant le coût de production et la marge de profit. Mais que se passe-t-il, dans un monde où la concurrence est mondiale, le coût de production optimal déjà atteint et la marge de profit par objet vendu (le « coût marginal ») quasi nulle ? Il devient de plus en plus dur d’être rentable, ou bien cette rentabilité se fait au détriment des salaires, ce qui n’est pas durable puisqu’il y aurait moins de monde pour acheter les produits créés. Le capitalisme fonctionne bien dans une situation de pénurie, où la rareté fait la valeur, mais dans une situation d’abondance, les rouages se grippent.
C’est alors qu’un vieux modèle d’organisation sociale refait surface : les « commons », ou « communaux » en français. On les connaît en économie pour la « tragedy of the commons » : dans un champ où tous les fermiers auraient le droit de laisser paître leurs bêtes, le pauvre champ finirait complètement brouté en moins de deux. Le concept prédit donc qu’en économie, si quelque chose est gratuit, il sera forcément exploité jusqu’à sa destruction du fait de l’égoïsme humain. Cela se révèle plutôt vrai dans le cas de l’écologie, avec les ressources forestières ou halieutiques… Pourtant, il existe partout dans le monde des champs que des éleveurs peuvent gratuitement utiliser, et tout se passe bien. Pourquoi ? Parce que ces utilisateurs de ces champs se retrouvent en eux, qu’ils s’accordent en amont sur le nombre de bêtes à faire paître, et que malgré un système de sanctions assez laxiste, chacun sait qu’il en va de son honneur et de sa réputation de ne pas trahir les autres. C’est ce qu’on appelle l’économie collaborative.
Or, ce modèle des communaux collaboratifs fleurit déjà autour de nous, et dans de nombreux domaines ! Le transport ? L’autopartage permet de mettre en commun une voiture entre plusieurs individus. La connaissance ? Un site non lucratif comme Wikipédia s’est imposé comme une référence grâce à son système de contrôle entre utilisateurs. Les hôtels ? Couchsurfing, sorte d’Airbnb gratuit, crée des liens de confiance entre personnes de différentes régions du monde. L’enseignement ? Les MOOC, cours en ligne gratuits, permettent à tous d’accéder aux meilleurs professeurs du monde entier. La création artistique ? Les licences « creative commons », ou copyleft, permettent de propager librement du contenu type vidéos ou musique entre Internautes. Et ce ne sont que quelques exemples de manières de passer de la propriété à celle de l’accès. L’idée est simple : au lieu de s’approprier les richesses du monde, on les utilise respectueusement.
Le développement exponentiel de l’Internet (connu sous le nom de loi de Moore) a permis, en une dizaine d’années, de connecter entre eux des milliards de gens à travers le monde. Une fois le réseau installé, envoyer des informations où l’on veut se fait à un coût marginal quasi nul (une fois qu’on a payé l’électricité et la box, on peut en envoyer autant qu’on veut !). Aujourd’hui, Internet est un incontournable, qui a complètement remanié l’économie. Bonne nouvelle : le développement des énergies renouvelables suit aussi une courbe de développement exponentielle, au point qu’elles seront accessibles à tous à échelle individuelle pour des coûts dérisoires d’ici quelques années. A cela s’ajoute deux autres courbes de développement exponentielles : l’Internet des objets et l’Internet de la logistique. Combinées, elles donnent des résultats spectaculaires : d’un côté, les objets connectés recueillent les données (si elles ne sont pas interceptées par de grosses entreprises !) tandis que de l’autre, celles-ci sont incorporées dans l’économie. Liées au système d’énergies renouvelables, elles pourront répartir automatiquement l’électricité dans le réseau en évitant les surcharges lors des heures de pointe ; liées aux infrastructures urbaines, elles indiqueront d’éventuelles réparations ou fluidifieront la circulation automobile, etc.
Encore plus prometteuse, bien qu’encore au stade expérimental, l’impression 3D risque fort de révolutionner le mode de production. Au lieu d’avoir à acheter des marchandises type mobilier, figurines, verre etc. venant de grosses usines, il n’y aurait qu’à télécharger des plans en ligne et de faire imprimer soi-même ou dans un fab lab local les produits désirés. On arrive déjà à produire des puces électroniques et du verre par impression 3D : le catalogue se remplira sûrement à l’avenir… Là encore, les grosses entreprises risquent de s’opposer à cette technologie, la prudence reste donc de mise…
Heureusement, il y a de bonnes raisons de penser qu’à terme, cette transition vers l’économie collaborative va aboutir. En effet, les « matrices énergie / communication » se sont toujours alliées à des formes de philosophie pour se donner un crédit moral. Chacune a été accompagnée d’une manière de penser et de concevoir la nature humaine : le système médiéval des vassaux se mariait harmonieusement avec l’ordre organique de la société féodale où chacun avait une fonction à remplir ; les Lumières anglo-saxonnes et l’utilitarisme ont justifié la propriété comme moyen d’augmenter le bien-être général et ainsi servi le capitalisme. Aujourd’hui, un nouveau paradigme émerge peu à peu, plus adapté à un système latéral pair-à-pair et collaboratif, à base de valeurs collectives et environnementales. Les jeunes générations biberonnées à la gratuité d’Internet et avides de partage, malgré leurs paradoxes, se révèlent plus ouvertes et moins matérialistes que les précédentes.
Si le mot « capitalisme » est un repoussoir pour beaucoup de gens, il ne faut pas oublier de juger la situation dans sa globalité. Rifkin admet que le système en place a considérablement augmenté la richesse totale en circulation, ce qui est plutôt cool en soi, mais reconnaît qu’il n’est plus adapté dans une ère marquée par les inégalités sociales, le réchauffement climatique, etc. Cela ne l’empêchera certes pas de continuer à fonctionner dans certains pans de l’économie où il se révélera plus efficace, mais il ne subsistera qu’en tant que complément. L’optimisme béat n’est pas non plus de mise : les communaux collaboratifs ne vont pas non plus chasser la part sombre de l’humain, mais ils auront au moins l’avantage de donner plus de poids à des valeurs comme le partage par rapport à des valeurs individualistes comme la réussite personnelle. Ce qui, pour ma part, m’enthousiasme pas mal. Rifkin a écrit son livre en 2014 et pour l’instant, ses prédictions ont l’air plutôt justes. De quoi être optimiste pour la suite, ou du moins, plus optimiste qu’avant.