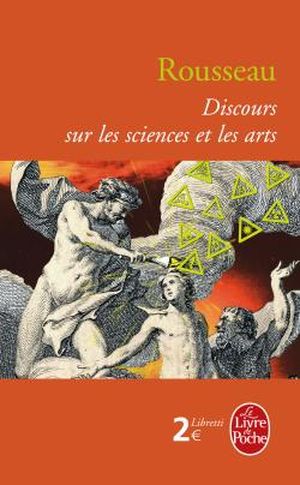Le Discours sur les sciences et les arts est un texte étonnant, auquel on ne s'attend pas forcément quand on pense à Rousseau. Le personnage, assurément, fait partie du panthéon des grands hommes qui ont guidé cette pauvre humanité obscurantiste depuis des millénaires sur la voie rédemptrice du Progrès. Rousseau, c'est le symbole du siècle des Lumières et du génie français du XVIIIe siècle, à tel point qu'un vidéaste de l'internet a pu affirmer sans crainte qu'un petit Africain ou un petit Guyanais pouvait acquérir la culture française (sic) en lisant Rousseau.
Ce qui est dommage, c'est que Rousseau, lui, n'aimait pas beaucoup les mœurs et les manières françaises. Effectivement, Rousseau était... suisse. Or, la Suisse était encore un pays pauvre (il l'est resté jusqu'aux années 1950), où, au fin fond des vallées reculées et peu accessibles, les montagnards vivaient dans le plus simple appareil, se contentant du peu de choses qu'ils parvenaient à produire dans une nature hostile et peu clémente. De ce fait, Rousseau avait dû migrer en France pour vivre la vie d'intellectuel ou d'homme de lettres qui lui était destinée : il s'établit ainsi à Lyon pour devenir précepteur. Et loin de son pays natal, de ses montagnes et de ses prés alpins, Rousseau devint nostalgique de son chez-lui et de ses compatriotes, tout autant qu'il aimait peu la façon française de vivre.
C'est là le point de départ de ce texte. En 1749, l'académie de Dijon met au concours la question suivante : « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. » La question, en elle-même, paraissait à la limite du choquant : elle laissait l'éventualité d'une critique du progrès ! À l'époque des libre-penseurs, il n'était pas question de s'autoriser une telle liberté de penser... Rousseau, lui, la prend. Le résultat, ce discours d'une cinquantaine de pages qui le rendit célèbre. Aussi célèbre qu'un Jean-Marie outrancier ! Car c'est l' « outrance » du propos qui fit parler de lui, d'autant plus qu'il remporta le premier prix du concours. Ce qui suscita une grande indignation chez les gardiens du bon goût : on trouvait choquant qu'une académie d'un pays civilisé puisse accorder le premier prix à quelqu'un qui... critique le Progrès ! On se croirait de nos jours...
Pour Rousseau, le « rétablissement des sciences et des arts » (c'est-à-dire, la Renaissance après cet obscur Moyen Âge) n'a en rien rendu les hommes meilleurs. C'est même le contraire. Il le constate en France où, dans ce pays policé à l'extrême, berceau de la civilisation, les bonnes manières ne rendent pas les gens meilleurs, mais simplement hypocrites, et où le cosmopolitisme (selon son expression polémique et dédaigneuse pour désigner l'humanisme universaliste), affichant un amour profond pour les lointains étrangers, ne sert que de prétexte pour se dispenser d'aimer les siens. Pire que ça, cette sociabilité à la française, donc civilisée selon les catégories de l'époque, en imposant de nombreuses contraintes à l'individu sommé d'être poli, courtois et soucieux des autres tue le génie individuel naturel contenu en chacun de nous.
À ce modèle de civilisation, Rousseau oppose plusieurs exemples historiques. Il y en a surtout trois. D'abord, les « sauvages » du Nouveau Monde : depuis le XVIe siècle, la découverte de cultures étant restées complètement séparées du monde européen ou asiatique avait ébranlé la confiance des Européens en leur propre modèle de civilisation ; on avait alors le sentiment que les Amérindiens vivaient en meilleure santé malgré la simplicité de leurs conditions de vie que les Européens dans leurs villes puantes et crasseuses. Ensuite, Rome : Rousseau était fasciné par Rome ; il reproduit en grande partie les critiques de Sénèque, philosophe stoïcien du début de l'Empire reprochant à la bonne société romaine de s'amollir à mesure que les loisirs se développent et, de ce fait, d'abandonner leur fonction militaire et politique ; un citoyen vertueux doit être humble, tel Cincinnatus qui était en train de pousser sa charrue quand on l'a appelé pour revenir au pouvoir afin de sauver Rome du péril.
Le troisième modèle de Rousseau, enfin, c'est tout simplement la Suisse, sa patrie. Car c'est bien un idéal politique suisse (ou montagnard) qu'il oppose à la civilisation incarnée par la France : ce que met en valeur Rousseau, c'est la vie paysanne simple, rustique, difficile, face à une nature hostile mais qui forge des hommes durs, vaillants, courageux et, pense-t-il, vertueux. Plus que ça : les Suisses sont jaloux de leur liberté et ils savent la défendre les armes à la main. La nation suisse naît, dans l'épopée nationale de ce pays, lors de la bataille de Morgarten en 1315, quand les confédérés suisses des cantons d'Uri, Schwytz et Unterwald en sous-nombre repoussent l'armée impériale menée par le duc d'Autriche. L'idée typique des montagnards qui défendent les armes à la main leurs libertés, c'est-à-dire leur modèle social et politique anarchiste, peu hiérarchisé et démocratique, contre les envahisseurs de la plaine n'est pas propre qu'à la Suisse : les communautés paysannes dans les Pyrénées ou dans les Alpes sont longtemps restées hors de contrôle réel des autorités centrales ; au Moyen Âge, une confédération de villages alpins, en Italie, avait par exemple mené une guerre pendant un siècle entier à un monastère qui prétendait détenir des droits sur leurs pâturages ; de nos jours encore, la reconnaissance de l'État français dans certaines vallées des Pyrénées est, dit-on, toute relative...
Rousseau établit ce lien : la liberté la plus profonde et la plus pure n'est rendue possible que par un mode de vie simple, austère, qui bâtit des hommes solides, vaillants et courageux, donc à-même de défendre farouchement leur liberté sur le champ de bataille. C'est toujours cette idée qui guide l'idéal politique suisse de nos jours, et qui explique donc leur doctrine du citoyen-soldat (qui fut aussi celle de la France entre la Première et la Deuxième guerre mondiale, soit-dit en passant) ainsi que l'importance que les Suisses accordent à leur armée où le service militaire est quasi un rite de passage faisant entrer le jeune Suisse dans la communauté de son pays (ceux qui essayent d'échapper au service militaire sont méprisés). En somme, Rousseau valorise un modèle de virilité et de courage qui est selon lui la garantie d'une authentique liberté et d'une authentique autonomie contre une doxa qui, au contraire, pense que c'est l'avènement de l'État et la domestication des masses qui permettra (paradoxalement ?) l'avènement de l'individu libre et autonome, rêve de la modernité. Il s'oppose également à l'idée libérale selon laquelle « les vices privés font le vertus publiques » (Mandeville), lesquelles n'étant résumées qu'à la richesse : le monde des marchands et des banquiers est un monde où le vice est brandi fièrement comme nécessaire au confort matériel.
En somme, Rousseau s'oppose du tout-au-tout à l'idéal progressiste : les progrès des sciences et des arts entraînent la décadence ; l’adoucissement des mœurs n'est en fait qu'un amollissement des âmes, qui entraîne un affaiblissement de la vertu ; la discipline à l'œuvre dans le processus de civilisation est la disparition de la liberté et de l'autonomie des communautés villageoises vivant simplement ; l'humanisme universaliste n'est que la manifestation d'un égoïsme misanthrope qui fait oublier l'amour de la patrie, la plus haute vertu politique possible contenant en son sein la possibilité d'une liberté politique authentique que l'on défendra éventuellement par les armes.
Mais dans le même temps, Rousseau conserve quelque chose de tout-à-fait moderne et même dans un de ses aspects les plus délétères. Ce texte a encore le mérite d'être dépourvu des concepts abscons que le philosophe suisse inventera par la suite. Il n'empêche qu'il contient en germe les développements ultérieurs de sa pensée. Car contre la contrainte imposée par le modèle de sociabilité français qui impose un recul de l'individu dans un souci de laisser en retour sa place à l'autre dans une forme de respect et d'humilité, Rousseau valorise un génie individuel que l'on doit pouvoir exprimer dans sa plus simple naturalité, car la nature est bonne : les hommes ne sont pas mauvais par nature, c'est la société qui les corrompt.
Ce mélange de thèmes encore assez confus dans le Discours sur les sciences et les arts annonce l'esprit romantique en lutte contre l'étatisme progressiste qui nivelle et arraisonne le monde en tuant la liberté des peuples et les peuples en tant que tels. Il annonce aussi un individualisme délétère faisant de l'enfant un petit génie qu'il ne faudrait surtout pas contrarier, sous peine de le rendre mauvais — ce qui correspond aussi à une certaine esthétique romantique (le génie isolé, mélancolique marcheur à la tombée de la nuit ou solitaire grimpeur de montagnes contemplant le monde au-dessus des nuages). Il me semble d'ailleurs que Rousseau fantasme beaucoup sur les sociétés « primitives » ou « vivant dans la nature » : ces sociétés ne vivent pas sans culture, elles peuvent même être plus civilisées ou policées que les sociétés modernes à bien des égards (il y règne plus de respect ou de politesse), et les rapports entre personnes ou de pouvoir ne sont pas moins codifiés par des normes, des règles, une tradition pas moins (et souvent plus) strictes et contraignantes que dans les sociétés dites évoluées. Or, j'ai du mal à voir ce qu'il y a de mal dans la politesse, le respect et le souci des autres...