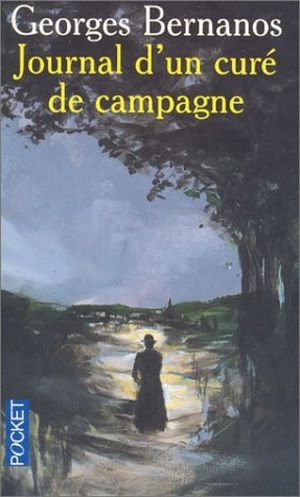Bonjour à tous,
Me voilà aujourd'hui avec ce roman célébrissime de Bernanos. Donc, pourquoi une critique de plus sur un livre trop connu, et très plébiscité, me direz-vous. Et bien, je trouve ce roman particulièrement mal compris, de manière générale ( mon petit ego narcissique ne peut pas le supporter... Peut-être est-ce le diable qui se joue de moi... )
Plus sérieusement, parlons peu, mais parlons religion. Non ! Pauvre fous que vous êtes ! Parlons plutôt de l' Homme, et de sa médiocrité ( je suis d' une médiocrité affligeante également rassurez-vous... ).
J' avais dis plus de sérieux non ? Je vais finir par vous lasser, et me lasser moi-même. Allons-y. Mauriac disait : « Le don magnifique de Bernanos, c'est de rendre le surnaturel naturel », Albert Camus « Cet écrivain de race mérite le respect et la gratitude de tous les hommes libres ». ça donne envie non ?
Georges Bernanos est hanté par la mort. Cette hantise d’une fin irrémédiable, il la retranscrit avec beaucoup de force dans le journal de ce petit curé de rien du tout. Jeune homme malingre et en proie à de terribles douleurs d’estomac, sans aucune assurance, le narrateur s’escrime à écrire un journal pour mettre à plat ses doutes sur sa capacité à servir de guide à ses ouailles ainsi que ses interrogations sur la foi. Là où le roman surprend, c’est que ce pathétique, très vite on ne peut plus s’en passer. Et l’écriture de Georges Bernanos, auteur de Sous le soleil de Satan, n’y est sûrement pas étrangère. Mêlant habilement les soucis quotidiens de la paroisse du curé (mais aussi ses problèmes de santé) et, beaucoup plus profonde, sa foi vacillante, l’auteur dépasse l’enveloppe textuelle de son personnage de fiction pour mettre en avant ses propres interrogations. Pratiquement triste du début à la fin, Journal d’un curé de campagne n’en est pas moins un indescriptible hymne à la vie. Sans doute ce que j’ai lu de mieux depuis longtemps.
Le chef-d'œuvre de Bernanos ? Assurément, mon bon monsieur ! C' est avant tout un roman profondément humain car authentiquement chrétien. Le regard porté par l'écrivain nous fait comprendre avec l'esprit et le cœur le parcours de ce jeune prêtre en chemin vers le plus grand dépouillement et le plus grand abandon que lui imposent sa solitude et sa maladie. Cette déréliction lente et inéluctable est mystérieusement transfigurée en voie de salut, sur laquelle le petit curé entraîne presque malgré lui ses paroissiens les plus farouchement éloignés de Dieu.
Et la langue splendide de Bernanos traduit à la perfection cet imperceptible rayon de lumière au milieu des ténèbres les plus épaisses. Cette sublimation de la langue française exprime à merveille l'invisible rédemption que Dieu opère au plus intime du jeune prêtre.
En véritable prophète, Bernanos répond à l'avance au « L'enfer c'est les autres » de Sartre, en faisant dire au curé : « L'enfer c'est de ne plus aimer. »
Voici les dernières lignes que Bernanos fait écrire au petit curé mourant :
« Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. ».
La force du roman de Bernanos est d’établir le lecteur dans cet espace d’indécision où il ne saurait trancher entre deux lectures : une lecture médicale, selon laquelle le don entier de sa personne à ses paroissiens que pratique le jeune curé d’Ambricourt, don si entier qu’il débouche sur la mort (en bref : il sauve les âmes au lieu d’aller se faire soigner) est miné par la maladie. Il ne serait donc qu’un faux-semblant, une manifestation secondaire intégralement placée sous un signe de mort, d’un abandon à la mort, voire d’un désir de mort.
Ou bien alors, à l’opposé, on aurait une lecture chrétienne, spiritualiste, une approche par le sublime qui verrait dans le parcours de don et d’abandon du jeune prêtre une sorte de passion, et ferait de celui-ci une sorte de saint poursuivant la tradition de St François d’Assise, qui rend inséparable don de soi et dépouillement, ceci jusqu’à l’effacement, la disparition du sujet même. Une approche par la grâce, à laquelle invitent les derniers mots du livre...
Chacun/e, sur ce point, se fera sa propre religion, c’est bien le cas de le dire, mais sans que cela change quoi que ce soit au fond : quel que soit le parti de lecture que l’on adopte, la manière dont le jeune curé va exercer son ministère en s’y vouant entièrement appellera toutes sortes de réserves et de perplexités. Sous quelque angle qu’on l’examine, la figure du don qui est ici présentée persiste à être hautement problématique.
Mais, si je devais m' engager, je dirais que c' est là que réside l’originalité et la force de l’ambition littéraire de Bernanos : il ne veut pas rendre compte de l’enlisement d’un peuple ou de l’effacement de la foi chrétienne en France, mais humblement tracer des routes sinueuses vers la fracture cachée qui déchire chaque homme. Cette fracture, mise en lumière par un style violent et empathique, devient bientôt un abîme dans lequel paraît s’être jetée l’espèce humaine entière.
Chaque révélation est une blessure vive que nous avions jusque là délibérément ignorée, et qui se rappelle alors à nous par la douleur que réactivent les évocations de Bernanos. Comment l’homme, si prompt à avouer ses péchés, lucide de ses défauts et terriblement conscient de sa futile condition, en arrive-t-il à les oublier si rapidement et à en effacer toute trace, au point de ne plus même chercher le pardon – au point même de ne plus vouloir tout simplement s’améliorer ? Le village entier et ses créatures désabusées ne cessent de jeter au visage du jeune curé, par leurs comportements et leurs paroles, la réponse la plus évidente et la plus violente qui soit : l’homme a renoncé. Il a rejeté l’espoir, pour avoir été trop souvent déçu. Il a rejeté l’amour, pour avoir été trop souvent blessé. En parlant des enfants, Bernanos écrit avec tristesse : « Quand leur bouche a pu l’articuler pour la première fois, le mot amour était déjà un mot ridicule, un mot souillé qu’ils auraient volontiers poursuivi en riant, à coups de pierres, comme ils le font des crapauds ». Par crainte, l’homme se protège désormais de la charité et de la compassion, et tourne en dérision les valeurs les plus nobles, les raillant pour leur faiblesse et leur naïveté.
Il n’est alors pas surprenant que l’homme se soit empressé de rejeter l’Église, accompagné par de mauvais conseillers qui lui firent miroiter des lendemains prometteurs, jurant qu’en brûlant les chapelles luxueuses et en confisquant les biens d’un clergé parasite, il obtiendrait enfin l’égalité promise, et que le malheur succomberait. Évidemment, le pauvre curé de campagne est le premier à maudire ce clergé détourné du Christ, mais son ami, le curé de Torcy, lui en donne la certitude : « Hors l’Église, un peuple sera toujours un peuple de bâtards, un peuple d’enfants trouvés ». Incapables de s’aimer les uns les autres, peut-être même incapables de s’aimer eux-mêmes, les hommes entendent déjà faire la révolution et changer l’ordre du monde, sans avoir même commencé par mettre de l’ordre dans leur cœur et dans leur âme. En détruisant l’ancien monde, ils ont cru conquérir la liberté et vaincre la misère – ils ont détruit avec lui la pitié. « L’ancien monde, lui, aurait pu durer peut-être. Durer longtemps. Il était fait pour ça. Il était terriblement lourd, il tenait d’un poids énorme à la terre. Il avait pris son parti de l’injustice. Au lieu de ruser avec elle, il l’avait acceptée d’un bloc, tout d’une pièce, il en avait fait une constitution comme les autres ». L’homme déteste la pauvreté, il la combat férocement, proclame le droit pour tous à la richesse, et prend honte du pauvre – le Christ, lui, l’aime profondément, car il ne prêche que la pauvreté.
Le curé qui tient son journal n’a pas renoncé. C’est là sa faute du début à la fin : il aime les paysans affamés avec la même conviction qu’il aime la comtesse hystérique. Il ne corrige pas les injustices – il en prend sa part. Acceptant l’horreur du monde, son seul labeur est de recommander les âmes à Dieu et de faire accepter à chacun un peu du Christ dans son cœur. C’est une tâche bien plus ingrate, moins exaltante et infiniment plus pénible que d’enflammer les foules par des discours. Humilié, détesté de ceux qu’il s’épuise à aider, souillé de boue au sens propre, son calvaire le détourne peu à peu de sa vocation, dont il commence à douter. Mais jamais les pires affronts ne parviennent à l’éloigner de Dieu, et sa foi, magnifiquement sombre, embrasée par le plus dangereux désespoir, devient petit à petit une cathédrale ténébreuse et splendide, dans laquelle il se recueille, plus proche que jamais du Christ dont il continue à transmettre la parole.
Bernanos parvient finalement au fond de cet abîme au-dessus duquel il nous a vertigineusement tenu suspendus. La vérité est un affront au monde. En refusant de donner à ses fidèles ce qu’ils attendent, en refusant de rendre la foi attrayante, en refusant de diluer le message pur des Évangiles, si intolérable à l’esprit bourgeois, pour mieux le vendre, le pauvre prêtre découvre alors l’insupportable vérité du christianisme : il est un danger. Il est une révolution. « Les pauvres. C’est à eux que le bon Dieu nous envoie d’abord, et pour leur annoncer quoi ? La pauvreté. Ils devaient attendre autre chose ! Ils attendaient la fin de leur misère, et voilà Dieu qui prend la pauvreté par la main et qui leur dit : »Reconnaissez votre Reine, jurez-lui hommage et fidélité » , quel coup ! »
Rien d’étonnant donc à ce que l’homme se soit détourné de l’espoir, quand le seul bouleversement auquel il peut aspirer est une contradiction radicale de ses aspirations terrestres. N’importe qui peut prêcher le renoncement matériel à un riche propriétaire : qui irait l’exiger d’un enfant mourant de faim ? L’indignation conduit donc l’homme à se révolter – puis, la révolte étant inlassablement vouée à l’échec, l’homme se terre dans l’indifférence et l’habitude. « Car si notre espèce doit périr, elle périra de dégoût et d’ennui ». Tout le roman gravite autour de cette urgence, d’abord pressentie indistinctement par le jeune curé, puis s’affirmant avec de plus en plus de netteté : il sera un jour trop tard. Car si l’homme révolté, par l’essence même du message politique qu’il porte, peut toujours espérer des lendemains glorieux, faisant feu de tout bois, se consolant même dans les pires défaites à la lueur de sa torche, en attendant aveuglément le grand soir, l’homme de foi est condamné. Il est condamné à une espérance certes bien plus tenace et bien plus certaine, mais dont les fruits ne seront récoltés qu’à la stricte condition qu’il parvienne à accepter le Christ. L’homme révolté du monde moderne ne rend de compte qu’à un programme, à une idée, à ses semblables : l’homme de foi rend des compte à Dieu, à la vérité et à tous les autres hommes, morts comme à vivre. Si le révolté échoue, il recommencera, inlassablement, à travers l’Histoire : chaque échec de l’homme de foi est une âme perdue de plus, un mort trop tard. « Le Maître que nous servons ne juge pas notre vie seulement – il la partage, il l’assume. Nous aurions beaucoup moins de peine à contenter un Dieu géomètre et moraliste ». La Révolution a tout son temps ; les jours avant l’avènement du Christ, eux, sont comptés. « La personne humaine aura été lentement rongée, comme une poutre par ces champignons invisibles qui, en quelques semaines, font d’une pièce de chêne une matière spongieuse que le doigt crève sans effort. Et le moraliste discutera des passions, l’homme d’État multipliera les gendarmes et les fonctionnaires, l’éducateur rédigera des programmes -on gaspillera des trésors pour travailler inutilement une pâte désormais sans levain. »
Par la narration la plus intime qui soit – celle de la confession quotidienne – des vérités sur l’homme jaillissent brutalement, qui valent à elles seules, dans l’éclat que le génie de Bernanos leur confère, des dizaines d’heures de prédication religieuse pleines de correction mais sans âme. En nous plongeant par la force dans les ténèbres du destin humain, et en nous faisant entendre l’écho assourdissant de la voix de Dieu qui résonne sans qu’on l’entende depuis des siècles, le Journal d’un curé de campagne est incontestablement l’une des plus remarquables réalisations de l’esprit littéraire français – et sans doute l’un des plus touchants et des plus puissants romans chrétiens du siècle dernier.
Sur ce, je vous laisse découvrir ce roman génial, et contempteur de nos vices ( humains, bien trop humains, comme dirait l' autre... ). Lisez Bernanos, et lisez ce livre ! Il vous rappelle notre profonde inhumanité ( même inconsciente... ). Tcho. La lecture est une urgence de notre société vouée à la technique, et au matériel. C' est à dire à la destruction de toute espèce d' humanité, en chacun de nous. @+.