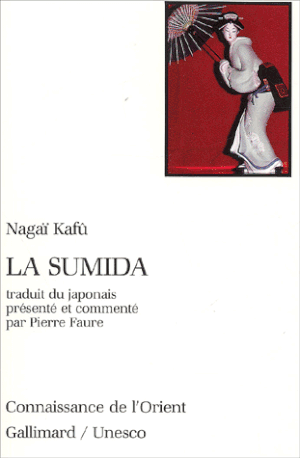Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2019/04/la-sumida-de-nagai-kafu.html
Je me suis rendu compte, bien tardivement, qu’il y avait comme un « trou » dans mes lectures en littérature japonaise : d’une part, je me suis intéressé à quelques classiques, notamment des époques de Heian et de Kamakura, un peu moins de Muromachi et d’Azuchi-Momoyama ou Sengoku, puis à nouveau un peu plus d’Edo ; d’autre part, concernant la littérature contemporaine, je me suis focalisé sur les ères Taishô puis Shôwa. Mais, entre les deux, il y avait l’époque du grand bouleversement, celle de Meiji – et, bizarrement ou pas, je n’en avais pas pratiqué un seul auteur à vue de nez… Chose d’autant plus fâcheuse qu’un Sôseki, tout spécialement, semblait être le maître, la référence indépassable, de nombre des auteurs qui suivraient – des écrivains majeurs comme Akutagawa Ryûnosuke, Tanizaki Jun’ichirô ou Uchida Hyakken.
Et, pas forcément très consciemment d’ailleurs, mes dernières lectures en la matière semblent avoir pour objet de remédier à cette lacune : je me suis ainsi récemment intéressé à la poésie de Meiji, et, si les Cent Sept Haiku de Shiki m’ont hélas laissé aussi perplexe qu’à peu près toutes mes tentatives dans ce registre poétique, au point que je ne me sentais absolument pas de chroniquer ce petit ouvrage, n’ayant rien à en dire, je me suis en revanche lancé dans les Cheveux emmêlés de Yosano Akiko, et, cette fois, ça me parle bien davantage ! Et, peut-être surtout, en matière de fictions, je me suis enfin attelé à Sôseki, avec Je suis un chat (roman séminal que je ne « connaissais » jusqu’alors qu’au travers d’une adaptation en manga un peu médiocre), une lecture qui en appellera sans doute beaucoup d’autres (comme Le Pauvre Cœur des hommes, notamment).
Ceci étant, si Sôseki était bien le grand romancier de (la fin de l’ère) Meiji, il y en avait quelques autres – dont Nagai Kafû, celui dont je vais vous causer aujourd’hui. Kafû, à première vue, est bien représentatif des écrivains japonais de cette génération et de la suivante, en ce qu’il vit un véritable déchirement lié à la modernisation et à l’occidentalisation à marche forcée du Japon sous Meiji. Il s’intéresse à la culture occidentale, et notamment au naturalisme français, qu’il découvre avec Zola, lequel le fascine – pas autant cependant que Maupassant qu’il découvre un peu plus tard ; aussi Kafû est-il une figure du naturalisme japonais, lequel cependant s’est considérablement éloigné du modèle français, très vite, au point que les rapports entre les deux courants pouvaient au fond paraître limités (notamment en ce que le naturalisme japonais, à ce que j’ai compris, accordait une place centrale à l’expérience subjective, et, j’imagine, entretenait de la sorte des liens marqués avec le courant du « roman du moi », ou watakushi-shôsetsu, à la Dazai Osamu). Mais l’expérience occidentale de Kafû ne s’en est pas tenue aux livres : un peu contraint et forcé par son père, désireux d’en faire un homme d’affaires, Kafû a fait un assez long séjour aux États-Unis, prolongé en France – guère fructueux au plan professionnel, mais déterminant dans l’appréhension de la vie pour le futur auteur ; La Sumida, d’ailleurs, a été écrit rapidement après le retour au Japon de Kafû.
Mais c’est justement un texte qui témoigne combien modernisation et occidentalisation peinaient l’auteur, voire l’irritaient : son goût pour les naturalistes français était une chose, mais il admirait avant tout le Japon traditionnel d’Edo et sa culture, notamment telle qu’elle s’était développée dans le « bas peuple » ; ce qui pouvait, d’une certaine manière, l’inscrire je suppose dans la filiation d’un Saikaku (et les deux auteurs, après tout, même avec deux siècles d’écart, ont beaucoup écrit sur les « quartiers de plaisir », le monde des prostituées et des geishas, des œuvres de divertissement jugées « populaires »), mais surtout, de manière plus franche, dans celle des auteurs de « romans sentimentaux » de la fin d’Edo, très décriés comme archaïques et « faux » du vivant de Kafû, mais auxquels il a toujours conservé son affection. Cependant, La Sumida témoigne de ce que l’auteur prisait aussi les haïkus ainsi que le théâtre d’Edo, notamment le kabuki, ou encore les estampes de la même époque, qu’on jugeait souvent encore « vulgaires » dans le Japon de Meiji du vivant de Kafû, alors même qu’elles fascinaient l’Occident.
Ce qui navrait Kafû, c’était la disparition brutale de toute cette culture japonaise, écrasée en masse sous le rouleau compresseur de l’occidentalisation. On aurait cependant tort de reléguer Kafû à l’archétype d’un conservateur acharné, voire réactionnaire, sans même aller jusqu’à parler de xénophobie – et son goût de la tradition japonaise s’accommodait très bien d’une attitude plus progressiste en matière de libertés individuelles, notamment : Kafû n’était pas moins farouche à défendre la notion d’individu et celle de son autonomie. Et c’est pourquoi, amoureux du Japon traditionnel, défenseur militant de sa culture, Kafû a cependant eu le bon goût de ne jamais se compromettre, dans les années qui suivraient, avec les nationalistes et le régime militaire qui emporteraient le Japon, après la brève « démocratie de Taishô », dans la catastrophique et sanguinaire aventure impérialiste que l’on sait – mieux, il a fait d’une certaine manière œuvre de rébellion en continuant à écrire à cette époque, en faisant fi des injonctions patriotiques du régime, et tous les grands (et moins grands) écrivains japonais de ce temps ne peuvent pas en dire autant.
Si La Sumida n’est pas le premier écrit de Kafû, qui avait déjà livré des œuvres sentimentales à la mode d’Edo (jugées très défavorablement par le traducteur et commentateur Pierre Faure dans un avant-propos qui ne prend pas vraiment des pincettes à cet égard), ainsi que des « souvenirs » de ses séjours aux États-Unis puis en France. Mais ce court texte (très court – à la limite plus une nouvelle ou novella qu’un roman) est celui qui a commencé à le faire connaître. L’influence du naturalisme français parcourt La Sumida, mais, déjà, il y a effectivement cette dimension subjective, ou peut-être intersubjective en l'espèce, qui singularise le naturalisme japonais.
Or c’est un « roman » sans véritable histoire. Il y a bien un soupçon de vague intrigue, mais, clairement, c’est là une dimension très secondaire de ce texte – ce qui importe bien davantage, c’est le regard porté par les personnages sur leur environnement changeant. Le texte s’ouvre sur la figure de Shôfûan Ragetsu, un haïkiste vieillissant, que son mode de vie passablement libertin a éloigné de sa famille ; il entretient cependant toujours des relations avec sa sœur cadette O-Toyo, qui a elle aussi un côté « artiste », puisqu’elle enseigne le chant et la musique associés au jôruri et au kabuki, mais elle entend pourtant faire de son fils Chôkichi, 17 ans, un homme « bien », beaucoup moins bohème, quelqu’un qui aurait un travail « normal » et rémunérateur. Chôkichi, pourtant, n’en veut pas – et, assistant à une représentation de kabuki, il réalise qu’il préférerait bien davantage devenir comédien… et il faut relever ici qu’il y a beaucoup de l’auteur dans ce personnage, de manière assez transparente (le « vrai » nom de Nagai Kafû était Nagai Sôkichi). Mais le jeune homme est dans une mauvaise passe – il a d’autant moins envie de s’impliquer dans ses études qu’il est très affecté par le sort de son amie d’enfance et plus ou moins amoureuse O-Ito, qui va devenir geisha, et qui s’éloigne de plus en plus de lui… O-Toyo perçoit bien la détresse de son fils, mais ses idées quant à son avenir demeurent bien arrêtées – et quand elle fait appel à son frère Shôfûan Ragetsu pour raisonner le jeune homme, le vieux libertin fait l’hypocrite, prônant la sagesse et le pragmatisme, et il en est tristement conscient…
Le récit tourne autour de ces quatre personnages, et il n’y a pas grand-chose de plus à en dire : si « intrigue » il y a, elle se concentre probablement sur le personnage de Chôkichi, mais, d’un chapitre à l’autre, nous changeons sans cesse de point de vue ; à vrai dire, quand on lit le premier chapitre, on est tenté de croire que Shôfûan Ragetsu sera le héros de cette histoire, ou du moins le principal personnage point de vue – et ça n’est absolument pas le cas : Chôkichi prend probablement davantage de place, mais O-Toyo est aussi impliquée (il me semble en revanche qu’O-Ito n’est envisagée qu’extérieurement).
Mais « l’intrigue » est donc secondaire – et peut-être même, d’une certaine manière, les personnages, si leur point de vue est essentiel. Il ne se passe au fond pas grand-chose dans ce « roman », qui n’a rien d’ennuyeux pour autant. Quand, en guise de postface, Kafû livre une « Fantaisie » rapportant comment l'histoire aurait pu se poursuivre, il y a peut-être encore comme une ambiguïté quant aux intentions exactes de l'auteur, mais ce « plan d’une suite », au fond, confirme avant toute chose, et par l'absurde, presque, que la suite n'était pas nécessaire, et que Kafû avait bien fait d'arrêter son roman là où il l'a fait, pour en sublimer les principes.
C’est que, ce qui compte vraiment, c’est le décor. Les personnages déambulent sans cesse, et la plupart du temps sur les rives de la Sumida, un court d’eau tokyoïte d’une vingtaine de kilomètres à peine. Quand, quelques décennies plus tôt, la ville s’appelait encore Edo, les quartiers baignés par la Sumida étaient représentatifs d’une ville basse « populaire », en même temps célébrée par des artistes de toute sorte, qui y singularisaient des « paysages », des endroits notables, magnifiés dans des estampes, des poèmes, éventuellement des sortes de « guides touristiques » mais avec quelque prétention littéraire – ou tout cela à la fois. Mais, quand Kafû écrit La Sumida, en 1909, tout cela relève déjà du passé : les quartiers changent, le vieil Edo disparaît, ou même a d’ores et déjà disparu, sous les coups de boutoir de la modernisation et notamment de l’industrialisation – les « points de vue », si j’ose dire, célébrés par les poètes et les peintres, cèdent la place à la morosité grisâtre d’un Japon qui sacrifie volontairement et délibérément son essence à l’autel du progrès économique et technologique dans ce qu’il a de plus brutal et barbare.
Ce sont des quartiers que les personnages, tout au long de leur vie, ont parcouru en long et en large ; et, de toute évidence, Kafû s’est beaucoup promené le long de la Sumida. C’est donc ce que font ses personnages : ils se promènent, regardent le monde autour d’eux, et ne le reconnaissent plus – soit que, comme Shôfûan Ragetsu, ils soient suffisamment vieux pour percevoir, et douloureusement, combien leur environnement a changé, soit que, plus jeunes, ils perçoivent dans les transformations rapides de ce décor, presque en temps réel, comme un écho objectif de leur vie intérieure torturée, de leurs angoisses quant à ce qu’ils étaient eux-mêmes et sont supposés devenir.
Dès lors, le cœur de La Sumida réside dans de longues descriptions, très raffinées, très précises, mais toujours biaisées par le regard à chaque fois différent des personnages qui se promènent. La vision de Shôfûan Ragetsu, ainsi, est imprégnée d’une profonde mélancolie, de nature nostalgique, mais le vieux libertin, qui a longtemps posé au nihiliste ou peu s’en faut, ne peut même à son grand âge se départir d’une certaine tendance à rire de tout – la tristesse l’emporte, mais le regard a en même temps quelque chose d’un peu amusé, si douloureusement. O-Toyo, comme son poète de frère aîné, a vécu les transformations des quartiers bordés par la Sumida, mais son regard, phagocyté par l’inquiétude qu’elle éprouve quant à l’avenir de son fils, est probablement davantage pragmatique. Enfin, ledit fils, Chôkichi, arpente les rives de la Sumida en étant perpétuellement préoccupé par le constat de ce que son propre passé, subjectif, le fuit en la personne d’O-Ito, en même temps qu'un inquiétant avenir se dessine pour lui malgré qu'il en ait, aussi douloureusement grisâtre et fade que le décor dans lequel il évolue – or sans doute perçoit-il bien qu’il n’en a pas toujours été ainsi, et il est sans doute révélateur qu’il cherche à se réfugier dans le théâtre, prosaïquement comme idéalement.
La plume de Kafû est très belle, raffinée, mais aussi subtile – il n’y a rien ici des réjouissants excès baroques que j’avais relevés dans Le Pied de Fumiko de Tanizaki Jun’ichirô, mettons. Tout cela est à la fois élégant et sensible, et une insidieuse douleur, légère mais indéniablement présente, parcourt les rêveries moroses de ces promeneurs solitaires, ou de ces hommes (et femmes) qui marchent, comme vous préférerez. Du moins est-ce le sentiment que procure la belle traduction de Pierre Faure : bien sûr, je ne peux pas me référer ici au texte japonais, mais la version française est assurément touchante en même temps que bien tournée.
Ceci étant, on en arrive au problème que m’a posé ce livre : sa délicatesse et sa beauté doivent visiblement beaucoup à ce que Kafû joue des références et des associations d’idées presque instinctives pour ses lecteurs japonais, dans les décors qu’il décrit, les poèmes et les estampes auxquels il fait allusion, etc. Ceci, un lecteur français lambda tel que votre serviteur n’est tout simplement pas en mesure de l’apprécier sans une aide extérieure. Cette aide, le traducteur et commentateur Pierre Faure la fournit volontiers, mais (outre quelques planches de cartes et de peintures, la belle idée que voilà) cela implique de passer par de nombreuses notes, et par un long commentaire en fin de volume (une trentaine de pages), passablement pointu, et probablement bien trop pour ma pomme. Il y a là quelque chose de frustrant, parce qu’on perçoit que le ressenti suscité par ce livre devrait être bien davantage instinctif pour être pleinement apprécié... Le recours à l’appareil critique instruit, mais n’émeut pas ; et la conviction n’en est que plus forte, pour ce lecteur français lambda, de passer à côté de bien trop de choses, et probablement de l’essentiel… C’est une limite que j’ai pleinement ressenti, qui ne tient donc pas forcément au texte lui-même, à sa qualité ou à celle de sa traduction, mais au constat de ce que ce livre ne peut pleinement parler qu’à des Japonais – le propos pourrait éventuellement paraître universel, on a sans doute écrit des centaines de milliers de livres sur le monde qui change, mais l’ancrage dans le Japon de Meiji est en fait tel que c’est en définitive la singularité culturelle qui l’emporte, et largement.
J’ajouterai une chose, mais beaucoup plus subjective : si je peux (plus ou moins) comprendre le ressenti de Kafû, si j’ai apprécié la finesse de ses descriptions, leur dimension élégamment sensible, si j’ai pu, même, revivre douloureusement mon passé en m’identifiant au personnage de Chôkichi, en même temps que je percevais en moi comme la possibilité d’un Shôfûan Ragetsu désormais trop vieux pour se montrer honnête dans ses conseils au jeune homme, il demeure que, idéologiquement, je me sens aux antipodes de l’auteur et de son propos. Disons-le, j’éprouve une méfiance instinctive et viscérale pour le sentiment nostalgique – qui vire régulièrement à l’hostilité quand on me vante les traditions pour la seule raison qu’elles sont des traditions ; aussi subtil soit le « roman » de Kafû, incomparablement plus que tant d’éloges creux du passé pour le passé qu’on nous sert comme autant de profondes et essentielles vérités, il avait donc dans sa note d'intention même quelque chose qui m’était fondamentalement suspect. Mais ceci est donc très personnel, et ne saurait véritablement constituer une critique de La Sumida…
J’ai apprécié ma lecture – le jeu des points de vue, la délicatesse des descriptions, la douleur insidieuse qui s’empare des personnages, la très belle plume de Kafû et/ou de son traducteur Pierre Faure. Mais un certain nombre d’obstacles m’ont donc empêché d’apprécier La Sumida autant qu’elle devrait l’être. Ce qui constitue une certaine déception, je suppose, même si plus « dérivée » qu’autre chose…