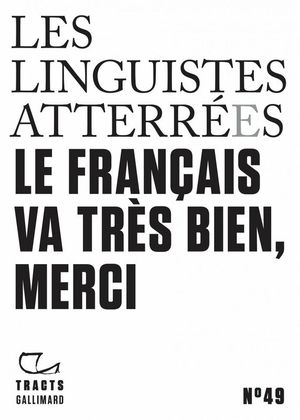Ce pamphlet propose une mise au point intéressante et bien documentée sur ce qu’est la linguistique, mais, en raison de son caractère très polémique, ne m’a pas tout à fait convaincu de la validité de ce que le titre affirme (à savoir que le français va très bien).
L’essai critique avec à propos des clichés répandus sur le français et la linguistique, en se fondant sur des citations d’idéologues réactionnaires, tels Finkielkraut ou Camus. Soit, mais quel est l’intérêt de la chose ? Il est évident pour qui s’intéresse un peu à la langue, à son fonctionnement et son évolution que ces imprécateurs, fussent-ils académiciens, n’ont pas mené une vraie réflexion sur le français mais se sont seulement servis de clichés sur l’appauvrissement sur la langue pour développer leurs rances diatribes sur la décadence supposée de la France et la civilisation occidentale. Or, à combattre de tels épouvantails, non seulement on ne convaincra personne qui pense que l’écriture inclusive annonce la fin des temps (je doute même qu’une telle personne lise ce pamphlet), mais on s’empêche de mener une réflexion plus nuancée car moins manichéenne.
Mais le principal problème, et ce qui m’a le plus gêné dans cet ouvrage lu avec le point de vue d’un professeur de français est la façon dont il minimise souvent l’importance de la norme dans la langue française, jusqu’à parfois presque la nier. Ainsi le premier chapitre rappelle-t-il que la langue est soumise à une évolution constante, et critique-t-il l’expression « la langue de Molière ». Soulignons ici la mauvaise foi des « Linguistes atteré·e·s » : en utilisant cette expression, personne ne souhaiterait qu’on s’exprimât comme les précieuses ridicules ! Mais, de façon plus significative, en insistant sur l’évolution de la langue, et même l’évolution de la norme, on en vient presque à nier l’existence de la norme. Les linguistes qui ont écrit de cet essai font bien de rappeler que leur travail consiste à étudier les usages de la langue, sans les hiérarchiser, et que les normes qu’ils en tirent sont descriptives et non prescriptives. Mais c’est oublier que malgré des évolutions notables, le français a une forme relativement stable et uniforme depuis que sa transmission n’a plus seulement été principalement orale, qu’une norme s’est imposée, surtout à l’écrit, et que c’est un attendu social (mais pas de la linguistique, certes) qu’elle soit respectée. Tout le monde sait ce qu’il arrive aux lettres de candidatures truffées de fautes… J’irais même plus loin : en linguistique, tous les discours se valent (p. 46 : « Là où les puristes blâment le barbarisme, la faute ou le « mauvais » français, les linguistes observent des variations ») ; dans la vraie vie, ce n’est pas le cas, et une maîtrise correcte de normes habituelles est souvent un bon moyen de distinguer, dans la masse de discours écrits et parlés, ce qui mérite notre attention ou non.
Il est vrai, et le livre nous y invite, que la qualité d’un propos ne correspond pas au respect scrupuleux de toutes les règles. Mais une fois encore, les auteurs cherchent à minimiser l’importance de la norme en se concentrant sur les anomalies de l’orthographe et en négligeant presque complètement la grammaire. Certes, il importe peu qu’on écrive nénuphar ou nénufar, mais la non-maîtrise, malheureusement si fréquente dans les travaux de mes élèves, des règles essentielles de grammaire et de syntaxe est, dans une certaine mesure, le reflet d’une difficulté à structurer leur pensée, et empêche souvent une réelle communication. Si l’on ajoute à cela le manque abyssal de vocabulaire, on a du mal à partager l’optimisme des auteurs : il est possible que le français aille bien, merci, il n’en est pas moins vrai qu’un nombre important de locuteurs est incapable de comprendre ou produire un énoncé écrit simple, et cela n’est jamais abordé dans l’essai. Dans cette critique de la survalorisation de l’orthographe, les auteurs s’en prennent au retour en grâce de la dictée, en s’appuyant sur Jules Ferry critiquant la place disproportionnée que prenait à son époque la dictée, centrée sur « les vétilles de l’orthographe ». Mais c’est très loin de la pratique actuelle de la dictée. Croyez-moi, les enseignants seraient heureux s’ils avaient le temps d’aborder ces vétilles-là !
Il conviendrait, nous suggèrent cependant les auteurs, de ne pas hiérarchiser les emplois de la langue, et accorder autant de valeur au français oral plus relâché. Et si tous les hommes se donnaient la main, le monde serait meilleur… Plus sérieusement, ou pas, les auteurs affirment même une certaine prééminence de la langue orale, que suivrait ensuite l’écrit avec ses règles ad hoc, et s’appuient notamment sur le fait que l’apprentissage de la langue est d’abord oral, puis écrit. Quelle belle prééminence que celle qu’apporte le galimatias d’enfants en maternelle ! Les auteurs recommandent aussi, pour simplifier l’orthographe, que soit mieux appliquée la réforme de l’orthographe de 1990. Je n’ai rien contre cela, d’autant plus que c’est conforme aux instructions du ministère de l’Éducation nationale. Mais j’avoue que je ne la maîtrise pas tout à fait, car les éditeurs ont conservé le plus souvent l’orthographe traditionnelle. J’ai donc été surpris, en lisant cet essai, de trouver la forme « elle renouvèle ». Pourquoi pas ? Mais je me demande où est la simplification quand un enfant doit apprendre qu’on écrit « une nouvelle » mais « elle renouvèle » ?
D’ailleurs, je me permets un aparté : j’aime qu’à travers les bizarreries orthographiques du français on devine l’étymologie des mots (et parfois même leur étymologie fantaisiste !). Cela leur ajoute une profondeur. Je me fous absolument ce que ça complique le langage courant : si les conversations ordinaires avaient de l’intérêt, on ne lirait pas de livre. Ce qui fait l’intérêt d’une langue, c’est sa littérature, et c’est ce qui fait qu’à mes yeux, clé et clef, par exemple, ne sont pas tout à fait interchangeables.
Enfin, pour revenir sur ce qui me semble constituer un déni de la norme, ses auteurs, pour montrer, dans un chapitre dans l’ensemble convaincant, que les anglicismes ne menacent pas le français, parlent de la cohabitation naturelle et harmonieuse entre le français et de l’anglais au Québec, et mettent en avant les néologismes heureux qui y ont été forgés. Mais c'est omettre que cette cohabitation n'est pas complètement naturelle, mais qu'elle est déterminée, encore une fois, par des normes, cette fois-ci légales, qui imposent, on le sait, que soient évités les anglicismes et que soient traduits les titres de tous les films. L'enrichissement de la langue n'est pas toujours le résultat d'un processus naturel et inconscient, il est aussi le résultat de décisions politiques.
Pour conclure, il y a dans cet essai des choses très intéressantes, des mises au point pertinentes et qui changent des cris d'orfraie médiatiques et peuvent contribuer au débat sans cesse renouvelé sur notre langue. Mais plus qu'une défense et illustration de la langue française, il s'agit d'une description de l'objet de la linguistique. De plus, en s'attaquant à des moulins à vent (car qui affirme sérieusement, comme le prétend cet essai, que les usages du Québec ou de l'Afrique francophone, abâtardissent le français ?), il se montre parfois utilement polémique, au risque de trop simplifier et de ne pas aborder des questions bien plus pressantes.