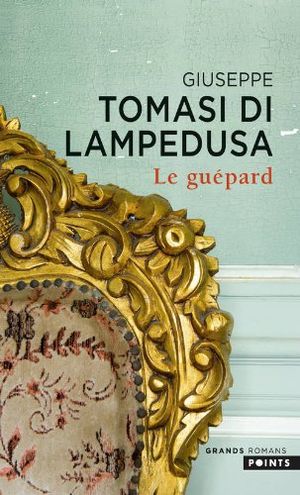Quand les pages du livre le font apparaître, le Guépard danse, toujours, jusqu'à l'absurde. À la porte d'une ferme, sur des carreaux de mosaïque, aux façades baroques de Donnafugata, surmontant les fontaines, frappant les voûtes du Monastère du Saint-Esprit, tranchant l'azur des vieux écussons, le Guépard clopine sa vieille mazurka, répand l'écho des siècles avec une exaspérante désinvolture. De toutes choses inanimées il a fait son royaume glorieux, son Olympe palermitain. Il joue des hanches, vibre, rehausse d'un élan mystérieux les vieilleries rococo flanquées de sa silhouette, imprime le souvenir d'un passé vivant. Il largue aussi dans sa valse éternelle une aristocratie fatiguée, brise par le train de sa course interminable les reins du dernier des Salina. Le Guépard habite d'autant les choses qu'il déserte les vivants. Il est le signe d'une époque agonisante, l'âme d'un vieux lignage sicilien qui rompt son antique continuité. Redevenant poussière de ses origines, il est au diapason de l'île qui l'a vu naître, omniprésente poussière rejouant ad vitam aeternam les noces tragiques qui la lient au char du soleil implacable. S'il est « des lieux où souffle l'esprit » comme l'écrivait Maurice Barrès, l'or des plaines saliniennes ondule sous les chaudes haleines du Guépard expirant.
Le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le seul de sa vie, est un roman des fins dernières. La fin d'un monde surtout, pour reprendre une formule consacrée, celui de la féodalité sicilienne que l'embrasement des révolutions européennes a réduite en cendres. Au-dessus du tas fumant, de faibles volutes évoquent encore le souvenir lointain des oliviers de Cyrène, des cris de Proserpine, des bains de Cefalà, du rite byzantin, celui encore des bâtisseurs normands et de Frédéric sous le chambranle de la Martorana se frappant la poitrine. Autant de lambeaux éparses qui composent à la Sicile un visage greffé de « magnifiques civilisations hétérogènes, toutes venues de l'extérieur, déjà complètes et perfectionnées ». Un cycle immuable de renouvellements qui a vu chacune de ces civilisations se substituer les unes aux autres puis s'interpénétrer, et dont le Risorgimento déferlant sur la vieille Monarchie des Bourbons n'est qu'une énième et banale manifestation. Le conservatisme aristocratique cède au libéralisme bourgeois, les troupes de François II aux chemises rouges de Garibaldi, la vieille souche de Palerme au pachydermique agioteur de Piémont, l'aristocrate dépouillé à l'arrivisme cupide du roturier propriétaire. Là se noue le grand malentendu qui a poussé l'intelligentsia italienne des années 1960 à voir dans Le Guépard la vulgaire apologie d'un ordre ancien, la nostalgie réactionnaire d'un glorieux passé monarchique, à la manière d'un Pierre Gaxotte opposant à l'âge d'or du Siècle de Louis XV l'anarchie satanique du jacobinisme révolutionnaire.
Rien de plus faux concernant le chef d’œuvre intemporel de Tomasi di Lampedusa, qui ne réduit pas la mélancolie de Don Fabrizio à la perte de ses privilèges, au morcellement de son domaine princier ou au déclassement que l'Italie réunifiée scelle sous la bannière des bourgeoisies triomphantes. C'est à l'agitation vaine des hommes et leurs médiocres aspirations qu'il réserve ses grasses volées de bois vert, non aux régimes politiques qu'ils se choisissent, dussent-ils pour s'imposer, passer par des révolutions violentes qu'un cynisme général renvoie à la farce des comices d'Auguste. Signe du soufflet qu'il adresse à la vogue démocratique, Don Fabrizio raille en permanence les grands événements de son temps en les projetant vertement sur ceux qui s'en réclament avec grandiloquence, comme pour les rendre plus insignifiants qu'ils ne sont réellement. Ainsi de la Révolution qu'il « [contemple] en personne dans ce nœud-papillon blanc et cette queue-de-pie noire qui montaient ses escaliers », ce Sedara en frac, méprisé, dont les manières ankylosées, l'obsession quotidienne pour les cours du blé font plus sûrement basculer le monde que tous les débarquements de Marsala. La gente patricienne n'est guère plus ménagée, qui offre le spectacle carnavalesque de sa ruine accélérée dans cette époque de bouleversements politiques. Ainsi des jeunes nobles de Ponteleone dont les riches parures ne suffisent pas à dissiper cette hallucination qui les meut en guenons hystériques, « Il s'attendait à les voir tout d'un coup grimper aux lustres et de là, suspendues par la queue, se balancer en exhibant leur derrière et en lançant des coquilles de noisettes, des cris et des grincements de dents sur les pacifiques visiteurs ». Ainsi enfin du brave Chevalley de Monterzuolo venu proposer à Don Fabrizio une place au nouveau Sénat d'Italie, que ce dernier renvoie sèchement dans ses pénates, opposant à la « très belle terre qui se présente au panorama du monde moderne » une « centenaire traînée en fauteuil roulant à l'Exposition Universelle de Londres, qui ne comprend rien, qui se fiche de tout ».
La désaffection de Don Fabrizio pour les hommes et pour son temps n'est pas liée à l'adoration d'un dogme politique. Elle n'est pas simplement le refus d'un progrès comme remède à toutes les arriérations culturelles de l'archaïque Sicile. Elle est le symptôme d'un sentiment plus profond qu'il a de sa caste et de son rapport particulier au temps, une altérité que le père Pirrone exprime admirablement lors de son retour au pays : « Vous savez, don Pietrino, les « nobles », comme vous dites, ne sont pas faciles à comprendre. Ils vivent dans un univers particulier qui n’a pas été créé directement par Dieu mais par eux‑mêmes, durant des siècles d’expériences très particulières, de soucis et de joies bien à eux ; ils possèdent une mémoire collective tout à fait solide et ils se troublent donc ou se réjouissent pour des choses qui ne nous intéressent en rien ni vous ni moi mais qui sont pour eux vitales car elles sont en rapport avec leur patrimoine de souvenirs, d’espoirs, de craintes de classe ». L'espoir de Don Fabrizio c'est sa conviction dans l'impossibilité du changement, dans l'immutabilité proverbiale du sicilien, cette fixité languissante que la cruelle beauté de sa terre lui jette dans l'âme comme une malédiction sans âge. C'est le perpétuel référent du prince, le seul appui solide qui lui permet de balayer les grands bouleversements de son époque, de s'y tenir en surplomb, puisque jamais aucun bouleversement d'aucune autre époque antérieure ne pût jamais entamer chez ses compatriotes « le désir d'immobilité voluptueuse ». Cette inertie métaphysique est d'après lui la raison pour laquelle aucune ère n'a jamais couronné l'île capricieuse, puisqu'elle fixe à la même intersection du temps historique le début et la fin de cette société profonde à laquelle il se sent appartenir, la source de l'odieuse perfection dont tout sicilien se pare dès sa naissance et qui lui fait dire dans un sublime accès de poésie : « notre aspect méditatif est celui du néant qui veut scruter les énigmes du nirvâna ».
Cet extraordinaire monologue qu'il tient au piémontais Chevalley de Monterzuolo, si souverain dans l'expression de la fracture irréductible entre la Sicile et le continent, Scylla et Charybde se regardant en chiens de faïence, tout cela tient d'une projection fantasmée, atavisme insulaire rêvé qui protège et rassure le prince quant à l'avenir des Salina sous un ciel nouveau. Elle s'accorde à cette passion pour l'astronomie qui lui attire une réputation d'excentrique autant que son sentiment d'homme accompli. Quoi de plus rassurant en effet que ces étoiles reproduisant indéfiniment un même schéma, celui d'un « visage triangulaire que son âme projetait dans les constellations quand elle était bouleversée » ? Leur caractère inaltérable est le reflet de ce tempérament sicilien que don Fabrizio cultive au plus profond de lui-même, et jamais il n'hésite à darder son regard d'acier vers le doux reflet de Sirius quand la nécessité de conjurer ses angoisses l'y incline. Les étoiles sont le gage d'un ordre stable, éternel, auquel va son unique allégeance, et qui lui font négliger les soubassements fragiles de l'ordre humain. Les palabres vaniteuses du colonel Pallavicino et ses exploits à l'Aspromonte auraient glissé sur la fourrure du Guépard s'il n'avait prophétisé les malheurs d'Italie par l'emploi d'une image trop pertinente : « Vous savez mieux que moi, prince, que même les étoiles fixes ne sont pas tout à fait fixes ». Ce n'est point la perspective d'un retour de la canaille mazziniste qui fit à ce moment là se serrer le cœur du prince, mais bien la perspective dramatique d'une mobilité possible des astres...