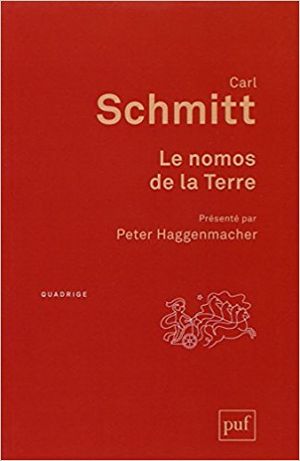Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Carl Schmitt, le sulfureux juriste allemand, s'interroge sur les causes du déferlement inédit de brutalité qui s'est abattu sur le monde, et en particulier sur son pays écrasé sous les bombes alliées jusqu'à la reddition sans conditions. De cette réflexion naît, en 1950, le Nomos de la Terre, un de ses textes majeurs.
Dans certains milieux intellectuels français, Carl Schmitt demeure une figure fondamentale, étudiée avec soin. C'est le grand pourfendeur des universalistes et autres néo-kantiens, celui qui a démasqué la perversité des bons et des généreux dont l'ordre mondial pacifié rêvé a conduit à brutaliser comme jamais les conflits au XXe siècle. Carl Schmitt ne croit pas en la viabilité d'un tel ordre mondial universel, transcendant les frontières et les particularismes. Au contraire, tout ordre du monde est, selon lui, ancré dans la terre, enraciné dans la géographie, c'est-à-dire concret.
En premier lieu, la terre féconde porte en elle-même, au sein de sa fécondité, une mesure intérieure. Car la fatigue et le labeur, les semailles et le labour que l’homme consacre à la terre féconde sont rétribués équitablement par la terre sous la forme d’une pousse et d’une récolte. Tout paysan connaît la mesure intérieure de cette justice.
Cette entrée en matière lyrique, dans une fièvre poético-tellurique bien germanique, constitue le point de départ à partir duquel doit s'arc-bouter l'ensemble de la démonstration de Schmitt. D'entrée de jeu, il pose les éléments de sa réflexion. Un ordre du monde, un nomos de la terre, est conçu depuis un regard subjectif qui sert de point central. Le monde s'organise autour de ce centre en cercles concentriques jusqu'à ses marges. Tout ceci détermine la conception politique de l'espace et, dans le même temps, le droit international ou le droit de la guerre. La conséquence majeure que Schmitt déduit de son schéma est que la guerre parvient à être régulée au centre d'un ordre du monde, mais uniquement parce qu'elle a, tacitement ou non, cours de façon illimitée à ses marges, où tout est pour ainsi dire permis. La brutalité de la guerre et la déchéance du droit de la guerre (appelé droit des gens d'après la vielle notion latine, jus gentium, ressortie des tréfonds de l'oubli par les juristes de la fin du Moyen Âge effarés par la brutalité des combattants à l'égard des civils) et du droit international au XXe siècle ne doit ainsi qu'à la confusion qui s'est progressivement imposée à mesure que cet ordre du monde enraciné est devenu universel, dépourvu de centre.
Partant de ce constat, Schmitt essaye de démontrer son affirmation en faisant l'histoire du droit de la guerre depuis l'Antiquité. Et c'est à ce moment-là que son raisonnement déraille... c'est-à-dire quand il essaye de le démontrer. Sa description de la conception du monde par les Anciens est fort juste et bien connue des historiens, et plus encore des historiens des religions. Cependant, il semble échapper à Schmitt que la discrimination entre un centre où la guerre est limitée et des marges où elle a lieu en-dehors de toutes normes n'existait pas. Les Romains, par exemple, se sont toujours appuyés sur un casus belli pour déclarer la guerre même aux barbares vivant au-delà du limes (à moins qu'un contre exemple échappe à ma mémoire). Ce n'est qu'au Moyen Âge que cette distinction apparaît, alors que se réalise cet ensemble qui a constitué le berceau de l'Europe : la Chrétienté. À cette époque, les efforts répétés du clergé et les logiques sociales internes à l'aristocratie féodale ont permis la concrétisation d'un vaste espace où la guerre était fortement limitée par des règles généralement respectées, qui garantissaient notamment la protection des civils et des prisonniers (quand ils étaient nobles, en tout cas). Au-delà du monde chrétien, une plus grande violence était (en théorie) permise, et le fait qu'un adversaire soit païen constituait déjà un casus belli en soi. Néanmoins, pour les hommes du Moyen Âge, le centre du monde était... Jérusalem, qui géographiquement était aux marges de la chrétienté, sinon au-dehors ! Carl Schmitt reproche en outre aux juristes médiévaux leur doctrine de la guerre juste. Mais il ne semble pas en avoir compris la nature et a voulu (curieusement) y voir un principe théologique où le juste se confond avec le bien, l'assimilant ainsi à la conception wilsonienne du droit international. La guerre juste était en fait une construction typiquement féodale où la guerre était conçue comme devant rétablir le bon droit bafoué par autrui ; elle servait ainsi de base juridique aux guerres féodales animées essentiellement par les querelles de succession.
De manière générale, Schmitt semble reprocher à l'ensemble des juristes successifs de ne pas avoir compris les principes de son fameux nomos de la terre supposé être l'essence immuable du droit international. À partir de la Chrétienté se forme l'Europe moderne aux XVIe-XVIIe siècles. C'est, pour Carl Schmitt, l'apogée du droit des gens européens, fondé sur le principe de réciprocité des États se reconnaissant, indépendamment de toute autorité jouant le rôle d'arbitre, comme pairs protégés par un droit commun. Cette réalisation a pleinement lieu, d'après lui, après la signature de la paix de Westphalie en 1648, qui met fin à la guerre de Trente Ans. Il y voit la forme de pacification de la guerre la plus aboutie en Europe, réduite à un « duel entre gentilshommes » (mais les guerres médiévales n'étaient-elles pas beaucoup moins meurtrières, pourtant ?) et, en fait, il semble que c'est à partir de ce schéma qu'il lit le reste de l'histoire européenne puis mondiale. Car, petit à petit, il décrit la disparition, par effet d'une confusion grandissante, d'un ordre du monde conçu en termes de centre et de marges. Avec la découverte du Nouveau Monde se distinguent désormais l'Europe civilisée et l'espace colonial sauvage, où la guerre a lieu sans limites. Puis la confusion commence à s'installer lorsque émergent les anciennes colonies devenues indépendantes, comme les États-Unis dotés de leur propre conception du monde (fondée sur la doctrine Monroe), et puis lorsque d'autres puissances non-européennes, comme le Japon, s'invitent de facto au monde civilisé. Finalement, la distinction entre espace civilisé et espace sauvage disparaît, et donc la discrimination entre centre et marges. On aboutit donc à la SDN puis à l'ONU, au traité de Versailles rendant l'Allemagne coupable d'agression et à la guerre d'extermination généralisée. Exit, donc, cette belle guerre limitée par le droit des gens.
Mais comment y parvient-on ? De quelle façon, exactement, cette évolution a-t-elle lieu ? Voilà un mystère auquel ce livre ne répond pas. Très rapidement, Schmitt s'embourbe dans une démonstration pénible, compliquée, scrutant tour à tour ouvrages de droit international méconnus et traités de paix obscurs. Il met en évidence des changements, l'introduction de nouveaux principes, tout ceci devant témoigner de la confusion progressive des esprits ayant oubliés le fameux nomos de la terre initial. Mais la logique historique, elle, reste la grande oubliée du livre. En fait, l'argumentation de Schmitt repose sur deux grandes idées qui sont mal (ou pas du tout) reliées entre elles, d'où la grande confusion du propos, en outre pénible et fastidieux :
- Le monde est conçu depuis un regard subjectif enraciné dans une géographie déterminée. La politique internationale d'une puissance est conçue en fonction de ce regard qui examine ses intérêts, ses menaces, ses zones d'influence etc.
- Une limitation de la guerre a été historiquement possible en discriminant un centre et des marges.
Ces deux postulats ne sont, en soi, pas faux. Mais Schmitt n'explique pas clairement ce qui les lie, au-delà du postulat non-démontré qu'il émet en introduction de son livre. Sa critique de l'universalisme qui, ayant remplacé cet ordre du monde concret enraciné dans la terre par un ordre du monde abstrait indéterminé, aurait conduit à la généralisation d'une guerre illimitée en devient extrêmement bancale, pour ne pas dire qu'elle rate probablement tous ses objectifs. Car ne peut-on pas concevoir une organisation internationale, comme l'ONU, servant d'arbitre tout en reconnaissant que chaque nation ait ses propres intérêts en fonction de sa propre conception de l'espace ? Pire encore, son argumentation sur la limitation de la guerre souffre d'un profond contresens.
Nous disions plus haut que la distinction entre guerre limitée au centre et guerre illimitée aux marges n'existait pas dans l'Antiquité et que c'est au Moyen Âge, avec la Chrétienté, qu'elle naît. En fait, cette conception existait aussi... en Islam, où le Dar al-Islam s'oppose au Dal al-Harb habité par les infidèles appelés à se convertir. Le principe est exactement le même dans la conception chrétienne du monde. Par exemple, la Conquista (la conquête des Amériques, pudiquement renommée ensuite « Grandes Découvertes » pour tâcher de faire oublier la légende noire espagnole) a été légalement légitimée par le fait que le Nouveau Monde était habité par des païens qu'il fallait convertir à la vraie foi. Cette conception du monde est, en fait, profondément universaliste. Si elle suppose une pacification active en son centre, c'est en vertu du principe que les hommes sont tous frères et parce que cette conception du monde est profondément animée par un désir d'atténuer la violence de l'homme. Et c'est même un espoir de pacification totale de l'humanité qui suppose, moins paradoxalement qu'il n'y paraît, la guerre illimitée chez les païens. Il faut convertir ces derniers afin de faire triompher la bonne religion, celle qui conduit les hommes à tous être frères et qui apportera la paix universelle. Oui, l'islam est une religion de paix... sauf pour les infidèles. L'idée est toujours la même lorsque la Chrétienté devient l'Europe civilisée aux XVIe-XVIIe siècles, changement de paradigme qui permet par ailleurs de conserver l'unité de cet espace européen malgré la division opérée par le protestantisme.
De fait, la nécessité de discriminer une guerre illimitée à l'extérieur et une guerre limitée au centre disparaît. Schmitt, d'ailleurs, explique la pacification du continent européen à l'époque moderne par le « défouloir » qu'aurait constitué l'espace colonial aux XVIe-XIXe siècles. Voilà bien la preuve que toute son analyse est en fait fondée sur ce modèle, qui sert de référence pour lire le reste de l'histoire, avant ou après. Car a-t-il existé un tel espace de défouloir au Moyen Âge ? Peut-être, pendant un temps très bref, la croisade a-t-elle permis de satisfaire les appétits aventureux et la soif guerrière des chevaliers chrétiens. Encore est-il vrai qu'une grande discipline était attendue des croisés et que, très rapidement, les relations entre les États latins et leurs voisins musulmans sont devenues des relations normales entre personnes civilisées, ce qui était d'ailleurs fortement reproché aux chrétiens d'orient accusés de faillir à leur tâche initiale. Aussi faudrait-il sans doute s'en tenir au mot de Philippe Contamine, grand historien de la guerre au Moyen Âge :
Ce n'est pas nécessairement faire preuve d'idéalisme ni d'irréalisme que de soutenir que la guerre n'est presque jamais voulue ni sentie ni pensée comme violence pure et illimitée, à l'état brut, élémentaire. Elle se trouve pour ainsi dire enveloppée (masquée aussi) par tout un appareil conceptuel ressortissant à la coutume, au droit, à la morale, à la religion — appareil destiné, dans son principe, à l'apprivoiser, à l'orienter, à la canaliser. En un mot, la guerre est un phénomène culturel.
Phénomène culturel qui a sa propre histoire. Mais cette dimension historique et culturelle se perd dans la structure imposée assez arbitrairement par Schmitt. Aussi ne semble-t-il pas comprendre qu'un homme de l'Antiquité ou du Moyen Âge n'ait pu ne pas voir ses adversaires par le prisme du droit uniquement, mais aussi par celui d'une coutume ou d'une morale qu'il n'imaginait pas limitées aux frontières de sa nation ou de sa religion. L'universalisme clairement conçu en tant que tel et, donc, son opposition conceptuelle avec, n'existaient pas. Un théoricien du droit à ces époques ne se posait pas nécessairement la question de savoir si le droit qu'il déterminait était limité dans un espace précis.
Les seules remarques intéressantes, et même hautement cruciales, de ce long et pénible ouvrage, mal écrit et confus, ne se retrouvent qu'à la toute fin. Oui, la guerre s'est brutalisée au XXe siècle. Et ceci a effectivement eu lieu parce que les belligérants se sont conçus comme défenseurs du Bien contre le Mal et que, en conséquence, leur adversaire pouvait être criminalisé. Le rapport au criminel est un rapport de toute puissance supposant une punition qui n'est régulée que par la puissance qui punit elle-même, là où un adversaire est un tiers protégé par le droit. Cet aspect des choses a été brillamment développé plus tard dans Théorie du Partisan, un texte court et clair, tout à l'opposé de celui-ci.