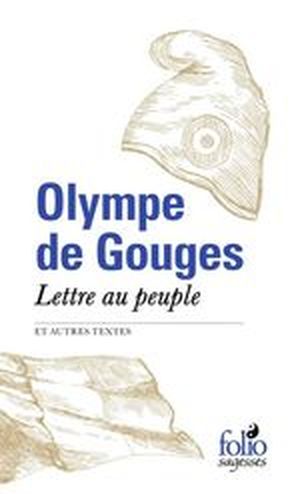Ces textes publiés par Olympe de Gouges entre 1788 et 1789, juste avant la Révolution française, n’ont pourtant rien de révolutionnaire, à plusieurs titres.
Tout d’abord, même si Olympe de Gouges est surtout connue pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, on ne retrouvera ici rien de féministe. D’ailleurs, quand elle imagine les premières sociétés dans Le Bonheur primitif et présente ces débuts de l’humanité comme un âge d’or, c’est une organisation patriarcale qu’elle décrit, où les femmes ne jouent qu’un rôle très secondaire.
De plus, Olympe de Gouges se montre sensible à l’atmosphère prérévolutionnaire de son époque, mais pour s’en inquiéter. Elle déplore la misère du peuple, reproche aux nobles leur obstruction, mais présente une éventuelle révolution comme une catastrophe épouvantable et purement destructrice, ne tarit pas d’éloges sur Louis XVI et ne cesse de rappeler qu’il ne faut pas que le peuple ait des aspirations qui ne conviennent pas à sa condition. Ainsi, toujours dans Le Bonheur primitif, elle affirme qu’une éducation trop soignée est préjudiciable aux élèves d’origine modeste, qu’elle n’en fait que des mauvais sujets, et qu’il vaudrait bien mieux qu’ils se contentent d’apprendre le métier de leur père ! (J’y vois aussi quelque chose de symptomatique de la psychologie de l’autrice, qui est la fille naturelle de l’écrivain Pompignan : si les talents sont en quelque sorte héréditaires, sa naissance illégitime lui confère une légitimité à appartenir au monde des lettres, alors qu’elle peine à se faire reconnaître comme autrice)
On peut considérer qu’elle n’a pas tout à fait tort de redouter les excès d’une révolution, mais on est loin de l’image de la pasionaria qu’on a parfois construite. Et les solutions qu’elles proposent frisent le ridicule : elle appelle les Français à un impôt volontaire ! Et elle explique que cela peut paraître étonnant mais correspond finalement bien à l’esprit français. On se pince… Et on a l’impression alors que tournent à vide tous les clichés de la rhétorique du XVIIIe siècle, mêlant enthousiasme démesuré et mièvre naïveté.
Enfin, quand elle s’essaie à la philosophie, là non plus, Olympe de Gouges n’offre rien de révolutionnaire. En effet, quand elle imagine les origines de la société dans Le Bonheur primitif, il s’agit clairement d’une variation sur la pensée rousseauiste. Mais alors que l’on sent chez Rousseau une profonde réflexion théorique derrière cette reconstitution des premiers temps de l’humanité, Olympe de Gouges semble développer une pensée assez superficielle et contradictoire. Cela se voit notamment dans la façon dont elle imagine comment la société a très rapidement dégénéré et perdu ce « bonheur primitif », sans pour autant renoncer totalement à sa confiance dans le progrès. On a donc une fantaisie rousseauiste, mais qui se refuse à admettre les conséquences des raisonnements de Rousseau.
Et il faut admettre que l’argumentation développée par l’autrice est souvent faible : la composition est lâche, et le raisonnement souvent confus, difficile à suivre, passant sans cesse du coq à l’âne. Ainsi en quelque lignes, on passe de la description de la société primitive à un règlement de compte personnel contre les comédiens du Français qui refusent de jouer ses pièces !
Cependant, et ce que montre bien cette querelle que je viens de mentionner, Olympe de Gouges écrit moins en théoricienne qu’en femme de théâtre : les reconstitutions philosophiques de Rousseau se transforment en scènes spectaculaires avec grands tableaux, coups de théâtre, effets scéniques impressionnants (elle décrit ainsi la panique des premiers hommes confrontés au spectacle de la première éclipse de soleil !), et tirades solennelles. C’est ce qui m’a intéressé dans ce livre : autrice très inégale, piètre esprit politique, médiocre théoricienne, Olympe de Gouges sait parfois déployer une certaine force d’évocation, et faire rêver à ces débuts de l’humanité.