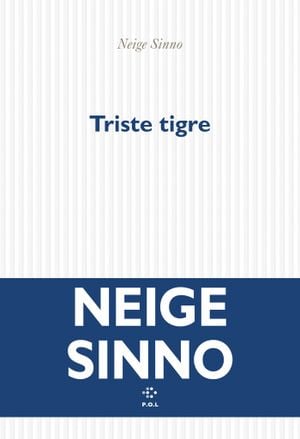Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tN2QHACn5jg&ab_channel=YasminaBehagle
De quoi ça parle ? C’est un livre assez curieux dans sa mouture, entre le témoignage et l’essai, où l’autrice revient (si on peut utiliser ce verbe dans le sens où l’on sent que ça ne l’a jamais quitté) sur l’inceste que lui a fait subir son beau-père dès l’âge de 7 ans.
Mon avis : Eh bien je dois dire que je suis agréablement surprise, c’est assez maladroit de le dire comme ça, mais c’est mon livre préféré dans le sous-genre du témoignage que représente l’inceste. Déjà, parce que justement, Neige Sinno est extrêmement consciente des enjeux du genre, et de ses écueils, mais aussi de la manière dont ils sont considérés ou déconsidérés.
Les adjectifs que la critique professionnelle ou amateure emploie pour ce type de texte apparaissent parfois dans Triste tigre, « La petite fille de sept ans de clavaire qui s’est enfin libérée de son fardeau en écrivant un poignant témoignage ? » et montre que la société, en tout cas c’est ce dont j’ai l’impression, même dans sa bienveillance, continue d’une certaine manière à vouloir cacher ces violences, ou les pousser hors de sa vue. En reléguant les autrices à ce sujet, en voulant à tout prix que l’écriture les soigne, c’est une manière aussi de leur dire, je ne vous accepte pas comme vous êtes, cabossés, non-aptes. C’est ce qu’il manquait dans les récits sur le sujet, de décrire ce que c’est exactement d’écrire sur l’inceste, le viol ou tout autre violence sexuelle. Le fait d’avoir peur d’être enfermée dans un rôle, la non-utilité de ce type de livre (« Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter quoi que ce soit aux victimes, aux proches de victimes, aux agresseurs ni même à ceux qui veulent mieux comprendre le sujet »), le fait que ça annihile le livre ou l’auteur derrière. Et donc une forme de refus de se soumettre à ça, tout en s’y soumettant.
D’un même mouvement, elle joue avec le voyeurisme du lecteur, elle nous concède quelque miettes, « Je peux néanmoins partager quelques anecdotes de nature plus ou moins sexuelle pour ne pas décevoir ceux qui considèrent que le sexe est un facteur déterminant et qui ont eu la patience de lire jusque-là ce petit mémoire ». et en lisant, face à l’effroi, on ressent aussi un peu de culpabilité. Je crois que c’est Angot qui soulignait il y a quelques années l’ambivalence du public face à ce type de livre et qui joue elle-même avec. Plutôt que les allusions, les ellipses ou tout autre procédé pour faire comprendre sans heurter, elles nous décrivent frontalement la matérialité de l’inceste, du viol. Mais là où Angot détaille sur des pages des scènes réalistes, Sinno, s’arrête, change de sujet, reprend un peu plus loin. Comme si elle concédait et refusait en même temps, comme si nous lecteur peut-être avide de scabreux, on était positionné à la place du beau-père agresseur, qu’elle se dérobe à nous, à notre entière attention.
Dans ce sens, elle reconnait la non-fiabilité de son témoignage, comme dans toute œuvre, même si c’est elle qui raconte. Et ainsi, je trouve que c’est peut-être en ça qu’elle arrive à faire fiction — puisque le matériau est corrosif, puisqu’en plus, il est possiblement abîmé par le temps, la mémoire, le traumatisme, elle est très prudente, mais se retrousse tout de même les manches, quitte à recoller ce qui ne tient pas forcément bien, à combler les trous et les manques avec des réflexions plus larges que son cas à elle.
Mais parfois, ça a pu me déranger, car elle écrit sous le patronage d’autres auteurs, et si c’est quelque chose que j’ai apprécié au début, surtout quand elle en tire des analyses fines (sur Lolita de Nabokov, par exemple), ça peut finir par faire un peu artificiel ou catalogue, avec de nombreuses citations non justifiées, uniquement pour appuyer son propos qui n’en a pas besoin parce qu’il est déjà très clair, très intéressant.
J’ai trouvé la fin, où elle explique qui est vraiment le triste tigre, non pas comme les journalistes l’ont l’ont écrit sans visiblement avoir lu le livre, le beau-père, mais elle-même, et par extension tous les enfants victimes d’inceste, puissant (je déteste ce terme galvaudé, mais j’ai pas d’autre mot pour décrire cette fin, on sent une force, pas un apaisement, ou de le sérénité, non, de la pure force). Alors que je trouvais que le mouvement Metoo s’était affadi lui-même par ses éléments de langage, son bégaiement sur la parole qui se libère, sur le fait de ne pas être seul, et que donc, comme tout slogan, ces mantras ont perdu de leur force évocatrice, Neige Sinno nous refait prendre conscience de ce que c’est, cette communauté de destins brisés, qui rien que par cette idée très simple, celle de connaitre quelque chose que 5 à 10 pour cent de la population connait, c’est sortir de l’hors-norme, du monstrueux. Ou plutôt que ce monstrueux, ce tigre ne condamne pas à rester agneau — que le tigre et l’agneau font partie du même monde, non pas dans une vision réconciliatrice du bourreau et de sa victime, mais d’une force vitale, je crois, que cette force qui a poussé l’agresseur peut quand même irriguer la vie de l’agressé, non pas à reproduire, mais à tirer de cette béance quelque chose. Pas par l’art, elle ne croit pas à la vertu thérapeutique de l’écriture ou ce genre de chose, (« Je ne crois pas à l’écriture comme thérapie. Et si ça existait, l’idée de me soigner par le livre me dégoute. »), mais une manière sensible d’être au monde. Et de possibilité de vivre avec, non pas de le dépasser, mais de vivre malgré ça, d’accomplir de grandes choses malgré ça, comme quand elle prend l’exemple de Claude Ponti — bien que ce soit de l’ordre de l’exceptionnel, que l’injustice c’est aussi ça, la personne victime d’inceste qui s’en sera le mieux sorti, sa seule récompense, ce sera juste de vivre comme n’importe qui, pas mieux, juste d’être fonctionnel.
Pour ce qui est du style, Neige Sinno a une voix qui résonne en moi, qui résonnera je pense en beaucoup de personnes, mais pour expliquer en quoi, je suis bien embêtée. Son écriture est fluide — ce terme est trop souvent employé à mon goût, mais ce que je veux dire, c’est qu’on le lit d’une traite, on est jamais dérangé par des maladresses, des alambiquages, les clichés ou autre. Mais par la même occasion, on s’arrête rarement devant une phrase, on se dit rarement, tiens j’y aurais pas pensé, je n’ai jamais lu ça — il y a le refus, comme pour Angot, de faire de beau style avec l’inceste, avec la violence et la destruction qu’il engendre. Je pense que ce livre pourrait rejoindre la longue liste de livres sur l’indicible, comme ce que je disais sur Toni Morrison ou Rouchon-Borie, car par sa forme même, y a quelque chose d’impossible, une forme fragmentaire qui reprend un peu la brisure totale de l’enfant détruit — l’impossibilité d’aller au bout de ses réflexions, et donc un roman comme un vase cassé, recollé de bric et de broc. Ça pourrait sonner comme un bémol, mais selon moi, c’est son originalité et sa force.