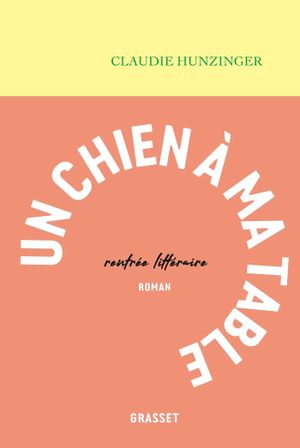Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TGkIXY0EfV4
De quoi ça parle ? La narratrice, double de l’autrice et son compagnon Grieg vivent en ermite aux Bois-Bannis, une maison entourée de nature, plus ou moins paisiblement jusqu’à ce que Yes, une jeune chienne victime de zoophilie, vienne gratter à leur porte. C’est un cri contre le monde tel qu’il est aujourd’hui, un cri contre les hommes, contre la mort.
Mon avis :
Assez partagée, et pour une fois, ce n’est pas à cause de l’écriture, mais au contraire d’une intrigue très relâchée, très distendue. Car le texte est bien écrit, poétique. Je pense que je l’ai lu de la mauvaise manière, c’est un livre qui devrait se lire comme un recueil de poésie, et non pas comme un roman, un livre où l’on s’arrête à chaque phrase pour la mâchouiller, qu’on referme, qu’on réouvre quelques jours plus tard.
I Un texte poétique
Hunziger s’inscrit dans la lignée d’autres poètes. J’ai retrouvé des affinités avec trois d’entre eux. Le roman s’ouvre sur une description de la nature environnante, pour se focaliser sur le colchique. Ce n’est pas un hasard, selon moi, puisque Les colchiques est un des poèmes les plus connus d’Apollinaire :
Le pré est vénéneux mais joli en automne
Les vaches y paissant
Lentement s’empoisonnent
Le colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne
Ce poème est mélancolique, lancinant, parle de l’empoisonnement que provoque l’amour.
Programmatique ?
Oui, le sous-texte crépusculaire est absolument présent chez Hunziger, fin de saison, fin de vie. Mais ici, on va plutôt s’intéresser à la thématique d’un féminin sacré, en symbiose avec la nature. Chez Apollinaire, on remarque l’association du corps de la femme, de ses yeux, à la fleur, plutôt péjorativement d’ailleurs, puisqu’accolée au poison, à la souffrance du poète. Cette association sera reprise par Hunziger, mais de manière décalée :
« Il m’avait fallu du temps pour relier l’apparition gazeuse de cette longue fleur mauve, menue, gracile et nue, vraiment nue, pas une feuille, une fleur éthérée, une fée, qui s’élève dans les prés en automne — bien observer les choses — pour la relier au bouquet de fleurs coriaces qui sortent au printemps suivant […] les fruits boursouflés de poison de la floraison de l’automne passé, grosses petites capsules vertes fabriquées sous terre, en secret, tout l’hiver, au fond du long tube mauve, émotif, lequel en réalité est son ovaire. »
Deux choses notables : déjà une hyperprécision, qui découle sans doute de l’observation d’Hunziger de chaque plante, une observation quasi scientifique, dans la dissection et le déroulement. Et ensuite, l’assimilation de la nature au genre féminin, comparaison à la fois physique, avec le côté charnu de la description, et psychique, avec les adjectifs qui relèvent des émotions. On note aussi l’apparition de la fée, figure de magicienne, de protectrice de la nature, divinité païenne passée avec le christianisme de la religion au folklore.
L'écrivain Michel Le Bris voit dans les fées « l'âme du monde », fabriquées par les humains pour habiter le réel et les rêves, mais surtout, des êtres intermédiaires entre le monde et l'humanité. Hunziger devient donc, en consultant la fée colchique, une sorte de druidesse elle-même qui consulte l’âme de la nature.
J’ai aussi remarqué une ressemblance avec Paul Celan dans ce passage : « à l’aube, l’aube blême, elle est vraiment effrayante parfois, l’aube, du lait noir, des dents gâtées, un goût de meurtre, il faisait presque encore nuit, et dans la nuit encore, avant de partir, j’allumais le feu. » On pense évidemment au poème Fugue de mort
Lait noir du petit jour nous le buvons le soir
nous le buvons midi et matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons une tombe dans les airs on y couche à son aise
C’est indubitablement l’apparition de l’image du « lait noir » qui crée un effet d’intertextualité avec Celan. Mais on peut aussi comparer l’anaphore « nous le buvons » chez Celan, « l’aube »chez Hunziger, qui produit une scansion quasi incantatoire, le cadre nocturne, sombre, où le lait, censé être synonyme de blancheur, d’innocence voire de maternité est vicié, goudronne la nuit, devient synonyme d’anéantissement. Le poème de Celan parlait de la Shoah, l’indicible d’exprimer la perte, perte qui imprègne pourtant tout. Je pense que chez Hunziger, cette perte, c’est celle du monde qu’elle a connu, il y a sans cesse un côté apocalyptique dans son roman, les Bois-Bannis comme vestige d’une humanité qui se perd.
Et enfin, à certains passages, j’ai retrouvé la simplicité et la grâce de Cécile Sauvage, les deux femmes partageant le même amour de la nature, de sa musicalité « J’ai cru que quelqu’un ronflait dans l’herbe. Je me suis penchée. J’ai tendu l’oreille. C’était un crapaud », dit Hunziger, quand à peu près cent ans plus tôt Sauvage écrivait :
« Langueur pure, douce harmonie
Des pelouses et des sentiers,
Les crapauds chantent dans ma vie
Avec leurs violons mouillés.
La figure du crapaud nous intéresse. En effet, alors que pendant l’antiquité, il était associé aux divinités primitives, comme les idoles féminines du néolithique et de l'âge du bronze, l’irruption du christianisme va renverser son image vers une créature complètement mauvaise, jusqu'à en faire un des animaux les plus associés au Diable. Par la suite, le crapaud accompagne tous les réprouvés de la chrétienté. Tout un imaginaire sera établi entre la sorcière et lui. Il devient ainsi symbole de la persécution des femmes, puisqu’en découvrir un auprès d’une femme soupçonnée d’être une sorcière prouverait ses liens avec le Diable.
Antispécisme et féminisme
On vient déjà de voir que certaines figures du folklore qui apparaissaient en filigrane dans le texte de Hunziger la liaient déjà au féminisme. On peut, comme son éditrice l’a fait, la définir comme éco-féministe. Quand on tape une définition de ce terme, on observe que le mot sorcière arrive en 4ème position dans la barre de recherche.
Une définition simple trouvée sur internet :
« L’écoféminisme c’est l’idée qu’il y a une connexion très étroite entre écologie et féminisme. L’exploitation et la destruction de l’environnement par les humains et l’oppression des femmes par les hommes sont les conséquences d’un même système. Pour les écoféministes, c’est une seule lutte qui prend deux formes différentes. »
C’est ainsi que l’antispécisme apparait à de très nombreuses reprises chez Hunziger, qui se manifeste par une extrême empathie avec l’animal, une empathie physique et douloureuse « L’année précédente, il avait été révélé que des chasseurs avaient descendu 128 sangliers en une seule battue […] je m’étais mise à gémir comme un sanglier rescapé de la tuerie qui aurait tout vu, caché dans les broussailles. »
Et c’est là que le roman pèche selon moi. Car Hunziger ne le met pas vraiment en scène, le côté autofictionnel donne d’ailleurs à son antispécisme et son féminisme un côté redondant (et avec ma dernière vidéo, j’en viens à me demander si le radotage n’est pas le principal défaut de l’autofiction, dans la mesure où suivre une personne plus qu’un personnage nous offre une vue plongeante sur ses obsessions et idées fixes)
Il y a donc un côté démonstratif et répétitif, on ne compte pas par exemple le nombre de fois qu’elle se dit écrivaine des marges, ou la dichotomie qu’elle trace entre le masculin et le féminin (par ailleurs, il reste encore à prouver que la bourgeoisie et le capitalisme est genré, je tendrais à penser qu’une femme, dès qu’elle accède aux mêmes postes de pouvoir qu’un homme fait les mêmes dégâts humains et écologiques). Elle divise l’écriture masculine et féminine, ce qui me parait non seulement manichéen, mais qui serait aussi assez maladroit venant d’un homme, (un auteur, je crois que c’est Knausgaard, disait qu’écrire pour un homme, c’est explorer sa féminité, et vice versa pour une femme, et je trouve que c’est plus intéressant comme conception). Bref, c’est dommage, parce que ça donne un côté grossier, mal moulé au texte qui était jusque-là ciselé :
« Morianne s’adressait à L.J. dont le domaine était l’autre pôle de la littérature française, le puissant, le dominant, le patriarcal, celui dont je m’étais depuis longtemps échappée ».
Elle passe à côté de la littérature à ce moment-là, car elle refuse de mettre cela en scène, comme si elle nous demandait de la croire sur parole, sauf que le personnage de l’écrivain ne réapparait pas, c’était juste un prétexte pour marquer des limites et montrer son féminisme. (et je trouve que pour quelqu’un des marges, elle aime bien en tracer). Ce qui est dommage, pour moi, parce qu’il faut toujours illustrer plutôt que dire les choses.
Pour l’antispécisme, c’est la même chose. Par exemple, à un autre passage, j’ai cru à un moment qu’on rentrait dans un propos ironique et subtil :
« Je me voyais bien aussi dans le corps d’un ours slovène au savoir immémorial, et alors je sauterais sur le dos de cet humain, avocat pro-chasse, et sur le dos de cet autre humain, président des chasseurs ».
J’avais cru lire « cet avocat anti-chasse », et alors, pendant une seconde, je me suis crue dans Grizzly man de Herzog, à me dire, ah, enfin, elle parle du côté aveugle, injuste et cruel de la nature, qui, en général, en a rien à foutre des valeurs morales des humains. On est tous nus devant elle, vulnérables. Mais non, c’est juste un moyen de critiquer la chasse, ce que je n’aime pas moi non plus, mais encore une fois, quand je lis un roman, j’ai pas forcément envie d’être caressée dans le sens du poil. C’est un livre qui prêchera les convaincus et agacera les autres, mais dans ces passages surlignés, ça n’amène ni la réflexion, ni le plaisir esthétique.
D’ailleurs, et je sais que c’est une critique que les antispécistes doivent souvent entendre, mais pour quelqu’un qui fait preuve d’autant d’empathie envers les animaux, elle en manque beaucoup pour les humains — quand un couple se plaint qu’elle n’ait pas attaché sa chienne, que la femme pleure, qu’on pressent donc qu’elle a sans doute une phobie des chiens, Hunziger, d’une part est pleine de sous-entendus visqueux « Un très vilain couple. Pervers, je ne dirais pas. Mais se faisant chier dans la vie. Sans enfant. En mal d’enfant. »
Et d’autres part, en vient à créer un fantasme dans l’esprit de l’homme par rapport à sa chienne, fantasme sorti de nulle part « C’est qu’elle faisait vraiment très envie, Yes, genre petite chienne à kidnapper, pas gracieuse, mais une bombe à sa manière, explosive, anti-patriarcale » - le texte en vient à en faire l’étendard d’une situation de masculinité toxique, alors que pas du tout. Ce qui remet en doute parfois l’existence même de sa chienne, étant donné qu’elle voit dans tous les hommes de possibles agresseurs de chiens, et qu’on se demande si ce n’est pas elle-même dont il s’agit, si ça n’emblématise pas sa propre peur du masculin.
C’est un livre que j’ai été contente de refermer, même si comme je disais, je pense que c’est dû à ma lecture assez rapide. Je trouve que la plume est très belle, que les images sont organiques, féminines, qu’elles sentent l’humus et le sous-bois, j’aurais apprécié que certains passages soient moins surlignés. Je le recommande à ceux qui aiment la poésie, qu’un roman sans histoire ne dérange pas.