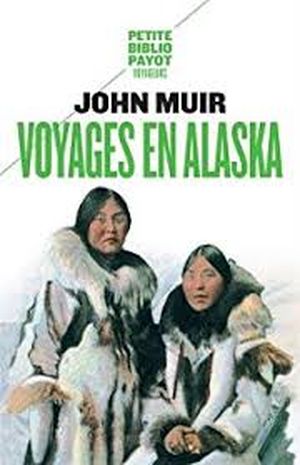Voyages en Alaska par BibliOrnitho
Muir est un naturaliste érudit : botaniste, glaciologue, ornithologue, géologue…, il touche à tout, s’intéresse à tout. Dans ce récit, il décrit trois de ses voyages dans le sud-est de l’Alaska, en 1879, 1880 et 1890. Depuis l’île Wrangell dans l’archipel Alexandre, cet écossais, père des parcs nationaux américains, va sillonner le littoral en canoë à la découverte de cette région encore très largement inconnue. A une exception près, il ne s’enfoncera pas à l’intérieur des terres autrement qu’à l’occasion de l’exploration des fjords qui déchirent le trait de côte. Accompagné par des indiens qui lui servent de guides, d’interprètes, de porteurs, de rameurs… et du révérend Young, un missionnaire presbytérien, il a à cœur d’observer tous les grands glaciers de cette partie de l’Alaska : ceux qui plongent dans la mer, ceux restant en altitude, ceux qui fournissent des icebergs au prix d’un bruit de tonnerre, les géants, les plus modestes. A mon grand étonnement, il précise que la plupart sont déjà en net recul. Croyant, il loue Dieu à plusieurs reprises pour ces paysages extraordinaires qui défilent sous ses yeux émerveillés.
Passionné, Muir arpente la montagne et les rivières de glace au mépris du danger, sans arme et sommairement équipé. A de nombreuses reprises, seule une chance inouïe le sauve de la mort. Même les indiens tremblent de le voir prendre tant de risques. Mais comme il l’affirme souvent lui-même, il est né sous une bonne étoile : à ses côtés, ses compagnons ne courent aucun risque. Rien n’a raison de son incroyable force, de son extraordinaire optimisme insouciant : ni le brouillard qui le surprend à plus de 25 kilomètres de son campement, ni les profondes crevasses qui s’ouvrent devant lui alors qu’il traverse un glacier, ni les icebergs qui s’entrechoquent autours de son frêle esquif et qui menacent de le broyer à tout instant, ni ces tempêtes glacées qui le trempent jusqu’aux os, ni cette neige qui tombe en plein mois d’août. Ni ces querelles fratricides qui opposent continuellement les différentes tribus indiennes : alors qu’il doit se rendre dans le principal village de l’ethnie Chilka, Muir doit renoncer au dernier moment car ses guides qui l’accompagnent depuis plusieurs semaines appartiennent à une tribu ennemie.
Young, à l’âme aventureuse, profite du périple de son ami pour prêcher la bonne nouvelle : le Christ s’est sacrifié pour nous sauver. Muir et Young ont été surpris (et le lecteur avec eux) du bon accueil de l’ensemble des indiens pour le prosélytisme occidental. Les « bostoniens », c'est-à-dire, les américains « civilisés », les anglais, les occidentaux (les Blancs) sont chaque fois perçus comme de grands savants. Ils possèdent des armes perfectionnées et sans rapports avec les leurs. Leurs bateaux sont en « fer » et propulsés par le feu (bateaux à valeur) alors que les leurs sont en peaux et à rames (ou à voiles). Si des hommes d’une telle supériorité matérielle croient en un Dieu qui n’est pas le leur, c’est qu’eux-mêmes se fourvoient depuis toujours. Ces Blancs vont enfin leur apporter la connaissance (par l’envoi d’instituteurs) et des réponses sur l’au-delà qui les tourmente tant. Aucun d’eux ne remet en question les affirmations du révérend dont la parole est d’or. Aucun d’eux ne doute de ses promesses. Et tous se désolent pour leurs ancêtres, morts à l’écart de la vraie religion et qui, certainement, errent quelque part en enfer.
Mais John Muir ne se montre jamais condescendant. Aucun sentiment de supériorité ne transparaît dans ses écrits. Pour lui, les autochtones sont merveilleusement adaptés à leur environnement (il décrit les enfants allant nus, les adultes à peine vêtus sous une froide pluie battante alors que lui, pourtant écossais, tremble de froid sous son épais manteau), leur savoir ancestral immense. Mais l’homme n’est pas ethnologue et il ne consacre que peu de pages à la culture indienne qu’il ne fait qu’écorner.
Ce récit, c’est trois cents pages d’exotisme, d’aventures et de dépaysement. Le lecteur est un mètre derrière l’explorateur et découvre avec lui cette nature grandiose qu’aucun Blanc n’avait jusque là contemplée. Ce pourrait être du Jules Verne dans le texte à la seule différence que Muir n’écrit pas une fiction. Tout a été vécu et le lecteur partage chaque fois les émotions (joie, peine, fatigue, frustration, fébrilité de la découverte, peur…) de l’explorateur qui est aussi un écrivain de talent.
Fabuleux !
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.