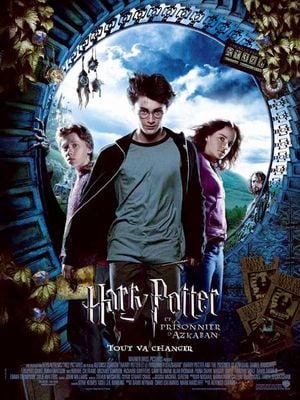(article disponible sur PETTRI.COM)
Après deux volets de bons et loyaux services, Chris Columbus décide de laisser sa place à la barre de la troisième aventure du jeune sorcier aux lunettes rondes et à la cicatrice en forme d’éclair. J.K. Rowling et les producteurs approchent d’abord Guillermo Del Toro, puis Marc Forster, M. Night Shyamalan et même Kenneth Branagh, qui interprétait Gilderoy Lockhart dans le précédent film. Mais c’est bien Alfonso Cuarón qui se retrouve aux manettes de ce mastodonte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en plus de faire son rôle de faiseur au sein d’une saga d’ores et déjà établie, il impose une patte immense, et un nouveau style qui perdurera dans les épisodes suivants. La plus immédiate des contributions du cinéaste mexicain à la saga est cette évidente désaturation de l’image, où les couleurs vives semblent se perdre dans des tons froids, ternes, sombres et des contrastes marqués. Il a en effet littéralement embarqué la saga dans les ténèbres serpentines qui se tramaient déjà entre les lignes des romans, en faisant de la lumière le thème logique et central de ce volet.
Dès les premières images, et jusqu’au générique de fin, Cuarón développe l’idée que Harry est le seul rayon de lumière qui subsiste dans un monde qui retombe peu à peu dans les ténèbres, à mesure que le spectre de Voldemort se ravive. L’ouverture est une véritable exposition de ce pli allégorique : dans un noir total, la caméra se rapproche doucement d’un léger et lancinant rayon de lumière blanche. C’est Harry, dans sa chambre de Privet Drive, qui révise ses sortilèges en pleine nuit, témoignant du caractère ambivalent de ce personnage : innocent, il fait plusieurs fois mine de dormir alors que son oncle Vernon vient pour le réprimander, mais continue sa rébellion en utilisant illégalement la magie en dehors de Poudlard, jusqu’à une explosion de lumière faisant reculer la caméra pour révéler le titre du film. L’aventure est littéralement lancée par la lumière d’espoir que représente le héros Harry au sein de l’obscurité de son monde. Thématique aisée et certes manichéenne, mais logique dans une saga telle que celle-ci, où le combat du Bien contre le Mal est une question centrale au sein même d’un voyage du héros tout à fait classique. Ce qu’il y a d’étonnant et d’osé dans ce film pourtant si mainstream, c’est le travail d’appropriation de Cuarón d’une autre thématique, celle du temps. Si elle était déjà centrale à l’intrigue du roman, notamment l’utilisation du Retourneur de Temps, Cuarón en fait carrément un motif visuel récurrent qui s’invite tout au long du film dans le décor, les dialogues, la mise en scène. Que ce soit via le pendule et l’horloge de la tour du château ou sur le travail visuel des ellipses saisonnières qui viennent découper le film se déroulant comme d’habitude sur toute l’année scolaire de nos héros. Cuarón utilise aussi à plusieurs reprises l’ouverture ou la fermeture à l’iris, une forme de montage du passé qui, associée à l’utilisation que fait le réalisateur du motif de la lumière, rapproche ce monde magique du cinéma, art de la lumière (capter le mouvement par l’exposition successive d’images fixes, la projection, etc.) et du temps (il ne s’agit plus d’images fixes comme en peinture ou en photographie). Cuarón est ainsi l’émissaire du rapprochement de l’art et de son médium au sein de cette saga qui aura bercé plus d’une génération d’enfants, et les aura éduquer au cinéma. Il y a pire comme guide.
D’autant plus que la mise en scène du réalisateur de Y Tu Mamá Tambien est assez folle quant à la gestion tonale qui est à l’œuvre au fil des 2h21 de métrage : on rit beaucoup moins que sur les deux films précédents, on peut passer d’une ambiance de film d’horreur (les Détraqueurs, le loup garou) au cartoon fun et léger, parfois en un instant, comme avec le Magicobus qui fait son apparition immédiatement après la première vision de ce qu’on pense alors être le Sinistros (c’est en réalité Sirius sous sa forme canine). Rien d’étonnant alors de considérer les Têtes Réduites, apport de Cuarón jugé parfois scandaleux, comme une extension de ce désir de lier les deux facettes de ce monde qui pourrait paraitre dichotomique : des objets de Magie Noire traités de façon cartoonesque, légère et drôle. À l’aide d’une mise en scène faisant la part belle aux plans en mouvement, Cuarón compose des plans magnifiques, que ce soit de longs plans de blocking, témoin de sa réelle virtuosité, ou des plans où la caméra n’a plus de limite matérielle, elle passe entre les barreaux, à travers les vitres et les miroirs. Ces plans superbement mis en scène et en images prennent tout leur sens quand on se rend compte que le mouvement d’appareil est aussi là pour signifier la menace de ce prisonnier en fuite, qui rôde et peut frapper à tout moment. Dès lors, il n’est pas étonnant de retrouver beaucoup de plans isolant Harry par rapport aux autres personnages, étant à la fois la cible de Sirius et l’élu, qui devra sauver seul le monde de sa menace ultime : Voldemort. Il serait d’ailleurs bon de noter que c’est le seul film de la saga où Voldemort est absent ; il n’est étrangement présent que dans une peinture à Poudlard.
C’est l’histoire de ses parents qui semble définitivement liée à celle de Harry : Lupin, le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Sirius, l’antagoniste qui est en réalité un allié de taille et le parrain d’Harry, et Peter Pettigrow, qui avait pris la forme de Queudver, le rat de Ron, sont les trois meilleurs amis d’enfance de James, le père d’Harry. Rogue lui reproche d’ailleurs de ressembler à son père, préfigurant les derniers moments déchirants du personnage dans le dernier volet de la saga. Si on a beaucoup reproché à Cuarón d’avoir pris des libertés quant à ce qu’avait instauré les précédents films (la place du Saule Cogneur notamment), on ne peut que louer ses nombreux implants pour ce qui se déroulera par la suite : on y décèle en effet les premiers signes de rapprochement entre Ron et Hermione ainsi que la découverte de la carte du Maraudeur, qui s’avèrera pratique plus d’une fois ! Cuarón prend une fois de plus à contrepied de ce qui a été précédemment fait avec l’unique scène de Quidditch, courte, brumeuse, terne et sans réelle démonstration du jeu. Mais elle sert surtout au développement de l’intrigue d’Harry qui doit à nouveau faire face aux Détraqueurs, passage obligé avant de pouvoir les repousser lors du climax. Et tout ça, Cuarón le fait sans pour autant en oublier l’aventure et les « boss » à passer, tels le Saule Cogneur, le loup garou et les Détraqueurs. En plus d’un nouveau réalisateur, ce nouvel opus accueille de nouvelles têtes, principalement britanniques : David Thewlis (Lupin), Gary Oldman (Sirius Black), Timothy Spall (Peter Pettigrow) et Emma Thompson (Sybille Trelawney). C’est l’irlandais Michael Gambon qui vient remplacer son compatriote Richard Harris, mort peu de temps après le second volet, pour prêter ses traits à Dumbledore.
Ce changement d’acteur contraint pour un rôle si important est embrassé par l’équipe artistique, puisqu’on assiste ici à un remodelage complet du look du directeur de Poudlard, ainsi que de son interprétation, plus agressive. Le film s’applique à également installer Lupin et Sirius comme des personnages durables et complexes, qui auront un rôle de taille dans les films suivants. Le ton du film, avec ses personnages plus nuancés et sombres, semble donc s’accorder parfaitement à l’esthétique désaturée et à la colorimétrie plus obscure et moins veloutée du chef opérateur Michael Seresin (les films d’Alan Parker). Sa magnifique lumière trouve son paroxysme lorsqu’on assiste 15 ans après à des intégrations numériques quasi parfaites, les effets spéciaux numériques étant probablement ce qui se faisait de mieux et de plus expérimental à l’époque. En outre, loin d’être une énième redite visuelle d’un loup garou lambda, on a le droit ici à une bête à la fois originale, viscérale et visuellement vraiment cool. Le Prisonnier d’Azkaban est aussi la dernière partition de John Williams pour la saga, où il fait quelque chose de plus expérimental et médiéval, avec au choix des trémolos de cordes, des rythmes jazzy rapides ou le fameux Hedwige’s Theme repris au glockenspiel ou au cor. Si le film se termine sur un freeze frame, typique du cinéma adolescent de John Hughes, ce n’est évidemment pas innocent. Cuarón fige le temps, et donc son film, dans un sentiment lumineux, d’espoir, de joie, de liberté, alors même qu’il l’avait ouvert sur un fin rayon lumineux au milieu de ténèbres écrasantes. C’est tout simplement ce qu’on appelle un cinéaste. Un cinéaste qui met en scène un film, ample, rigoureux, beau et fin. Avec ce film, Alfonso Cuarón aura donc fait entrer la saga Harry Potter dans la dimension magique, grandiose et éternelle qu’on connait aujourd’hui. Reste à voir ce qui en sera fait par ses successeurs dans les films suivants !