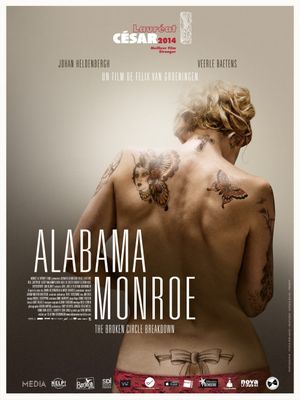Raconter l’histoire de parents devant faire face à la maladie et la mort de leur enfant, c’est prendre le risque de tomber dans le pathos et de ne rien raconter sinon enfoncer des portes ouvertes. Le réalisateur d’Alabama Monroe, Félix van Groeningen évite avec habileté cet écueil au moyen notamment d’un montage alternant entre passé, présent et futur laissant le temps au spectateur de souffler avec des scènes plus légères. Mais en plus d’éviter habilement cet écueil, Félix van Groeningen nous propose une réflexion intéressante sur les manières de faire face à la mort et qu’il me semble nécessaire d’expliciter pour en révéler toute la teneur.
Certains y auront vu un cinéaste qui pose des questions sans jamais y répondre laissant le soin au spectateur d’y répondre par lui-même. Je tiendrai ici le discours opposé. Bien que van Groeningen construit nombre de ses scènes pour aboutir simplement à des questions, le film distille dans les autres scènes au moins une réponse à celles-ci.
Faire face à la mort : la tension au cœur du film
Le film réside dans la tension entre la cruauté de la vie et les moyens mis en œuvre par les humains pour tenter de vivre. Cette tension est concentrée dans la confrontation à la mort de Maybelle avec l’oiseau, alors même qu’elle risque de mourir très bientôt. Face au deuil, l’incompréhension ou encore la cruauté de la vie, deux points de vue sont ici opposés : la croyance au surnaturel parfois religieux et l’athéisme lorgnant avec une rationalité scientifique. Cette tension entre les deux points de vue est personnifiée par le couple, Elise et Didier, et dont chacun est un archétype.
Didier représente le point de vue athéiste, cherchant à s’extraire lui – et si possible tout le monde avec lui - des illusions, des croyances et de la religion qui sont pour lui des créations humaines servant à manipuler les autres, à les écarter du vrai monde, à les encourager de vivre dans la confortable grotte de Platon.
A l’opposé, Elise vit dans un monde où le surnaturel peut prendre sa place. Elle vient d’une famille croyante dont le crucifix légué de mère en fille en le témoignage. Elle tatoue avec des figures symboliques des étapes de sa vie sur son corps. Quand un oiseau vient toquer à sa fenêtre, elle croit que c’est sa fille Maybelle qui lui rend visite. Dans son monde, les choses prennent des significations métaphysiques, mais qui mis en parallèle de l’athéisme prennent la forme d’une fuite de la réalité, d’une vérité qui ne passe pas : celle de la mort de Maybelle, sa fille.
Incompréhension et individus faillibles
Mais ces deux personnages, bien qu’ils se constituent en archétypes ne sont pas caricaturaux. Ils sont en réalité très humains. Les humains sont des individus complexes et il est très rare de trouver un humain parfaitement caricatural. Didier n’est pas un fervent militant athéiste et scientiste. Sa conception du monde est fondée sur des connaissances scientifiques vulgarisée et une philosophie de vie centrée sur l’existence humaine sur Terre, tout simplement. Il est comme de nombreuses personnes qui n’ont pas pour objectif de vie de devenir des scientifiques ou des philosophes, ou du moins d’atteindre personnellement ce niveau en dehors de toute validation académique légitime. La limite de sa compréhension du monde se situe dans la limite de ses connaissances scientifiques, philosophiques et épistémologiques qui sont partielles. Sur le plan de l’évolutionnisme biologique, il est absurde de penser que des espèces comme les oiseux finiront par apprendre qu’ils ne peuvent pas traverser les vitre (et même si c’était vrai, est-il éthique de laisser mourir nombre d’entre eux en espérant qu’ils finissent par apprendre ? La question n’est pas vite répondue). Sur un plan socio-anthropologique, il ne comprend pas non plus les raisonnements qui amènent les humains à croire ou à donner des significations aux choses du monde. Cette méconnaissance entraine une incompréhension qui se traduit dans le film par des énervements incontrôlés amplifié par la perte de son enfant. A partir du discours du Président états-unien George W. Bush à la télévision on comprend que pour Didier ce sont bel et bien les croyances qui empêchent l’avancée de la science sur les cellules souches qui auraient pu soigner sa fille. Il faut cependant noter que ce n’est pas purement pour sauver sa fille qu’il s’énerve. Sa mort, il l’a accepté. Ce qui l’énerve c’est qu’il pense à toutes ces personnes qui mourront en attendant que la situation se débloque. A cela on peut d’ailleurs faire un parallèle avec les oiseaux s’écrasant sur les fenêtres.
De l’autre côté, Elise n’est pas particulièrement croyante. Le seul élément qui la rapproche de la croyance pendant une bonne partie du film est ce crucifix. Et parce qu’ensuite elle a beaucoup de mal à accepter la perte de sa fille, elle croit qu’elle existe encore au travers des oiseaux autour de la maison.
Le côté humain des deux personnages dans lesquels il est très facile de s’identifier permet une véritable implication des spectateurs et pose les bases d’un débat sur le deuil et la manière d’appréhender la vie et la mort.
Des réponses ou que des questions ?
Au premier abord, Félix Van Groeningen ne semble pas donner de réponses aux questions qu’il pose dans son film à l’image de l’interrogation de Didier à Elise, je paraphrase : « peut-on dire à un enfant qui découvre la mort, et qui plus est risque de mourir très bientôt, qu’il n’y a rien après la mort sinon le néant ? » Ce à quoi Elise répond simplement non. Mais que dire ?
Alors que la fin du film ne résout en réalité aucune tension et la continue même avec la répétition de la mort lors de son dernier acte, Félix van Groeningen propose néanmoins une solution : la poésie. Ainsi, le dénouement de la tension ne se trouve pas dans un juste milieu entre athéisme cru et croyance fuyante mais dans un pas de côté. Entre la cruauté de la vie et la faiblesse de l’esprit humain, la poésie est le vaisseau qui peut transmettre sans traumatisme des idées ou des faits difficiles à entendre.
La poésie prend dans le film deux formes. D’abord elle existe tout du long dans l’accompagnement des émotions avec la musique bluegrass. Un genre musical très axé sur la mélancolie ou encore l’expression de sentiments difficiles à avouer. Et c’est d’ailleurs une chanson bluegrass qui conclut le film après que la mort ait encore frappé comme pour nous dire que le moyen le plus simple et peut-être le plus efficace pour accepter l’inentendable était la musique et la poésie.
La deuxième forme consiste à utiliser les connaissances scientifiques comme allégorie. C’est le cas dans cette scène vers la fin du film, où Maybelle dans son caisson stérilisé demande à son père de raconter encore une fois l’histoire des étoiles, Didier raconte : « Une étoile, c’est un soleil, mais très très loin. La lumière qu’elle produit traverse toute la galaxie jusqu’à tes yeux. Et même si elle meurt, sa lumière continue de voyager à l’infini. » A travers cet exemple, Didier fait un pont entre les connaissances scientifiques et l’acceptation d’une réalité dure à entendre. La mort ainsi représenté n’est plus si terrible et ajoute une perception tout à fait réelle de l’expérience humaine : les morts continue de vivre dans l’esprit des vivants.
Conclusion
En définitive, Alabama Monroe ne se contente pas d’une histoire triste d’enfant malade voué à mourir. Il ne se contente pas non plus de poser toutes les questions que déclenchent la mort ou le simple fait d’en parler. Distiller dans sa réalisation et au cours de certaines scènes, Félix van Groeningen invite à un pas de côté face à l’expérience de la mort : la poésie comme technique de sublimation de la vie et de la mort.