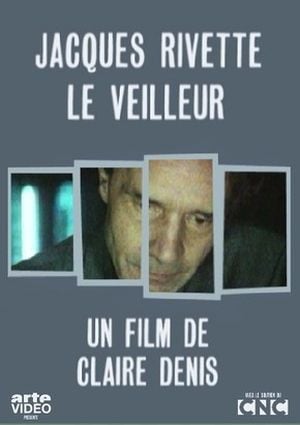Jamais je n'ai vu plus beau portrait filmé d'un cinéaste.
A un moment, Rivette parle du mot plot chez Edgar Poe, que Baudelaire traduit toujours par plan, alors qu'il y a dans plot une dynamique, une promesse de récit que le mot plan ne recouvre pas. Alors, un film, ce ne serait pas une question de plan. Un film, ce serait ce mot, plot.
"Complot, plot, c'est peut-être la même étymologie", badine Daney. Un film est un complot qu'on fait toujours à plusieurs, un film est un complot qui se dénoue. Et là, le sourire de chat de Rivette invente quelque chose, un petit jeu de mot, très mignon : un film, si c'est un plot", c'est donc une "pelote", un film est une pelote qu'on dénoue.
Et ce film, c'est un peu ça, une pelote qui se dénoue. On y voit Paris, des rues, des espaces de Paris, ainsi que quelques fils d'une vie, celle de Rivette ; se dénouer. Et on n'obtient pas grand chose d'une pelote qu'on dénoue. Simplement le fil, et plus grand chose de la tension de la pelote. C'est un peu ça, le mouvement du cinéma de Rivette : au départ, il y a une concentration de fils, et nous n'avons pas grand chose à gagner que celui-ci se dénoue. Rien, à part le plaisir de dénouer. Rien, à part du temps. Et c'est le secret de ce temps que le film de Claire Denis nous propose d'explorer.
Je trouve le film magnifique, d'une très grande douceur, d'une très grande bonté. Il semble obéir à la seule leçon du cinéma de Rivette : ne jamais chercher à violer le secret de l'autre tant qu'il ne se révèle pas de lui-même. C'est peu dire que Rivette, comme son cinéma, reste un homme secret. Alors, le film se fait une place dans ce secret, le secret d'un cinéma et d'une vie, une place bien à lui, singulière. Cette place, c'est celle que se donne Claire Denis, où qu'elle se manifeste, devant ou derrière la caméra. Parfois devant la caméra : assise à la table, silencieuse le plus souvent, ne faisant entendre sa belle et jeune voix qu'à de rares instants, cachant son visage avec sa main, sa main du mauvais côté de la caméra - c'est à dire, en fait, du bon, de celui qu'on voit, de celui qu'on devrait voir, de celui qui devrait nous permettre de regarder son visage. Mais non. La main est là, et Claire Denis choisit de conserver ce plan d'elle. Comme pour montrer à Rivette qu'elle garde pour elle ses leçons : personne d'autre que soi ne peut partager son secret, personne d'autre que soi ne peut se morceler le corps, personne d'autre que soi ne peut se toucher vraiment, s'appartenir. Jamais nous n'avons l'impression que le film appartiendra à Rivette. Non. C'est le film de Claire Denis. Et lorsque la caméra balaie sublimement Paris, c'est à Paris que le film appartient, à ses fantômes.
Quand Claire Denis n'est pas à l'image, on la sent tout autant derrière. Comme lorsqu'elle décide, soudainement, de panoter après une réplique de Daney ou Rivette, filmer la rue ou la vitre du café. On semble entendre ou sentir l'impulsion de la cinéaste, qui demande soudainement à l'opératrice d'effectuer le mouvement. C'est très étrange, j'ai senti cela très intensément. J'ai senti l'impulsion. J'ai senti la présence. Ces choses, d'habitude, on ne les sent pas. Surtout pas dans un portrait, encore moins dans un portrait d'un cinéaste aussi reconnu. Cela veut dire que Claire Denis est là, veut être là, veut se donner une place. Rivette parle un moment de Lang qui ne parlait que de morale. Daney disait d'ailleurs dans un entretien que Lang savait nous donner une place. La morale est-elle une affaire de place qu'on assigne, qu'on s'assigne ? Cela, Rivette ne le dit pas : c'est Claire Denis qui filme et qui nous le dit.
C'est un film qui problématise à son avantage la question du cinéma de Rivette : noli me tangere, ne me touche pas. Il n'y est question que de distance, de sensation, de tension, d'attention aussi - Claire Denis semble attentive à chaque mouvement de tête que Daney effectue pour mettre Rivette à l'aise. Il y a bien sur le regard de Rivette lui-même, fuyant l’œil de la caméra dès qu'elle se rapproche un peu, ne regardant jamais son interlocuteur dans les yeux. Il y a le jour et la nuit, le petit matin clair et mystérieux. Filmer Rivette, c'est comme tomber amoureuse du secret des autres - en d'autres termes, devenir cinéaste. C'est cela que Le Veilleur nous montre : une cinéaste qui, lentement, se dessine.