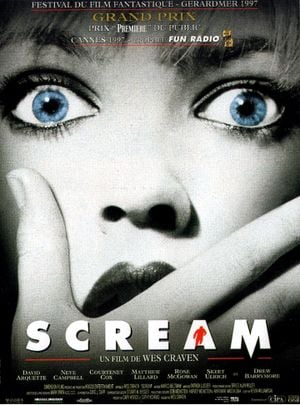Film culte pour toute une génération, ayant réussi l’exploit d’aller bien au-delà du cercle habituel de ce type de cinéma, pour devenir un véritable phénomène immédiat, Scream, titre simple et évocateur, aura connu trois suites sur trois décennies (en attendant le 5ème, sans numéro derrière), et aura fait office de point d’ancrage pour qui se réfère à la culture 90’s, s’attirant autant de critiques enthousiastes (allant jusqu’à faire la couv' des Cahiers, et de déclencher la colère du lectorat le plus puriste du célèbre magazine), que de scepticisme de la part des « fans » de genre estimant le film de Craven comme un sommet de cynisme prenant le film d’horreur de haut et son public pour des ados décérébrés ou potentiellement violents, relançant même via quelques faits divers crapoteux l’éternel débat sans fin sur la violence au cinéma et son impact sur les esprits fragiles. Bref, il est bien difficile aujourd’hui de trouver un nouvel angle d’attaque pour parler de cette Œuvre importante du cinéma, tant tout semble avoir été dit et écrit à son propos. Et pourtant, la revoir aujourd’hui montre bien à quel point le geste de Kevin Williamson, scénariste qui allait connaître son heure de gloire suite à ce coup de génie, associé au métier de Wes Craven, a bel et bien été une marque dans l’histoire du cinéma tout court, en allant bien au-delà du simple commentaire méta comme on en a tant soupé depuis, pour s’inscrire réellement comme manifeste culturel et générationnel, à l’intelligence redoutable, et dont le recul permis par les presque 30 ans nous séparant de sa sortie initiale, permet de mesurer d’autant plus l’impact et la capacité à résister à tout effet de mode, pour devenir un véritable chef d’œuvre toujours aussi jubilatoire, et aux divers niveaux de lecture assez frappants.
Sous sa couche première, il s’agit bel et bien d’un slasher, dans son sens le plus pur, à savoir une bande de jeunes confrontés à un tueur psychopathe tuant à l’arme blanche, couplé à un whodunit, genre popularisé par les romans de Agatha Christie, et consistant tout simplement à dénicher le ou les coupable(s), instaurant un jeu ludique mettant à contribution autant les protagonistes de l’histoire que les spectateurs. Le principe étant ici de mettre en scène des adolescents possédant la même culture cinéphilique que les spectateurs supposés, culture leur permettant à priori de déjouer les pièges inhérents à tout film du genre où les personnages feraient systématiquement tout ce qu’il ne faut pas pour survivre. En réalité, la mise en abyme n’est pas nouvelle lorsque le film sort, et Wes Craven lui-même avait tenté le coup peu de temps avant avec « Freddy sort de la nuit », sans être trop compris par le grand public. Mais rarement le principe avait été poussé à un tel niveau avec des personnages comme désensibilisés totalement à la violence les entourant, ayant comme conscience d’évoluer dans un univers fictionnel dont ils connaissent toutes les règles, ce qui leur permet de s’en amuser et à Williamson et Craven de jouer sur des effets miroirs parfaitement agencés, allant au-delà des simples citations comme le cinéma moderne en est friand, pour tout simplement faire ce que l’on appelle communément la mise en scène. Cette petite chose insignifiante qui est la base du cinéma et qui, lorsqu’elle est maitrisée, par un immense réalisateur, ou un artisan talentueux comme c’est le cas de Craven, permet de faire passer ses idées par le mouvement de la caméra, le montage, bref la narration par l’image.
Dès la fabuleuse scène d’ouverture (12 minutes trente toujours aussi stressantes de par l’effet de proximité induit immédiatement entre le personnage et le public), la caméra fluide se faufile dans toutes les pièces, à travers de longs plans effectués à la steadycam, où se fait jour la grande virtuosité de Craven pour la mise en espace, retenant les leçons des maîtres en filmant toujours utile, s’attardant soudain sur des éléments de décors qui serviront plus tard. Nulle virtuosité stérile chez lui, mais un professionnalisme acquis au travers d’une carrière déjà longue, pas toujours brillante, mais faisant de lui un excellent artisan ici au sommet de son Art. Plus tard, nous retrouverons ce type de plans, notamment lorsque Sidney Prescott, notre héroïne, déambulera dans sa maison, nous permettant de nous repérer parfaitement. Mais au-delà de ces plans se référant au meilleur cinéma classique (oserais-je citer la figure toute puissante de Hitchcock ?), le film va se faire réellement virtuose et génial dans sa deuxième partie, lors du pré-climax, là où le projet initial se fera définitivement jour, au-delà des crimes sanglants et du suspense parfaitement entretenu, pour devenir ce sommet toujours aussi efficace aujourd’hui.
La mise en abyme est donc ce principe consistant à créer un effet miroir entre ce qui se déroule dans le film que l’on regarde et la conscience que ses personnages évoluant dans le « vrai » monde peuvent avoir de ce qu’ils vivent, à travers le cinéma à l’intérieur même de la fiction. Généralement, cela se fait avec des scènes se déroulant au cinéma (à ce niveau, Angoisse de Bigas Luna, sorti au début des 90’s, est un sommet précurseur), mais cela peut également être le cas lorsque des personnages vont regarder un film comme c’est le cas ici, en commentant ce qui se déroule dans ce film qu’ils regardent (ici La nuit des masques), et qui répond à l’action à laquelle on assiste nous-mêmes dans la fiction dont ils ignorent être les héros. Une scène frappante porte en elle tous ces enjeux théoriques sur le papier, s’incarnant merveilleusement à l’écran. Randy, le cinéphile édictant tous les codes du genre à ses camarades lors d’une fiesta décomplexée (en temps de couvre feu et alors qu’un tueur fou traîne aux alentours), se retrouve tout seul devant la télé, à parler à Jamie Lee Curtis à travers l’écran en lui disant de ne pas aller par là, car le meurtrier se trouve derrière elle. Bien entendu, pendant ce temps, le tueur de « Scream » apparaît, couteau à la main, juste derrière lui, poussant sans doute le public salles de l’époque à s’écrier « Derrière toi, Randy ! « . Juste après, nous retrouvons le caméraman de la journaliste Gale Weathers, dans le van, regardant les images de la fête obtenues grâce à une caméra cachée à l’intérieur, nous montrant en différé ce même Randy en train de s’adresser à Jamie Lee, le tueur apparaissant derrière lui, et le caméraman s’adressant donc à Randy en différé sans pouvoir intervenir. Un discours sur l’image en forme de triple mise en abyme, du film que l’on regarde, de « La nuit des masques », qui plus est l’œuvre la plus mythique du genre, comme caution des règles de base du genre, et enfin le caméraman regardant les images de « Scream », par le prisme d’un autre écran. Et tout cela ne devient jamais plombant à l’écran, tout simplement parce que le discours théorique n’est jamais montré comme tel, pouvant bien entendu être compris par les cinéphiles s’intéressant aux notions d’images, de la façon de les montrer, du montage, bref, de tous ces éléments cinématographiques auxquels le public adolescent visé par le film n’est pas nécessairement sensible, mais qui rendent le film aussi passionnant à analyser que ludique à regarder au premier degré.
C’est pour ça que même en le connaissant quasiment par cœur, l’effet de surprise sur l’identité des meurtriers ne jouant plus, il est toujours possible de revoir le film au fil des ans en y découvrant de nouveaux détails, ou tout simplement en se rendant compte de sa richesse formelle. Au-delà de ces considérations, le film frappe toujours aujourd’hui par sa violence graphique assez rare à l’époque, et il n’y a qu’à comparer l’ouverture d’une cruauté inimaginable ainsi que le climax sanguinolent à tout ce qui aura suivi, durant la vague du néo slasher, avec des films tels que Souviens-toi l’été dernier ou Urban legend, pour mesurer l’écart entre le traitement de la violence dans ce film et dans les ses copies (aussi sympathiques puissent-elle être malgré tout). Une violence qui aura d’ailleurs souvent été pointée du doigt par les parents affolés, et qui, sans aller jusqu’à un discours moral ronflant, peut néanmoins être questionnée, là aussi avec tout le recul permis par les années, de par la façon dont les personnages vivent ces évènements de manière totalement distancée, de la même manière que le public du film, plus dupe du tout après des années de visionnages d’équarissages fictionnels d’adolescents dans des slashers plus ou moins réussis. Cette absence d’émotions assez frappante au début du film lorsque notre groupe d’ados réagit au massacre initial par une attitude rigolarde, avec force détails sur la façon dont les victimes ont été étripées, loin de tout discours manichéen anti jeune (le shérif dira d’ailleurs, lorsqu’on lui posera la question sur ce qu’il pense de la probable culpabilité du jeune Billy Loomis, qu’il aurait répondu il y a vingt ans que ce n’était pas pensable, mais qu’avec les jeunes d’aujourd’hui il n’avait plus aucun certitude), est pourtant la preuve d’un recul et d’une complexité qui emmènent le film bien au-delà de la simple récréation pointée par certains critiques à l’époque.
Le temps aura donné raison à tous les défenseurs initiaux, ayant compris immédiatement à quel point le film allait être important. Ses suites auront certes capitalisé avant tout sur son succès démentiel, avec plus ou moins de réussite, mais même sans atteindre la force évocatrice de ce premier opus, elles auront néanmoins à chaque fois apporté leur pierre à l’édifice d’une saga unique en son genre, nous ayant présenté les mêmes personnages vieillissant en même temps que le public, apprenant de leurs erreurs pour devenir de véritables icônes prenant des coups mais se relevant à chaque fois plus forts. La raison principale de l’attachement que l’on peut avoir pour la saga, et de l’excitation mêlée à la crainte de voir débarquer aujourd’hui un cinquième opus aux airs de passage de flambeau à la nouvelle génération. Croisons les doigts pour ne pas avoir un film malhonnête conçu pour de mauvaises raisons, mais en attendant, savourons le plaisir intact à revoir cette Œuvre séminale et incontournable du cinéma, n’ayant pas pris une ride.