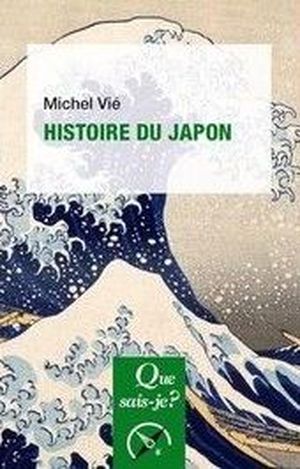Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/08/histoire-du-japon-de-michel-vie.html
Bon, là encore, je ne sais pas s’il est bien pertinent de livrer une chronique de ce petit ouvrage – un « Que sais-je ? » qui plus est… Cela dit, pour avoir un tant soit peu pratiqué la collection, il me semble qu’on peut y distinguer de « simples » résumés d’une problématique donnée, et d’autres essais qui affichent davantage un caractère personnel, voire une thèse à part entière, et cette Histoire du Japon : des origines à Meiji, signée Michel Vié, professeur émérite des universités à l’Institut national des langues et civilisations orientales, me paraît bien relever de cette deuxième catégorie – ce qui justifie sans doute davantage quelques développements à ce propos (à noter, l’auteur a également consacré un « Que sais-je ? » au Japon contemporain, qu’on peut supposer complémentaire de celui-ci).
En tout cas, ce petit ouvrage constitue un complément bienvenu à la partie pré-Meiji (quelque peu sommaire, donc) de l’Histoire du Japon et des Japonais d’Edwin O. Reischauer, relue récemment, en se montrant sans doute davantage pointu et en développant des questionnements éventuellement plus subtils… ou moins caricaturaux. Avec en tout cas une focalisation marquée sur un aspect dans l’ensemble autrement discret dans l’essai de Reischauer : la tension entre le centre et la périphérie, empruntant au fil des âges des traits féodaux pouvant légitimer la comparaison avec le Moyen-Âge occidental, et affichant pourtant en même temps la singularité du Moyen-Âge nippon. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’histoire japonaise, qui en est percluse jusqu’au cliché – dont, sans doute, celui qui vise à produire une synthèse originale voire unique entre tradition et modernité, que l’auteur présente plutôt, avec peut-être un soupçon déconcertant de raillerie d’ailleurs, comme une volonté d’inscrire les changements, pourtant bien réels, dans une continuité et une homogénéité constitutives d’un « temps immobile », principe essentiel d’une conscience historique nippone qui, pour autant, ne doit pas invalider le principe même d’une étude historique ; il n’en demeure pas moins que le contraste essentiellement envisagé par ce « Que sais-je ? » porte sur une dynamique interne – centre et périphérie – qui aurait pu être entropique, mais s’avère pourtant bel et bien garante d’une forme d’unité.
Ce ton parfois étonnant, et en même temps la précision des concepts employés, dès cette brève introduction passablement abstraite encore, dessinent les contours d’un petit essai ne relevant finalement guère de l’entreprise de vulgarisation parfois associée (et souvent à tort, j’imagine) avec la collection. J’irais même jusqu’à dire que le démarrage est un peu rude – après cette entrée en matière, très abstraite, le premier chapitre, consacré à la préhistoire japonaise, est ainsi passablement ardu. Ce « Japon d’avant l’écriture », celui des cultures Jômon, Yayoi puis des kofun, est peut-être d’emblée un contexte paradoxal, se constituant sans que l’on sache trop comment, et notamment sans vagues de migrations massives ; c’est en tout cas déjà une société se constituant comme de juste d’emprunts et d’assimilations, si l’on n’est pas bien certain des circonstances exactes – en ce qui concerne notamment l’agriculture et la métallisation. On y constate l’émergence de communautés locales dotées de chefs dont l’ostentation notamment funéraire (les kofun, donc, tertres parfois immenses en forme de trous de serrure) traduit déjà le pouvoir.
En émerge pourtant le Japon étatique de la « Cité impériale » (VIIIe-XIIe siècle), qui introduit la dynamique essentielle des tensions entre centre et périphérie. Si la Cour, à Kyoto, rassemble une aristocratie raffinée de fonctionnaires et de lettrés, elle introduit pourtant (ou formalise) un système de relations d’abord économiques puis politiques, via notamment les institutions fiscales, constitutif progressivement d’une aristocratie parallèle, ancrée localement cette fois – la conquête de l’espace intérieur (« l’ennemi n° 1 », selon la formule de Fernand Braudel ici reprise) témoigne peut-être elle aussi d’une tension essentielle, la pacification caractéristique des premiers temps de la « Cité impériale » débouchant à terme sur une remilitarisation essentielle à l’éclosion d’une société féodale, ou féodo-seigneuriale, caractéristique du Moyen-Âge japonais comme elle l’a été du Moyen-Âge occidental, toutes choses égales par ailleurs.
À mesure que l’on se rapproche de l’époque moderne, le ton de ce « Que sais-je ? » me paraît devenir plus abordable – mais peut-être est-ce avant tout qu’il devient alors plus concret. Quoi qu’il en soit, ce Japon médiéval d’où devait surgir (paradoxalement ?) l’État moderne au XVIe siècle, gagne en chair à mesure que la permanence et en même temps les changements subtils des institutions, politiques, économiques, etc., suscitent une dynamique de tension, cette fois dans une époque où c’est la périphérie qui en profite. C’est tout d’abord le Japon du Dit des Heiké, qui voit les Taira et Minamoto s’engager dans une lutte acharnée pour la réalité du pouvoir : un pouvoir central délégué, via les régents Fujiwara et Hôjô et les premières incarnations de l’institution shogunale ; ce pouvoir, en dépit de quelques réactions telle la vaine tentative de l’empereur Go-Daigo de restaurer la puissance censément fondamentale de la dynastie impériale, acquiert ainsi des traits essentiels pour la période moderne à venir : le gouvernement militaire du Bakufu incarnera bien alors le centre, quitte à maintenir dans une déférence toute japonaise pour la tradition le « second centre » de la Cour impériale, nul ne songeant visiblement à remettre en cause la dynastie impériale comme source de la légitimité de tout pouvoir. Mais il ne faut pas s’arrêter là : les luttes de cette période troublée de sengoku amènent à la constitution de pouvoirs locaux, les daimyô, dont la nature économique originelle adopte de plus en plus des atours militaires, dans une société où les guerriers, bushi, incarnent une sorte d’idéal ancré dans le temps comme dans l’espace ; dimension essentielle, mais qui ne doit pas négliger, d’une part l’existence de tensions éventuelles dans cet ancrage local même (sans doute d’autant plus à mesure que l’image traditionnelle du guerrier à cheval, maîtrisant l’arme blanche, doit composer avec le paysan soldat, puis avec le soldat spécifiquement entraîné pour manier les fusils – l’art de la guerre en étant comme de juste bouleversé), d’autre part la perpétuation d’autres réseaux avec lesquels le pouvoir, qu’il soit central ou local, doit composer, ainsi d’un certain nombre de « solidarités horizontales », sensibles à la ville comme au village, ou dans le cadre des monastères bouddhiques, a fortiori à mesure que des sectes plus militantes se développent.
L’acheminement vers l’État moderne, conçu par Tokugawa Ieyasu dans la foulée des tentatives avortées mais cruciales d’Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi, résulte directement de ces complexités féodales et, tout en instaurant un pouvoir central fort, avec le Bakufu implanté à Edo (future Tokyo), doit composer avec des réalités féodales qui ont favorisé son ascension, mais peuvent sans doute à tout moment accaparer la réalité du pouvoir ; les institutions s'adaptent, qui tentent de contraindre l'aristocratie provinciale à la résidence à Edo, équivalent nippon, peut-être, de la domestication de la noblesse par Louis XIV la rassemblant et soumettant à Versailles. Le paradoxe essentiel s'inscrit dans cette problématique – dans la mesure où ce Japon moderne résulte d’une pacification rendant la dimension militaire des pouvoirs locaux peu ou prou obsolète ; les daimyô n’en exercent pas moins le pouvoir au niveau local, et leur prestige et influence demeurent, voire s’accroissent en temps de crise (car, sur les deux siècles et demi de l’ère Edo, si le caractère étonnant de ce Japon « pacifié » correspond bien à une réalité, les tensions n’en demeurent pas moins, qui s’expriment à l’occasion – ou travaillent le régime de manière plus insidieuse). Par ailleurs, l’isolement dont, dans une perspective très occidentale, on a fait un voire le trait essentiel du Japon de l’ère Edo, s’il contribue indéniablement à la définition de cette société pacifiée, doit sans doute être pondéré – d’autant qu’il était moins intransigeant qu’on ne le dit (il faut revenir ici sur la « science hollandaise », notamment) ; il est toutefois intéressant de voir, dans cette perspective, comment la lutte contre le christianisme au Japon (par ailleurs tourmenté entre catholicisme et réforme, Portugais et Espagnols d’un côté, Hollandais et Anglais de l’autre) s’explique peut-être par un potentiel d’agitation déjà perçu comme menaçant et à traiter avec une vigueur adéquate dans le contexte des sectes bouddhiques florissantes de la période féodale – participant de ces solidarités alternatives illustrant à leur manière le caractère non-absolutiste des pouvoirs politiques traditionnels, central ou locaux.
Mais la dynamique essentielle demeure celle du centre et de la périphérie. En fait, dans cette optique, c’est bien là que se trouvent les raisons profondes des bouleversements de l’ère Meiji : il ne faut pas exagérer le rôle de l’ouverture au monde extérieur (Reischauer, dans le cadre de son essai, y insistait sans doute un peu trop – mais il est vrai que l’optique initiale de son Histoire du Japon et des Japonais l’y incitait tout naturellement) ; il ne faut pas davantage leur conférer une dimension proprement « révolutionnaire », guère dans les intentions des protagonistes du drame (ce qui explique sans doute le caractère largement « pacifique » du bouleversement – car bouleversement il y a eu, mais sans véritablement de motivations idéologiques conduisant aux violences irrépressibles entre adversaires défendant des points de vue radicalement incompatibles, comme en France plus tôt, en Chine et en Russie plus tard). À bien des égards, la chute du pouvoir shogunal, le Bakumatsu (qui n’est pas pour autant véritablement regain d’autorité de l’empereur, ce Meiji alors très jeune – et quoi qu’en en fait la légende), est ici l’illustration ultime et la plus frappante de la thèse au cœur de l’ouvrage, où les tensions entre le centre et la périphérie justifient bel et bien les changements les plus fondamentaux, tout en les inscrivant dans la continuité nécessaire d’un « temps immobile ». Le récit des événements de la période 1853-1871, plus précis sur le plan factuel que tout ce qui précède, s’avère véritablement passionnant ; les ambitions, surtout, des principautés du Sud-Ouest (Satsuma, Chôshû, Tosa…), aussi incompatibles soient-elles parfois, s’associent cependant pour constituer véritablement la « rénovation de Meiji »… et, comme de juste, ont sans doute des conséquences inattendues, en appelant une nouvelle fois à la redéfinition de la dynamique centre-périphérie – éventuellement au point de jouer en définitive contre ces ambitions premières : en résulte en effet une réforme militaire jusqu’alors peu ou prou impossible, tandis que l’agitation locale conduit paradoxalement à une affirmation nouvelle du principe centralisateur. L’affaire est d’une extrême complexité, mais proprement fascinante – il faudra vraiment que j’approfondisse l’étude de cette période étonnante… C’est, en tout cas, de ce « Que sais-je ? », la partie qui m’a le plus intéressé, et de loin – si les événements en eux-mêmes, autant que leurs conséquences institutionnelles, ont quelque chose d’encore un peu flou pour moi, expliquant les éventuelles incertitudes ou imprécisions de ce résumé.
Quoi qu’il en soit, après un début intimidant, cette Histoire du Japon : des origines à Meiji, s’avère des plus satisfaisante, et pondère utilement quelques visions peut-être trop faciles de l’histoire de l’archipel, en insistant sur des dynamiques propres qui confèrent à l’essai un caractère autrement plus enthousiasmant que celui d’un simple résumé d’une matière figée par ailleurs. Il faudra que je poursuive, avec l’auteur, en lisant Le Japon contemporain ; par ailleurs, disposant maintenant de quelques données générales sur la matière, il me sera sans doute possible d’aborder des études plus spécialisées – c’est prévu, même si, dans le côté englobant, il me faudra aussi passer par A History of Japan de George Sansom, notamment. Autant dire que je n’en ai pas fini…