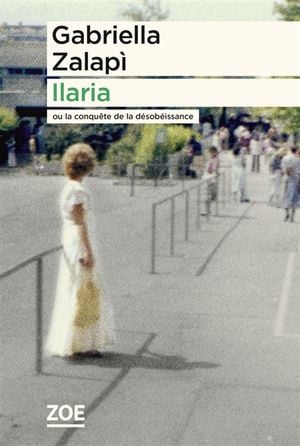Ilaria a 8 ans. Elle se rêve gymnaste. Suspendue la tête en bas à des barres métalliques, elle défie le monde sans y penser.
Elle ne comprend pas tout aux disputes de ses parents fraîchement séparés. Et encore moins pourquoi son père l’emmène, un matin, “juste pour un week-end”, sans qu’elle ait pu dire au revoir à sa mère.
Commence alors un long périple : de ville en ville, de route en route, enivrés par les effluves d’asphalte, d’essence… et de whisky.
Ilaria est arrachée à son enfance. À sa mère. À elle-même.
L’écriture est flottante, affranchie de toute logique apparente. C’est à nous de recoller les morceaux, de tracer les contours flous de l’étrangeté d’Ilaria.
Ses pensées sont éclatées, troublées, comme l’est la narration. On avance à tâtons, à la traîne de cette enfant qui vacille derrière un père désespéré.
Ce roman, lu presque d’une traite, m’a serré le cœur.
Tout y est silence, non-dit, flottement.
C’est justement cette pudeur qui rend le récit si fluide, si insaisissable, et si bouleversant.
Un seul reproche me vient à l’esprit : le titre.
“À la conquête de la révolte” laisse entendre une tension, un élan, une lutte. Or, chez Ilaria, la révolte reste rare, timide, tardive.
C’est moins un cri qu’un long égarement. Moins une conquête qu’un déracinement.