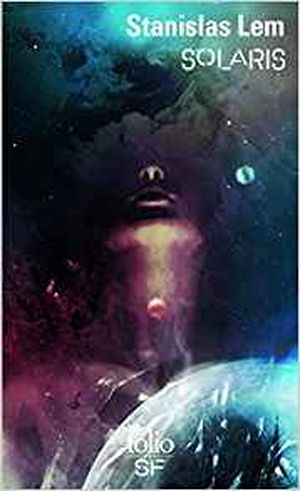Solaris est un classique de la SF des années 60, qui connaîtra une postérité fameuse sur grand écran puisqu’il y sera adapté deux fois.
Pourtant, à sa lecture, l’aspect cinégénique de ce roman ne paraît pas évident. Lem livre une oeuvre essentiellement contemplative, teintée d’onirisme, mettant en scène des personnages vivant l’action de l’intérieur et dont la confusion permanente éloigne toujours un peu plus les certitudes du lecteur. C’est pourquoi je suis assez curieux de connaître l’axe utilisé par Tarkovski pour son adaptation.
Outre l’aspect « thriller psychologique » présent au début et qui disparaît malheureusement trop vite, la dimension la plus remarquable de Solaris est sa précision technique, qui l’inscrit automatiquement dans la lignée des romans de « hard SF » qui se fondent sur la crédibilité des arguments scientifiques en mobilisant moult détails et développements. L’imagination de Lem n’a aucune limite et il déploie ici une créativité formidable dans sa description géophysique de la planète Solaris et dans sa chronologie imaginaire de l’historique des découvertes, entremêlés de controverses académiques et d’expéditions astronomiques.
Je reste toutefois un peu sur ma faim, d’une part parce que le coté hard SF m’a parfois un peu lassé et d’autre part parce que j’ai trouvé le versant thriller psychologique susmentionné vraiment sous-exploité.