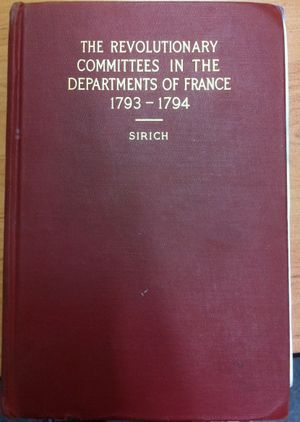Au contraire de la Guerre d'Indépendance américaine qui n'a qu'effleurée en superficie les mécanismes et les lois de la société des colons, la Révolution française a touchée, quant à elle, tous les engrenages de la société, c'est d'ailleurs ce que rappelle Condorcet dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain : elle a remis en cause la monarchie, les privilèges, la société d'ordre, elle a modifiée jusqu'aux relations qu'avaient les hommes entre eux. C'est donc tout naturellement que sa portée dépassa les simples frontières de l’Hexagone.
Quand, à l'aube du XXème siècle, le jeune historien Albert Mathiez s'imposa dans le paysage historiographique des études révolutionnaires, sa lecture de la Grande Révolution fut rapidement adoptée aux États-Unis, probablement en raison de la tradition républicaine qui animait alors les universités américaines. Dans les années 1930, ces universités devinrent même, avec l'Angleterre, l'un des principaux pôles étrangers de recherche sur la Révolution française.
Surveillance et police politique en l'An II
L'ouvrage, critiqué ici, de l'américain John Black Sirich, The revolutionary committees in the departments of France, 1793-1794, s'inscrit dans cette lignée. Paru en 1943, l'écrit est publié par la prestigieuse Université d'Harvard, qui avait acquise, quelques années auparavant, la bibliothèque d'Alphonse Aulard, premier titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne. Si le travail de Sirich est loin d'être exempt de défauts, il a le mérite de mettre en avant une institution peu connue des historiens, à l'époque : les comités révolutionnaires, aussi appelés comités de surveillance. En efft, cette institution, de première importance au temps de la Terreur, n'avait, jusqu'à lors, jamais fait l'objet d'étude sérieuse, à l'exception de quelques rares monographies. De par leur nature complexe, ces comités ont été longtemps décrier dans l'historiographie comme des instruments sanguinaires de dénonciations. Je vous invite à jeter un coup d’œil à cette très célèbre caricature emblématique de l'imaginaire lié à ces comités. On y voit des commissaires, armés de piques, jugeant partialement, une pipe à la bouche, le doigt accusateur, une jeune famille venue présenter leurs certificats de civisme.
L'étude de Sirich nous permet donc d'avoir enfin une idée plus sérieuse de ces comités, et qui plus est, à l'échelle du pays. S'étalant sur plus de 230 pages, l'ouvrage est divisé en quinze chapitres (introduction et conclusion comprises), auxquels se joint une annexe, bienvenue, des principales lois qui ont marquées les comités, à savoir celles du 21 mars (loi de création), du 17 septembre 1793 (loi des suspects) et du 14 frimaire an II (loi d'organisation du gouvernement révolutionnaire). Toutefois, un regroupement plus chronologique et thématique des chapitres aurait permis une lecture plus efficace et intelligente de l'ouvrage. Ici, la plupart des parties s’enchaînent sans véritables connexions entre elles.
Un champ novateur de recherches historiques
Dans une introduction peu commune, John B. Sirich balaie l'essentiel de l'historiographie révolutionnaire, jusqu'à lui bien entendu, et dresse un portrait peu flatteur des historiens français : ceux-ci auraient écrit leur interprétation historique depuis le Moniteur (pour rappel, "La Gazette Nationale ou le Moniteur Universel" est un journal officiel qui retranscrit les débats à l'Assemblée nationale) prenant au pied de la lettre les décrets de la Convention nationale, et supposant que le reste de la France se serait plié à tous les aspects de la loi. Ces historiens baseraient leur réflexion sur les seuls événements parisiens, oubliant ainsi les autres départements... A croire que l'auteur n'a pas eu vent de la thèse de G. Lefebvre, Les Paysans du Nord pendant la Révolution française, publié en 1924, ou des travaux d'autres historiens comme Sagnac ou Caron. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de faire le rapprochement entre les comités et la question centrale qui entoure la Terreur : à savoir, qui régnait dans les provinces, en l'an II ? Car étudier cette institution permet de comprendre les mécanismes de la Terreur, même si une telle analyse a ses limites : il explique que les archives et les sources sont bien trop nombreuses pour une seule personne, et qu'il n'a pu en visiter que quelques-unes : Lyon, Bordeaux, Marseille, Limoges, Rouen, Orléans, Dijon... En ne choisissant principalement que des grandes villes, il commet une nouvelle erreur, les comités étaient aussi présents dans les communes les plus modestes où ils pouvaient tenir un rôle important au sein du jeu politique local.
L'auteur explique qu'il ne faut pas s'arrêter à l'étude des textes, des lois, des ouvrages, mais qu'il faut directement aller voir dans les sources, regroupées au sein des Archives Départementales, pour avoir une idée de la réalité de la politique de Salut public de l'an II. Une attitude scientifique plus que louable que des historiens bien plus contemporains que lui auraient mieux fait d'adopter, à commencer par notre Furet national, mais c'est une autre histoire. Si l'on se tient à la loi de création de l'institution en mars 1793, les comités doivent surveiller les « étrangers ». Une lecture inattentive pourrait laisser penser qu'il s'agit de ressortissants d'autres pays, mais en analysant l'origine des personnes arrêtées, on remarque très rapidement qu'il s'agit bien de français, et que la notion « d'étranger » ne signifie pas forcément « étranger au pays », mais aussi « étranger à la ville, au département ». L'idée étant qu'un lyonnais de passage au Havre ferait bien de justifier rapidement sa présence en Normandie : raison commerciale, amicale, familiale ou... politique ? Vous me suivez ?
D'où l'intérêt d'être minutieux sur l'étude d'un tel sujet, une lecture partielle pouvant conduire à une erreur d'interprétation : cela arrive même aux plus "grands" historiens, comme Lefebvre dans son écrit, La Révolution française, publiée en 1930 : celui-ci avance que les comités restent, tout le long de leur existence (y compris après le 14 frimaire et la loi d'organisation du gouvernement révolutionnaire), sur leur mission de police, hors, Sirich explique qu'au contraire, leurs pouvoirs se voient étendus après cette date, et que certains comités vont largement dépasser le cadre d'une simple police pour jouer un rôle majeur dans la vie politique communale.
Si les premiers chapitres sont inévitablement liés, adoption et application de la loi du 21 mars, installation des comités dans les provinces, les autres chapitres, eux, sont indépendants. L'ouvrage recouvre l'essentiel des activités : la poursuite des étrangers, puis des suspects après septembre, l'application de la loi sur le Maximum, le contrôle du courrier et des passeports, l'attribution des certificats de civisme... mais l'historien s'intéresse aussi aux relations avec les autres autorités, locales comme nationales. Les derniers chapitres reviennent sur les lois de ventôse, Thermidor, l'ouverture des prisons et la disparition des comités.
La Terreur au village
John B. Sirich voit en la loi du 21 mars 1793, l'événement fondateur des comités. Il réfute donc ce qui deviendra la théorie d'Albert Soboul, à savoir que le Comité de recherches serait « l'ancêtre » des comités révolutionnaires. Cette loi vient, en réponse à une demande collective, légaliser une pratique déjà existante. Légaliser pour mieux contrôler ? C'est la théorie de l'auteur : la loi du 21 mars serait tout autant contre les étrangers que contre les sections de Paris, celles-ci possédant déjà leurs propres comités : la Convention nationale crée une institution sans réel pouvoir et fait perdre aux sections parisiennes le pouvoir qu'elles avaient gagnées avec la loi du 11 août 1792. Le but des Girondins était d'occuper les Comités révolutionnaires avec des routines plutôt que de les supprimer totalement, et ainsi de risquer l'émeute. Ironie de l'histoire, ce sont ces comités qui pourchasseront leurs créateurs, après leur chute des Girondins en juin.
L'auteur se penche aussi sur l'instauration des comités. Ils sont composés de 12 membres, à l'exception des plus petites communes, qui réunissent jusqu'à 7 membres. C'est surtout avec les mesures de septembre que les commissaires vont avoir une idée plus claire de l'institution et de leurs missions : le 5, la Convention fixe une indemnité à 3 livres par jour, le 17, une nouvelle loi est proposée, d'après un rapport de Merlin de Douai. Au fil des mois, un nouvel ennemi s'est dessiné grâce aux activités des comités départementales de Salut Public : les personnes hostiles à la Révolution. Les députés se doutaient qu'une propagande minime mais continue, dans les départements, pouvait préparer le terrain pour une attaque de plus grande ampleur. Le 17 septembre, c'est donc la loi dite des « suspects ». Les révolutionnaires ont préférés arrêter et enfermer leurs ennemis plutôt que de procéder de manière systématique à des exécutions de masse. L'auteur souligne que la question des suspects n'est pas nouvelle, elle avait déjà été abordée lors de l'Assemblée législative, et revient aussi en mars 1793, lorsqu'une délégation populaire demande à la Convention nationale qu'elle ordonne le désarmement de tous les nobles, prêtres et suspects. Le 12, un citoyen propose la levée en masse de tous les patriotes et que les suspects soient placés en arrestation. D'après J. Sirich, le problème de la loi du 17 septembre est qu'elle enlève les garanties légales que la Constitution de 1791 avait instaurée afin d'empêcher toute arrestation arbitraire. Cela s'explique par le caractère exceptionnel de ces mesures prises pendant le temps de la Terreur, mais aussi parce qu'entre deux, la Constitution est devenue obsolète : le roi est mort, l'Assemblée s'est radicalisée, et le contexte géopolitique a largement évolué. Une nouvelle constitution fut donc votée le 24 juin 1793, mais les circonstances ont faits, la "force des choses" comme dirait Saint-Just, qu'elle ne fut jamais appliquée. Institution tardive, les comités n'ont pas le temps de s'harmoniser, ils ne sont pas crées partout, et les limites de leur mission, mal définies par la Convention font que d'une commune à l'autre, la réalité du comité de surveillance peut changer. L'auteur note également un autre problème majeur : à qui doivent-ils rendre des comptes ? Ils travaillent officieusement avec le Comité de Sûreté Générale, mais ce n'est qu'avec la loi du 14 frimaire que l'erreur est réparée : la Convention les plaçant sous la tutelle de l'agent national du district.
En dehors de la chasse aux suspects, les comités vont toucher à de nombreux domaines de la vie publique. Ils s'établissent dans des locaux, certaines communes instaurent une section permanente, et les commissaires vont se relayer pour couvrir jour et nuit la commune. Certains commissaires seront chargés de l'écriture de procès-verbaux, ou d'adresses qu'ils enverront à l'attention de la Convention ou de l'agent national du district. J. Sirich s'intéresse aussi à l'attitude face à des événements nationaux, comme la guerre. Certains comités se donnent une mission de police militaire et traque les déserteurs, d'autres, comme celui de la section Fraternité à Lisieux, décident d'inventorier toutes les armes à vendre et d'interdire aux armuriers de les vendre, afin de les réquisitionner et de participer à l'effort de guerre. Les comités vont aussi jouer un rôle dans l'Ouest et la Guerre de Vendée, mais ils seront très vite dépasser car arrêter ceux qui pactiser avec les rebelles revient à arrêter énormément de monde...
Les événements du 9 Thermidor qui précipitèrent la chute de Robespierre et ses amis ne changèrent pas réellement l'attitude des comités, même si souvent les commissaires s'empressèrent de féliciter la Convention, autant par adhésion réelle que par crainte de représailles. D'après l'auteur, l'annonce de la chute des "robespierristes" ne les marqua pas plus que celles des Indulgents (Danton, Desmoulins) ou des Exagérés (Hébert). La politique des commissaires ne changea qu'à l'aube de Fructidor, même s'il est difficile d'affirmer si ce revirement se fit par conviction ou par opportunisme. L'ouverture des prisons ne se réalisa pas sans encombres, l'auteur avance que les suspects pouvaient dorénavant répondre des accusations faites à leurs encontre, ce qui obligea les commissaires à trouver des preuves contre des personnes qu'ils ne connaissaient à peine. Cette affirmation est à nuancer, les études récentes montrent que dans la plupart des cas, les comités ont agis avec extrême prudence, que chaque arrestation était précédée d'une enquête minutieuse, puisqu'il s'agissait d'arrêter des personnes que l'on côtoyait dans la vie quotidienne. Quoiqu'il en soit, la libération des suspects ne fut pas une tache aisée, certains comités refusant même d'ouvrir les prisons, la tache revint aux représentants en mission. Il était clair que pour les commissaires, en partie responsables des décisions locales prises pendant la Terreur, craignaient de devenir les cibles d'une réaction naissante.
Un chantier historique toujours en cours
Après lecture de l'ouvrage, nous ne pouvons nier que l'objectif de son auteur est louable : offrir aux comités de surveillance et révolutionnaires, un ouvrage attitré. Malheureusement, l'écrit de l'américain John B. Sirich est, aujourd'hui, dépassé. D'abord, parce que les comités sont, normalement, présents dans la quasi-totalité des communes de France. Dès lors, l'auteur, face à l'abondance de sources, se voit obliger de sélectionner les communes, et ne s'intéresse donc qu'à celles qu'il a estimé importantes (c'est-à-dire, celles qui furent amener à un jouer un rôle lors d’événements politiques majeurs) alors que les comités s'investissent aussi dans la politique locale des communes les moins connues, en s'insérant notamment dans la « triade municipale » (comité de surveillance, municipalité et société politique), ou à travers leurs relations avec les représentants en mission ou les autres autorités locales ou nationales. Il est évident qu'une seule personne ne pouvait prétendre à une étude si complète. C'est d'ailleurs l'objectif de l'enquête nationale, initiée par des chercheurs de la Société des études robespierristes, qui s'est ouverte à l'issue de la journée d'étude du 6 novembre 2002. Ensuite, en raison de la « jeunesse » des études scientifiques portant sur la Révolution, Sirich a composé son analyse en s'appuyant sur des recherches, parfois, peu sérieuses. On pense, par exemple, aux conventionnels envoyés en mission dans les départements : les noms de Carrier pour Nantes, de Tallien pour Bordeaux reviennent souvent... Ces mêmes noms que l'on a retrouvé régulièrement dans l'historiographie jusqu'aux travaux récents de Michel Biard.
The revolutionary committees in the departments of France, 1793-1794 est un ouvrage utile à son époque, car il vient combler un vide historiographique, mais sa lecture, pour les chercheurs d'aujourd'hui, est loin d'être indispensable.