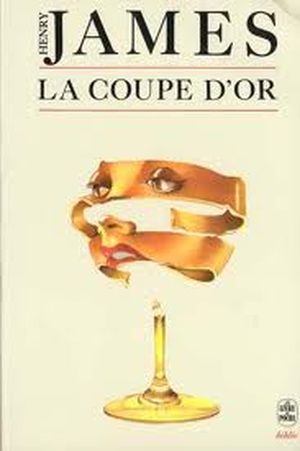La Coupe d'or surprend avant tout par son sidérant déficit d'incarnation : l'amour, les relations entre personnages, tout est vu de manière hyper-intellectualisée, la conscience de chaque protagoniste acquérant un espace propre, une géographie intime où s'ébat l'intrigue. Le monde matériel ne se rappelle que de loin en loin, à travers des objets symboliques (la coupe, en premier lieu) et donc également « intellectuels », qui font sens en dehors de leur existence concrète. L'attirance charnelle et tout le potentiel de sensualité qu'offre le thème de l'adultère s'effacent au profit d'un jeu complexe, savant, codifié, tout en non-dits, en conversations où rien n'échappe du sentiment vrai, en incursions prolongées dans la psyché de personnages qui entretiennent entre eux les rapports civilisés et désaffectés du financier mondain. Dans La Coupe d'or dominent la loi de l'intérêt, la séduction de la beauté pure, froide, et donc morbide. Les corps vivants évacués du récit, ne reste, à l'image du collectionneur Adam Verver, que le plaisir d'esthète devant une œuvre si parfaitement, si mortellement ciselée, avec une virtuosité d'orfèvre. Il y a dans le roman d'Henry James beaucoup plus d'artificiel que de naturel, artificiel autonome et comme détaché du terreau primitif, devenu pure construction de l'esprit humain, brillant mais glacé.
« Cette illumination n'était que de l'esprit, elle n'ouvrait de vastes perspectives que dans le monde de la pensée ; la perspective ouverte au monde des sens était bien différente. » (p.204)
Il est singulier de voir comme James, à défaut d'exploiter la matérialité du « vrai » monde –monde social tel qu'on le trouve représenté dans les romans français du XIXe, chez Balzac ou Flaubert par exemple–, donne à la conscience de ses personnages, à leur for intérieur, toutes les apparences d'un lieu : bien souvent la métaphore et la comparaison s'attachent à spatialiser la pensée ou l'être intellectualisé –la physionomie des protagonistes elle-même, les rares fois où elle est évoquée, s'associe à un parallèle architectural, à un bâti, analogie qui fait du character un endroit clos et habitable, où littéralement vit la conscience, qui est la conscience (la conscience est son propre habitat, elle existe en elle-même, en circuit fermé). Dès lors, tout visage devient une façade à examiner pour y voir les signes du trouble ou de la fêlure ; le visage ainsi symbolisé, surélevé par l'analogie, est le seul élément corporel saillant, affiché ; le reste se perd dans les plis et les drapés de la convenance. Si mouvement il y a, c'est sous la surface, dissimulé par une nécessité du jeu toute anglaise, par finesse et goût de la pénétration. Roman de l'analyse extrême, La Coupe d'or se laisse difficilement appréhender en ce qu'il n'offre que très peu d'aspérités. À l'image du Prince, jamais « anguleux », sa surface courbe et lisse (cf. p. 99-100) « ne trahi[t] la rosée bienfaisante que par une couleur un moment avivée ». La force et la faiblesse de l'œuvre résident dans cet art consommé de la nuance, de la lumière à ce point diffractée et décomposée qu'elle en dessine des figures illisibles, belles comme de purs objets d'art mais hors de portée.
« ... cette démonstration se placerait sur un plan très élevé, le débat se tiendrait dans l'atmosphère haute et fraiche de l'analyse la plus fine, de la sincérité la plus profonde, de la philosophie la plus large. Quels que fussent les faits à invoquer et à passer en revue, il ne s'agissait pour eux que de définir leur conduite à tous deux ... » (p.208)
Il sans cesse question d'explication à donner, de positions à définir, de se placer sur un échiquier en fonction des forces en présence ; toujours on parle et on pense, on cherche à percer le clair-obscur de l'autre et de sa propre intériorité, le roman devient un espace clos où l'on se dissèque encore vivant pour s'examiner et se regarder vivre. Dans l'analyse, on n'y trouve pas la fraiche candeur de La Princesse de Clèves, ses tâtonnements romanesques de genre encore débutant ; non plus la désillusion d'Adolphe, la prise de conscience du sentiment comme impulsion éphémère, l'expérience du récit de soi comme tentative de compréhension a posteriori ; Henry James, parvenu à un degré de sophistication sublime, à l'époque où une certaine forme de roman atteint peut-être son sommet en même temps que sa limite –avant Joyce et Proust–, tisse une toile étouffante dont on ne sort pas avant que chaque élément, correctement nommé et défini, ait trouvé sa juste place.