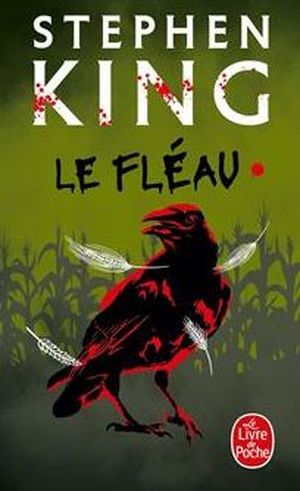Le quatrième roman de Stephen King, paru en 1978 et révisé en 1990 dans sa version complète, est un
roman d’apocalypse
où s’affronte le bien et le mal d’une manière assez manichéenne au premier abord. L’Amérique voit sa population presque entièrement décimée suite à la propagation accidentelle d’un virus créé par l’armée. Les rares survivants, disséminés à travers le pays, rêvent d’une vieille femme, et se réveillent terrorisés par d’effroyables cauchemars dans lesquelles apparaît un homme sans visage. Suspense, horreur, angoisse, les éléments qui ont fait la renommée du King sont bien là. Mais rien n’est jamais aussi simple et c’est derrière la forme que Le Fléau gagne à être lu : entre approche théologique et réflexion socio-politique, Stephen King décortique la société américaine du début des années quatre-vingt et son consumérisme déjà irresponsable. Des décennies plus tard, le fond est toujours d’actualité, et c’est bien là que le constat glace les sangs.
Tout d’abord, si le manichéisme pare le roman d’un aspect un peu simpliste, on se rend vite compte que la puissance narrative tient finalement là : Alfred Hitchcock parlait souvent de la nécessité de réussir son méchant pour réussir son histoire, Stephen King le sait aussi et l’Homme Noir qui hante les nuits de l’ensemble des personnages du livre, mieux qu’un méchant réussi, est le mal incarné :
L’heure de sa transfiguration était proche. Il allait naître pour la
deuxième fois, allait sortir du ventre en travail de quelque grande
bête couleur de sable qui déjà connaissait l’agonie des contractions,
écartait lentement les cuisses tandis que giclait le sang de
l’enfantement, ses yeux brûlés par le soleil perdus dans le vide.
Un être un peu fantastique, aux frontières du réel, sans âge et sans visage, qui, dans le premier livre d’une narration qui en compte trois, n’apparaît quasiment que dans les rêves, avec une bonne dose de surnaturel autour de ses déplacements et de ses actes. Et quand enfin il vit, quand il entre pleinement dans le réel, aucun de ces aspects ne disparait : lévitation, troisième œil, désincarnation, omniprésence et omniscience. Malgré son nom bien américain, il s’agit bel et bien d’un démon. Le diable en chair, palpable, froid. Et son antagonisme avec une prophétesse de Dieu, qui rassemble autour d’elle les bonnes âmes, renforce encore l’idée lancinante que ce diable arpente la terre pour s’abreuver de la colère, de la folie et du sang des hommes.
Les partisans du bien d’un côté, ceux qui se laissent berner par les promesses du démon de l’autre. Entre les deux, des limites floues : certains personnages se posent des questions, passent d’un camp vers l’autre, hésitent ou luttent intérieurement avec force, intensément. Le panel des survivants décrits par l’auteur lui offre les possibilités de nombreuses narrations, de nombreux cheminements et de nombreuses réflexions. Et lui permet d’explorer les différents visages de cet être supérieur que vénèrent les hommes :
Dieu était le chef des incendiaires
pour certains,
Dieu le créateur avait fait l’homme à Son image, ce qui voulait dire
que tout homme (et toute femme) qui vivait dans la lumière de Dieu
était un créateur d’une sorte ou d’une autre, une personne qui voulait
mettre la main à la pâte, donner au monde une forme rationnelle.
, ou encore
Dieu était joueur. S’Il avait été mortel, Il aurait passé son temps
penché sur un damier (…) Il jouait les Blancs contre les Noirs, les
Noirs contre les Blancs. Pour lui, le jeu valait plus que la
chandelle, le jeu était la chandelle.
Sans trancher, Stephen King laisse à ses personnages le soin d’explorer les facettes d’une force qui les dépasse mais dont ils ne peuvent nier l’existence. Croyant ou athée,
le lecteur se laisse submerger par la mystique du roman
qui lui confère une atmosphère particulière, qui rajoute à l’apocalypse.
Les différents personnages, dans ce contexte extraordinaire, évoluent enfin, eux qui depuis l’enfance étaient restés les mêmes,
Tu es parti comme un petit garçon dans un corps d’homme, et tu
rentres exactement pareil,
lui permettent d’explorer l’inertie de l’âme humaine dans son quotidien :
Tu as décidé que ça faisait trop mal d’aimer quelqu’un, qu’il était
plus sûr de ne vivre que pour toi. Et c’est ce que tu as fait,
toujours, toujours et toujours. Cette pièce. Tu ne t’es plus
intéressée qu’aux morts de ta famille et tu as oublié ceux qui
vivaient encore.
Ces évolutions post-apocalyptiques se font de manière linéaire pour certains : le mal s’envenime, le bien se renforce. De manières plus inattendues parfois, au plus proche de l’irrationalité humaine :
Personne ne peut dire ce qui se passe entre ce que vous étiez et ce
que vous devenez. Personne ne peut dessiner la carte de cet enfer
solitaire. Ces cartes n’existent pas.
Le second aspect, socio-politique, s’installe
dès le livre 2 : les survivants, d’abord seuls, disséminés dans l’immensité de ce pays ravagé, commencent de se regrouper. Que leur reste-t-il de cette société qui les a consumés ? Quelle voie choisiront-ils pour vivre ensemble ? Le personnage du vieux professeur de sociologie, en ce sens, est utile puisqu’il porte de bout en bout la réflexion de l’auteur :
La plupart des sociétés qui se formeront seront vraisemblablement
des dictatures primitives, dirigées par des petits Césars, à moins que
nous n’ayons beaucoup de chance. Quelques-unes pourront être des
communautés éclairées, démocratiques, et je vais vous dire exactement
de quoi auront besoin ces sociétés d’ici la fin du siècle et au début
du siècle suivant : elles devront disposer d’un nombre suffisant de
techniciens pour rallumer la lumière. (…) Toutes les machines sont là,
elles attendent que quelqu’un vienne les remettre en route (…) et tout
recommencera.
Stephen King, par la foule de personnages qu’il fait vivre, et malgré l’espoir porté par bon nombre d’entre eux, garde ce cap désabusé et cette vision sans illusion de la nature humaine.
Montrez-moi un homme seul, et je vous montrerai un saint. Donnez-moi
un homme et une femme, et ils vont tomber amoureux. Donnez-moi trois
êtres humains, et ils vont inventer cette chose charmante que nous
appelons la « société ». Donnez-m’en quatre, et ils vont construire
une pyramide. Donnez-m’en cinq, et ils vont décider que l’un d’entre
eux est un paria. Donnez-m’en six, et ils vont réinventer les
préjugés. Donnez-m’en sept, et dans sept ans ils vont réinventer la
guerre. L’homme a peut-être été créé à l’image de Dieu, mais la
société humaine a été créée à l’image de Son grand ennemi.
Le jugement est sans appel
et Le Fléau ne cesse de démontrer cette longue proposition.
En guise de conclusion, Stephen King nous rappelle la bonté et le désintéressement des sociétés primitives, la force des clans sans ampleur, qui ne croyaient qu’en un seul être supérieur idéal et le respectaient chaque instant en restant à son écoute : la nature. L’environnement. Il nous rappelle la modestie dont l’homme doit faire preuve face à l’immensité.
Fran comprenait pourquoi les peuplades primitives adoraient le
soleil. Depuis que la paix écrasante de ce pays presque vide devenait
de plus en plus présente pour elle, jour après jour, s’imposant avec
toujours plus de force, le soleil – et la lune aussi d’ailleurs –
avait commencé à lui paraître plus gros, plus important. Plus
personnel. Comme lorsqu’elle était enfant.
Il nous rappelle que l’écoute de son corps et la réflexion personnelle que chacun doit avoir quant à sa place dans son environnement est plus importante que quoi que ce soit d’autre, pour soi et dans son interaction à l’autre :
Dans plusieurs tribus amérindiennes, « avoir une vision » faisait
partie intégrante du rite de passage à l’âge adulte. Quand le moment
était venu de devenir un homme, vous deviez partir seul dans la
nature, sans arme. Vous deviez tuer un animal, composer deux hymnes –
le premier à la gloire du Grand Esprit et l’autre sur vos prouesses,
de chasseur, de cavalier, de guerrier et de baiseur – et enfin, vous
deviez avoir une vision. Vous ne deviez rien manger. Vous deviez
entrer dans un état second – mentalement et physiquement – et attendre
que cette vision se manifeste. Ce qu’elle finirait par faire,
naturellement, la faim étant un merveilleux hallucinogène.
Une mystique simple, à l’échelle de l’âme humaine, modeste.
Sans illusion cependant :
il se dit qu’il serait préférable (…) qu’ils s’en aillent un peu
partout. Retarder aussi longtemps que possible l’organisation. Car
c’était l’organisation qui semblait toujours être la cause des
problèmes.
Avec cette question pour conclure, qui se repose chaque jour qui passe, chaque jour que des puissants continuent d’opprimer les faibles, chaque jour que des fous sanguinaires continuent de massacrer leurs semblables, chaque jour que
l’homme confirme son statut de loup :
Crois-tu… crois-tu que les gens apprennent ?