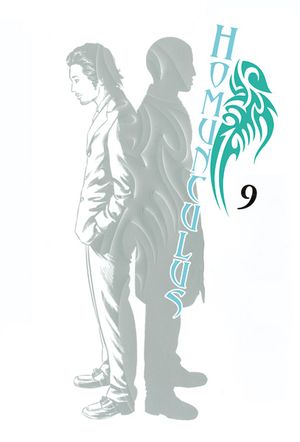Il s'agit du neuvième tome d'une série complète en 15 tomes. Il faut impérativement avoir commencé par le début de l'histoire, c'est-à-dire le premier tome. Ce manga est en noir & blanc, écrit et dessiné par Hidéo Yamamoto. Cette édition se lit dans le sens japonais, de droite à gauche.
Dans le bureau d'Ito, le face-à-face entre Manabu Ito et Musumu Nakoshi se poursuit. La nuit tombe, et leurs silhouettes n'apparaissent plus qu'en ombre chinoise. Nakoshi repose la question qui lui tient tant à cœur : Pourquoi est-ce moi que tu as choisi ? Ito contrattaque et questionne durement Nakoshi, avec des sous-entendus très critiques. Son homoncule se répand vers Nakoshi, en continuant de s'écouler par son entrejambe. Il marque un point important en exposant un fait que Nakoshi a gardé secret, et que lui a découvert dans son dossier médical. Par la suite, Nakoshi accompagne en voiture Ito pour qu'il aille rendre visite à son père à l'hôpital. Puis il retourne contempler l'océan. Enfin Nakoshi invite Ito à manger au restaurant, mais il lui impose sa tenue vestimentaire : maquillage, perruque, jupe, et talons hauts.
Après le long prologue tâtonnant du tome précédent, le lecteur débute ce tome un peu échaudé, mais aussi plein d'espoir, puisqu'Hidéo Yamamoto ne se répète jamais. La première partie déconcerte fortement du point de vue visuel. Les silhouettes des personnages ne sont que des masses noires, de vrais aplats de noir, sans aucun signe distinctif, si ce n'est la forme d'un œil de temps à autre. Dans une bande dessinée franco-belge ou un comics américain, le lecteur aurait identifié là un signe criant de fainéantise de la part du dessinateur, un raccourci graphique pour s'économiser. Du fait de la minutie maniaque des planches des tomes précédents, ici il sait qu'il s'agit d'un dispositif narratif choisi sciemment, symbolique et signifiant.
La narration de Yamamoto use de tous les dispositifs possibles pour faire ressentir des sensations au lecteur. Ici, la sensation qui prime est celle de l'obscurité et du vis-à-vis indistinct dans cette pénombre. Au fur et à mesure de l'avancée de l'obscurité, l'interlocuteur perd toute caractéristique visuelle pour ne plus être qu'une personnalité. En même temps, Ito et Nakoshi perdent leurs repères visuels, la possibilité de décoder les signes comportementaux de l'autre, toute la communication passe par le langage parlé les mots, les intonations.
Au bout de quelques pages, le lecteur est rassuré : Yamamoto a recommencé à nourrir sa narration, avec des informations substantielles. Ito abat quelques cartes de son jeu, une partie de ce qu'il sait de son cobaye. Son homoncule prend une forme provocatrice : la tête du guppy devient protubérante au niveau du bassin, comme un sexe en érection, alors que son fluide s'écoule en flaque vers Nakoshi. Yamamoto continue d'utiliser les fluides corporels comme des symboles, puisqu'en réponse à l'épanchement de l'homoncule d'Ito, répond la sudation à grosses gouttes de Nakoshi. La suite du récit emmène le lecteur dans 3 autres lieux : une chambre d'hôpital, le bord de l'océan et le restaurant dans lequel les 2 protagonistes ont l'habitude de prendre leur petit déjeuner ensemble.
Dans un premier temps, le lecteur éprouve le plaisir retrouvé d'une narration réservant plusieurs surprises avec un rythme qui ne donne pas l'impression de faire du surplace. La première partie est de nature essentiellement cérébrale, puisqu'elle se déroule entre 2 ombres chinoises informes ou peu s'en faut, Ito mettant Nakoshi face à des vérités peu confortables, développant le thème du mensonge consubstantiel de la vie en société, de l'obligation du paraître.
Par la suite, Yamamoto surprend son lecteur en s'abstenant de jouer sur le complexe d'Œdipe entre Ito et son père, et en mettant en scène cet étrange dîner où Ito est travesti en femme. Alors que cet élément pourrait sembler grotesque et une provocation gratuite, Yamamoto le pace dans un contexte où Nakoshi a décidé de changer de tactique pour interpréter l'homoncule d'Ito. Il lui propose d'adopter un comportement sortant de l'ordinaire, faisant écho aux propose d'Ito lorsqu'il s'adressait à Yukari (numéro 1775) dans le tome 4, en l'intimant de briser les modèles qui gouvernent sa vie.
Yamamoto joue avec le concept de thérapie cognitivo-comportementale, en amenant Nakoshi à contraindre Ito d'adopter un comportement radicalement différent. Comme dans les évocations psychanalytiques précédentes, Yamamoto fait en sorte de ne pas recourir au vocabulaire spécifique, et de montrer plutôt que de dire. Nakoshi dit même clairement qu'il est plus rapide de tripoter le corps que de tripoter le mental. Il évoque également le processus de projection (l'opération mentale, généralement inconsciente, par laquelle une personne place sur quelqu'un d'autre ses propres sentiments - Source wikipedia), les homoncules perçus par Nakoshi n'étant que le reflet d'émotions qu'il porte en lui, qu'il a déjà éprouvées. Il continue également de développer le décalage existant entre l'image que l'individu a de lui-même, et ce qu'il est vraiment, apprécié sur la base des actions qu'il accomplit.
Avec ces séquences, Yamamoto ramène le récit vers une narration efficace et intrigante, sans retrouver complètement la verve pénétrante des tomes précédents. Au milieu de ce volume, le lecteur découvre une séquence qui atteint le niveau d'intensité maximal. Cette séquence est d'autant plus remarquable qu'elle repose sur le montage de cases figurant dans des tomes précédents. Nakoshi se remémore quelques fragments de sa vie, à partir de souvenir déjà évoqués. Chaque case est recouverte d'une trame mécanique qui la fonce pour attester du statut de souvenir, et de recopie de cases déjà lues. Cette séquence montage de 12 pages est rehaussée par quelques remarques concises de Nakoshi. Il procède ainsi à une analyse d'un trait dominant de sa vie en en juxtaposant plusieurs moments.
Le lecteur éprouve cette révélation comme s'il était lui-même Musumu Nakoshi, la compréhension d'un facteur éclairant d'un jour nouveau une facette de son comportement. Cette séquence est d'autant plus intense et poignante que Nakoshi perçoit que ses triomphes matériels, ses joies de vainqueur ne l'ont pas rapproché du bonheur, et constituent autant de symptômes de son mal-être. Il pousse même le bouchon un peu plus loin dans la direction de la psychanalyse en faisant observer à Nakoshi que son mal-être est associé à son absence de sensation, comme s'il ressentait le monde extérieur comme à travers un film plastique.
Après une phase d'observation laborieuse dans le tome précédent, Hidéo Yamamoto retrouve une narration plus agréable pour le lecteur (plus d'informations, plus de surprises, plus de changements de lieux) pour la suite du décorticage de la personnalité de Manabu Ito. Il évoque d'autres courants thérapeutiques, sans les nommer ni recourir à leur vocabulaire, grâce à une maîtrise remarquable de la mise en scène, de la direction d'acteurs, du langage corporel et des décors. Il subsiste dans ce tome quelques passages un peu convenus (Manabu Ito se débarrassant de toute sa quincaillerie et de son maquillage, ou son travestissement).