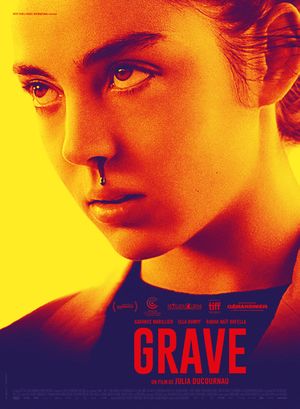Ici vous pouvez spoiler !
Commençons par ce que Grave réussit, et ce n’est pas rien.
Le cliché un peu fade de la famille végétarienne parfaite est très vite déconstruit, et derrière l’image proprette se cache un interdit plus profond : l’abstinence carnée comme barrage contre une pulsion incontrôlable. Ce n’est pas le respect du vivant qui motive ce régime, mais la peur de nuire — non pas aux animaux, mais aux humains. Et ce n’est qu’après coup que tout s’éclaire : la panique de la mère lorsqu’elle surprend Justine en train de consommer de la viande n’a rien d’une lubie diététique — c’est un cri d’alarme.
L’autre grande réussite du film réside dans son traitement de la violence. Il y a, dans cette esthétique du sang vif, une ironie macabre presque réjouissante. On pense à Tarantino — pas tant pour le fond que pour cette façon de rendre l’horreur étrangement ludique. La bagarre hallucinée entre Justine et sa sœur, où l’on passe de griffures à de véritables bouchées de chair, frôle le burlesque morbide. Et la bande-son, moderne et décalée, vient renforcer ce sentiment d’étrangeté contrôlée. Visuellement, c’est assumé, rythmé, jamais ennuyeux — bref, un film qui se regarde sans peine, ce qui n’est pas si fréquent dans le genre.
⸻
Là où Grave me laisse perplexe, c’est dans ce choix narratif autour du cannibalisme. Dès le début, le synopsis annonçait que Justine allait « découvrir sa véritable nature »… J’imaginais une exploration intime, un combat personnel face à une pulsion qui s’éveille, un chemin solitaire vers une part d’elle-même qu’elle ne comprend pas.
C’est en terminant le film que l’on comprend que cette « nature » n’est pas une quête intérieure ou un instinct qui se révèle, c’est une malédiction héréditaire, transmise comme un secret de famille, presque magique. Deux sœurs, cannibales de naissance, devenues comme des vampires insensibles à la douleur et folles dès qu’elles sentent le sang.
Or, le cannibalisme, dans la vraie vie, c’est bien plus prosaïque : un acte humain, dérangeant, marginal, mais humain. Les cannibales restent des hommes et des femmes, avec conscience, choix et limites. Ce n’est pas un réflexe incontrôlable ni une pulsion surnaturelle.
Alors, je me demande : si on fait un film sur un sujet aussi dérangeant, pourquoi chercher à l’expliquer par une pseudo-malédiction héréditaire ? Pourquoi ne pas assumer l’inconfort et la solitude d’une déviance qui n’a pas forcément d’explication ? Pourquoi ne pas montrer que certaines choses dans la vie, simplement, ne s’expliquent pas ?
À mes yeux, c’est justement ce qui aurait été plus fort, plus troublant, plus authentique. Prendre le parti d’un cannibalisme réel, brut, sans fard ni conte magique, c’est accepter de plonger dans l’inconnu, dans l’irrationnel, dans le dérangeant sans filtre. C’est ça qui choque vraiment, pas une génétique fantasmée qui allège un peu le poids de l’horreur.
Ce choix narratif, à mon sens, rend le film moins dérangeant là où il aurait pu être un choc véritable. C’est un virage qui m’a laissé sur ma faim, alors que tout le reste, visuellement et rythmiquement, tenait bien la route.