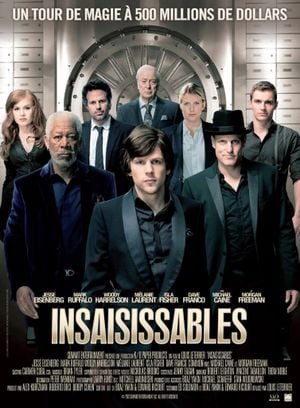Prestidigitation et volupté du faux-semblant
Un agent du FBI, épaulé d’un limier d’Interpol, se lance aux trousses d’une confrérie d’illusionnistes démiurgiques, auteurs de larcins spectaculaires dont ils redistribuent les butins à une foule médusée.
Une machination étincelante et jubilatoire
Insaisissables s’impose d’emblée comme une fresque vertigineuse, une mécanique de tromperie aussi scintillante qu’un miroir aux alouettes. Le film, animé d’une frénésie chorégraphique, déploie une mise en scène d’une vélocité éblouissante, où le moindre plan semble guidé par une baguette invisible. Le spectateur, convié à cette mascarade grandiose, s’y abandonne avec une fascination enfantine, oscillant entre incrédulité et jubilation. On assiste là à un grand spectacle hédoniste, un manège de prestidigitateurs hallucinants qui se jouent des lois de la physique comme d’un simple accessoire dramatique.
L’audace d’une idée : la magie au service du crime
Il faut saluer la malice d’un concept d’apparence saugrenue mais diaboliquement fécond : mêler l’art ancestral de la magie à la rigueur d’un braquage millimétré. Cette union contre-nature engendre une énergie singulière, un souffle carnavalesque. À travers ce scénario sinueux et scintillant, le film pose une interrogation à la fois naïve et obsédante — comment ont-ils fait ? —, question qui devient le moteur même de la fascination. C’est là que réside sa réussite : dans cette curiosité tenace, dans ce désir presque enfantin de comprendre l’impossible, tout en permettant qu’on le lui explique.
Un plaisir coupable, assumé et réjouissant
Certes, les esprits austères pourront relever, non sans acrimonie, les incohérences pléthoriques et la logique brinquebalante de l’ensemble ; mais à quoi bon ergoter ? Ici, la raison s’efface devant l’enchantement. Le film obéit à une grammaire propre, celle du merveilleux urbain, où « c’est de la magie, donc c’est possible » tient lieu de manifeste esthétique. Ce principe, d’un irrationalisme délibéré, confère à l’œuvre une saveur délicieusement régressive : on s’y grise comme un enfant devant un numéro de prestidigitation, conscient de la supercherie mais avide d’y croire encore.
Conclusion : la supercherie comme art suprême
Ce métrage ne prétend pas réinventer le réel, mais l’embellir par le mensonge. Il célèbre, avec emphase, la toute-puissance de l’illusion, ce théâtre du faux où la vraisemblance importe moins que la virtuosité. Œuvre ludique, clinquante et volontairement outrancière, elle rappelle que le cinéma, au fond, n’est jamais qu’un tour de magie bien exécuté — et qu’il n’est nul besoin de tout comprendre pour éprouver la griserie de l’émerveillement même si tout y est largement expliqué.