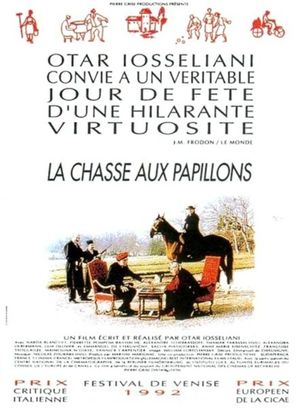Otar Iosselani, comme Jacques Tati, semble attaché aux détails du quotidien, ces petits riens qui caractérisent et humanisent les personages et qui donnent ici une dimension naturaliste au récit. Plus que Tati, qu'on a parfois taxé de réactionnaire dans sa critique du modernisme, Iosselani fait figure d'observateur rétrograde. Il oppose tout au long du film un mode de vie archaïque, au mieux traditionnel ou considéré comme un art de vivre, représenté par des villageois bien de chez nous et par deux chatelaines en particulier, à l'avidité capitaliste qui corrompt les moeurs. En l'occurrence, le château des soeurs Bayonnette risque, avec la complicité d'héritiers sans mémoire, de tomber aux mains des japonais, figures emblématiques de l'invasion capitaliste et du brassage de l'argent.
On peut facilement souscrire à l'idée du cinéaste. Cependant, la distance humoristique avec laquelle il aborde le sujet et les personnages est telle que l'un et les autres n'ont plus rien de cocasse. La mise en scène, minimaliste, est carrément soporifique, à tel point que le thème, pour qui n'adhère pas au style et au ton de l'auteur, ne présente plus aucun intérêt.