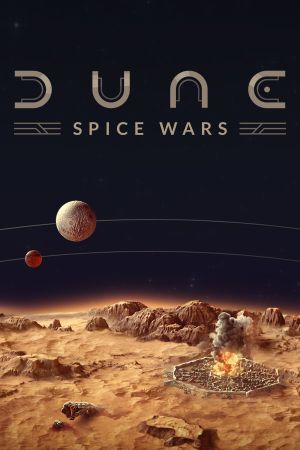(suite de Caca et Caca vol. 2)
Pourquoi y revient-elle ? Parce qu'il y a possibilité d'exploiter cette tendance, de l'exploiter économiquement (en faire une économie des circuits courts, une économie de la rentabilité) et cette possibilité est bien comprise par les sujets individuels et collectifs qui ont grandi avec la montée du capitalisme industriel et l'assomption de la culture consumériste ; ces sujets ont en effet été éduqués, orientés, encouragés à profiter des opportunités de cette exploitation sans aucun égard pour les dommages qu'elle entraîne (incurie, négligence, insouciance revendiquées en droit par l'idéologie du bonheur dont Jacques Ellul a parlé et dont il fait la marque distinctive du bourgeois : "Il nous est apparu que finalement deux caractères essentiels peuvent définir le bourgeois. Deux caractères qui se situent à deux niveaux différents : l'un idéologique, l'autre que nous pourrions appeler ontologique (...) Le caractère idéologique (...), c'est l'idéologie du bonheur. Le caractère ontologique, c'est le pouvoir d'assimilation." Métamorphose du bourgeois). La poursuite du bonheur, revendiquée comme droit au bonheur (c'est-à-dire comme droit au sens absolu : la question d'égalité depuis que les sciences sociales détiennent la vérité du fait social l'emportant sur toute autre perspective qui viendrait un tant soit peu la relativiser), fait sens, donne sens à l'existence, qu'elle soit individuelle ou collective. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Comment appréhender cette visée dont la positivité s'attache moins à l'accomplissement qu'au projet, à la tentative qui peut ne pas aboutir (mais comme le dit l'adage, l'important n'est pas la destination mais le chemin). Il s'agit d'une certaine croyance dans la capacité transformatrice de l'action et dans le fait qu'une liberté d'agir sera, pourra, devra être récompensée par la reconnaissance individuelle et/ou collective (reconnaissance qui vaut récompense et réalisation). Il y a une différence entre réussir et rater sa vie qui n'est pas donnée au départ (sinon dans les conditions matérielles qui déterminent les inégalités comme défaut, diminution de chances) et procède de la réalisation de l'individu par lui-même, réalisation qui peut dépendre de l'entourage et de la société mais dépend surtout de la pleine capacité à s'exprimer en tant que soi, expression qui définit la valeur ou la visée ultime. Le problème n'est pas que le bonheur puisse constituer une valeur mais qu'en s'installant dans les représentations cette valeur s'absolutise et devienne opposable au titre de prétention, au titre de droit. Indissociable de la promotion de l'idéal du bonheur est la reconnaissance de l'impératif d'égalité, donc de droit au bonheur. Chacun a droit au bonheur, du moins à sa possibilité, ce que contredisent les situations où l'on observe sans cesse davantage de malheurs, d'inégalités, d'impossibilité ne serait ce qu'à soutenir cette prétention. Il existe cependant pour les hommes une façon de s'arranger de cette contradiction et même de l'adopter non pas comme une contradiction mais comme une logique inversée : c'est parce que les inégalités sont omniprésentes que s'impose l'idée d'une égalité nécessaire. Une nécessité en droit qui répond à une observation des faits. La croyance, plus ou moins assumée, à laquelle tient cette logique inversée (une logique qui s'interdit en réalité de réfléchir un clivage de plus en plus fort entre les faits et le droit), c'est que l'action transformatrice est fonction du niveau de conscience. Plus nous aurons conscience des choses, plus nous serons à même d'apporter les corrections nécessaires, l'établissement de la justice : cette vue, qui est clairement celle du marxisme (une visée tranformatrice, pratique, concrète de la critique), tord le cou à la "conscience" pour la rendre efficace en la subordonnant à l'action (une action sans laquelle nous serions condamnés à rester coincés dans l'enfer de la philosophie bourgeoise). Mais parvenir à cette instrumentalisation se fait au prix d'une élusion : celle de l'aporie à quoi mène toute réflexion, tout effort de conscience visant à se coltiner ces questions de la liberté et du désirable au regard des montages complexes, de la dialectique (inscrite dans le langage comme lieu de réflexivité) du je et du nous propre à l'animal humain. La critique est supposée avoir un effet concret libérateur. Or (et ceci est connu depuis Socrate : les questions essentielles ouvrent sur des difficultés qui ne sont pas de simples obstacles, des défis lancés à la dialectique, à la logique ou la rhétorique, mais de véritables épreuves – i. e. des conditions indissociables de l'individuation entendue par Stiegler comme unicité de l'individu), cette libération n'advient pas et au lieu de réfléchir la dimension aporétique de ce constat, les progressistes de tout poil multiplient les explications rationnalisantes pour dissoudre l'écart, la prise en compte de l'épreuve dans la forme et le style de la pensée, dans les contingences historiques ; l'échec de la critique peut être alors relativisé : "tout n'est peut-être pas perdu", "les conditions peuvent changer", "de toute façon les gens finiront par se rendre compte", "il n'y a pas d'autre solution possible", etc. À l'arrière-plan de cette rhétorique se joue un subtil déplacement de la critique venant confirmer l'inversion, c'est-à-dire au fond l'indifférenciation de la cause et de l'effet (et cette indifférenciation vaut comme rapport au réel). L'action transformatrice s'est déportée vers les représentations, ce qui implique que l'espace représentationnel (les images dans la tête des gens) est investi comme espace réel, qu'il est accueilli et assumé dans une sorte d'homogénéité à l'espace où l'histoire a lieu. Le "véritable" domaine de l'action devient la représentation, et ce report obéit à la fois à une stratégie (l'échec est reconnu) et au caractère impératif de l'illusion, un "oui mais" qui restaure l'idéal mis à mal par le réel. Nous ne pouvons pas agir réellement (modifier le cours injuste, violent, destructeur des choses) mais en agissant sur la représentation, nous pouvons croire que cette impossibilité pourra un jour se muer en son contraire, que la conscience atteindra un niveau suffisant (une sorte de fait majoritaire) et que l'action pourra se faire. Il y aurait beaucoup à dire sur cette croyance (la façon dont elle fait immersion – dont elle fait masse – grâce notamment aux sciences neurocognitives – neuromarketing et autres sciences computationnelles), contentons-nous d'en observer la prégnance et le fait que le sujet capable de s'autodéterminer semble avoir cédé la place au sujet manipulable : le sujet défini par sa manipulabilité (manipulabilité parfaitement ambiguë dans la mesure où la manipulation sera soit négative, aliénante, ou positive, "émancipatrice" car résultant d'une déconstruction des conditionnements précédents).
Cette digression ne sera pas inutile pour appréhender l'ampleur du "mal de caca" qui ne se réduit pas aux avatars sériels de Dune. Mais il est peut-être temps, au point où nous en sommes, de résumer notre propos :
1. Nous observons dans les Dune 1 et 2 de Villeneuve une perversion du cinéma, une perversion qui n'a certes rien d'inédit mais qui prend un relief tout à fait significatif avec certaines analyses du cadre socio-techno-économico-politique qui a permis à un tel objet d'accéder à la reconnaissance du public et aux palmes de l'Académie.
2. L'amateur sériephile joue un rôle essentiel dans cette perversion qui le mande au titre de consommateur manipulable, de victime satisfaite et consentante. Il est ainsi la dupe d'un système qui prospère avec ses actes d'achat, ses abonnements à prix abordable, ses heures consacrées à des contenus plus ou moins distrayants qui lui permettent d'oublier (ses soucis) mais aussi de se rappeler que la vraie vie, c'est l'image (le spectateur est à la différence du petit poisson un être dédoublé, à la fois dans l'aquarium et devant lui).
3. Les plateformes (de streaming) jouent un rôle central dans cette perversion puisque ce sont elles qui ont inventé une nouvelle solution techno-économique d'exploitation des contenus télévisuels ; les séries (ambitieuses) qui existaient avant elles étaient produites dans le cadre d'un système économique rôdé (chaîne télévision câblée) mais présentant de nombreuses faiblesses : audience limitée, donc rentabilité limitée, croissance contrainte, modèle rigide, complexe, sans grande perspective d'amélioration... Les plateformes en instaurant l'accès immédiat et illimité ont réaménagé le "pacte sériel" et profité dans le même temps des possibilités offertes par l'analyse des données et métadonnées de connexion (qui "participent" de la fiabilité et de la sécurité du service technique) pour "améliorer" la qualité du contenu lui-même. Il s'agit en fait d'une mainmise du techno-économique et la création (qui prévalait encore dans le précédent modèle) n'est plus entendable qu'au sens de la communication ou de la publicité : une pure surface.
L'exemplarité du Dune de Villeneuve tient dans le fait qu'il dissimule autant qu'il donne à voir : c'est un jeu de bonneteau et si l'on prend un peu de distance, si l'on observe le jeu plutôt que les mouvements de gobelets qui ne contiennent plus rien, on s'aperçoit de sa transparence. Dune raconte l'histoire d'un peuple qui rencontre l'étranger, le messie qui va opérer l'avénement de l'illusion dans la réalité et mener ses membres par le bout du nez à coller à cette illusion jusqu'à la mort (le djihad). Jusque là nous avons affaire à un récit messianique sans grande originalité mais à partir du moment où ce récit devient un film, deux films d'une durée cumulée de plus de cinq heures, vus par une centaine de millions de spectateurs dans le monde, ayant coûté près de 400 millions de dollars et rapporté plus d'un milliard, le réel en son miroir avance sur la scène pour adresser la question rituelle : qui-suis je ? La réponse, double et doublement retorse, parlera aux amateurs d'énigme et de tragédie shakespearienne : Je suis ce que je suis en n'étant pas ce que je suis. Sachant que toute illusion cache (et révèle) une vérité, on pourra situer l'entreprise Dune du côté d'une (re)définition exemplaire de ce qu'il y a désormais à attendre de l'art de (ra)conter. Raconter des histoires, c'est mener en bateau des gogos à qui l'on vend sans coup férir l'illusion après laquelle ils courent comme s'il y avait là quelque morceau de choix, un or précieux qui éblouit par la distinction unique de son éclat. Or cet éclat n'est rien (on retrouve le "brillant sur le nez" du cas exposé par Freud). Le fétichisme c'est l'art d'ériger "l'objet en négatif, en creux, en absence" (Rosolato). Le pervers est dans la littérature psychanalytique (celle par exemple de Janine Chasseguet-Smirgel) celui "qui doit conserver le leurre qu'il n'a ni à grandir (puisque tel qu'il est il plaît à sa mère) ni à prendre la place de son père (c'est déjà fait). Ce qui permettrait au leurre de se pérenniser serait l'inexistence de la génitalité. En ce cas son illusion d'avoir pris la place du père — et donc de n'avoir rien à lui envier — serait parfaitement conforme à la vérité. On aboutirait ainsi à une entière abrasion des différences (entre l'enfant et le père, entre le petit pénis de l'enfant et l'organe génital du père) (...) Mais (...) le pervers n'est jamais totalement dupe du fait que son père possède un pénis avec des prérogatives et des capacités dont l'enfant est dépourvu. Aussi, pour sauvegarder l'Illusion, il devra faire passer son petit pénis prégénital pour un pénis génital, en l'idéalisant. A mon avis la création du pervers réalise cette fin : elle représente son propre phallus magnifié qui, faute d'une identification paternelle adéquate ne saurait qu'être factice, c'est-à-dire un fétiche." (J. Chasseguet-Smirgel, La maladie d'idéalité). Il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais on peut déjà souligner l'articulation entre l'idée de factice (le fétiche) et le déni de la castration (où la castration organise le deuil de la toute-puissance et instaure l'ordre symbolique de l'A(a)utre). Il y a différentes façons de constituer le fétiche mais l'idée perverse insiste sur sa "mise en fonction" dans une sexualité faisant du défaut de la reconnaissance de l'autre (reconnaissance supportée dans le vieux modèle psychanalytique par la différence des sexes) son positif (le positif d'une élusion et d'une illusion).
Deux aspects me semblent ici devoir être distingués : le premier relève de la constitution fétichiste, le second de la constitution perverse. Le premier insiste sur l'objet, le second sur la manœuvre (c'est-à-dire sur le "savoir" du pervers, qui comme le dit Chasseguet-Smirgel "n'est jamais totalement dupe" d'un certain travestissement de la réalité). Pour aller à l'essentiel et reprendre une perspective inspirée par la lecture de Pietz, je dirais que l'idée de fétiche doit être distinguée de la manœuvre perverse qui ne saurait en épuiser le sens ni le "problème" (pour reprendre le sous-titre du livre de Pietz) et que le savoir du pervers (ou celui de la perversion) est devenu comme la chimère, l'animal introuvable, en cela que l'"inexistence de la génitalité" qui pouvait autoriser la "pérennisation" du leurre apparaît, malgré le primat du fantasme en sa lumière déformante et trompeuse, comme un horizon possible sinon probable. Si je reprends ma conclusion (la sérialité revient infailliblement à l'objet et à l'enfance) je dois, pour la mettre en ordre, interroger l'adverbe dans sa dimension d'ironie. L'une des trois définitions de l'adjectif infaillible dans le wiktionnaire dit en effet ceci : "Qui ne peut ni tromper, ni errer". Il y a une complémentarité et une articulation entre le culte de l'objet en son absence et son destin de perversion que l'on pourrait lire comme une interprétation ironique de l'infaillibilité (et qu'on pourrait illustrer par le commandement : Tu tromperas ton prochain comme toi-même). La vérité nous revient infailliblement, non pas dans la signification positive, l'attestation qui la trouve conforme et fidèle à elle-même, mais dans la dimension de la Loi, celle de l'agir humain et de ses conséquences. La vérité est donc par définition rétrospective et négative (se donnant en défaut et comme le report d'une différence) mais le fait remarquable est la portée dialectique (au sens quasiment hégélien) de la maladie d'idéalité dans le succès (le destin) auquel parvient le pervers dans la rencontre du fétiche. Il y a une dimension structurelle de la perversion (2 à la place de 3) qui lui donne toute sa pertinence et son efficacité à notre époque accélérationniste. Pour que la stratégie du petit pervers réussisse, elle doit s'appuyer sur la complaisance de la mère qui se prête au fantasme incestuel, à l'idée qu'elle ait pu s'autoféconder en accouchant d'un enfant qui représente le pénis (le phallus) qui ne lui a jamais manqué.
Pour revenir au Dune de Villeneuve, l'élision de l'illusion (ce qui fait sa transparence, ce qui permet au joueur de bonneteau de continuer à jouer, de continuer à y croire) est inscrite dans le cadre de production, c'est-à-dire le programme, la structure de mise en image qui se substitue à l'adaption pour le cinéma. La différence entre cinéma et série pourrait être symptomatisée à travers la "modestie" exprimée par Villeneuve à l'égard du projet, une modestie qui retourne l'image du cinéaste mégalomaniaque aux ambitions démesurées (type Kubrick) pour donner à voir une autre position (une autre interprétation, plus sournoise, de la mégalomanie). Une position imposée par une industrie qui ne mise plus qu'aux conditions d'une calculabilité littérale. C'est une autre belle découverte qui me vient de Chaty (comme quoi, vive l'IA) : "Thomas Tull [fondateur de Legendary], entrepreneur dans la tech, a voulu appliquer une logique plus analytique à Hollywood : il a introduit l’analyse de données dans les choix de projets, une pratique encore peu répandue à l’époque. Legendary a démarré avec des productions comme Batman Begins (2005), en partenariat avec Warner Bros., et s’est rapidement imposée avec des blockbusters tels que The Dark Knight (2008), Inception (2010), Godzilla (2014), Pacific Rim (2013), et plus récemment Dune (2021) et sa suite." Lorsque je demande à Chaty de me préciser comment Legendary s'est servi de l'analyse de données sur le projet Dune, voici sa réponse : "Legendary Entertainment n'a pas communiqué publiquement sur l'utilisation spécifique de l'analyse de données pour le projet Dune. Cependant, l'entreprise a démontré une volonté d'explorer des technologies émergentes pour enrichir l'expérience des fans. Par exemple, en 2021, elle a lancé la collection Dune: Future Artifacts, une série de NFT inspirés de l'univers du film, en collaboration avec des artistes numériques et des plateformes spécialisées. Cette initiative visait à offrir une nouvelle forme de collection numérique, permettant aux fans de s'immerger davantage dans le monde de Dune (Communiqués de Presse & Relations Investisseurs [source]). Bien que cela ne constitue pas une utilisation directe de l'analyse de données, cette démarche reflète l'intérêt de Legendary pour les technologies innovantes afin d'engager son public. Il est plausible [je souligne] que des analyses de données aient été utilisées en interne pour orienter des décisions marketing ou créatives, mais aucune information publique ne le confirme à ce jour." Voici qui nous ramène à Philippe Huneman, Annie Le Brun et à la production algorithmique de l'usager et tout ceci au cœur du "cinéma". Pour finir sur la "modestie", il semble en effet que le cinéaste perverti soit un cinéaste empêché : il lui est impossible (comme il était possible à David Lean ou à Bondartchouk) d'avoir une vision et de porter cette vision à travers le temps, les obstacles, les aléas de production. Il lui faut se soumettre ou renoncer. Se soumettre aux méthodes de l'analyse de données certainement présentes dès la phase d'écriture et glisser sa patte entre les blocs de contrainte, pour répondre aux exigences de codification. La mise en scène ici n'a pas d'autre sens que celui qu'elle peut avoir dans la publicité ou le jeu vidéo : le metteur en scène est un chef d'orchestre qui met en musique un produit et attend le retour des ventes pour savoir s'il pourra continuer son travail ou pas.