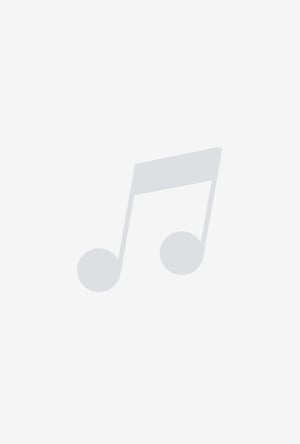Analyse des lieder de Franz Schubert
S'il est possible, dans le double domaine de la musique de chambre et de la symphonie, de tracer une histoire de l'évolution du style de Schubert, de noter les étapes de l'apprentissage qui mène à une exemplaire maturité, il en va tout autrement dans le domaine du lied. Des premiers lieder, à la ...
Afficher plus10 morceaux
créée il y a plus de 6 ans · modifiée il y a 4 moisEine Leichenphantasie, D. 7
19 min.
Morceau de Franz Schubert
PiotrAakoun a mis 8/10.
Annotation :
D7 - 1811
"Une fantaisie macabre" ou "Une fantasmagorie funèbre"
Son premier lieder composé à l'âge de 14 ans est un de ses plus long, (pas loin de vingt minutes) et révèle une maturité étonnante. Il est d'une profondeur bouleversante, on sent déjà toute la fougue et la nuance de ses compositions futures.
Si Schiller a écrit ce poème à la suite d'un événement de sa vie, il est raisonnable de supposer que Schubert, au même stade précoce de son développement créatif, était attiré par une poésie qui semblait faire écho à un aspect, particulièrement douloureux, de sa propre vie. Il est probable que le jeune compositeur, déjà perçu comme « différent » de ses frères et sœurs et de ses pairs, subissait certaines des mêmes pressions qui avaient poussé Schiller à souhaiter sa mort. La vie scolaire était rude et la vie familiale était difficile pour Schubert, comme elle l'a toujours été pour tout adolescent de 14 ans suffisamment adulte pour contester fermement les décisions de son père, mais impuissant face à l'autorité paternelle. Durant ses 8 années d'études à l'académie militaire, Schiller avait bien trop peu vu son père. On soupçonne que Schubert avait plutôt trop vu le sien.
Après une ouverture puissante, dès le deuxième verset, l'inspiration de Schubert faiblit un peu où on sent qu'il ne s'est pas encore libéré des schémas rythmiques instrumentaux conventionnels. On y trouve malgré tout d'élégants rebondissements et une ornementation efficace, il se montre, par exemple, déjà habile à illustrer le mouvement de l'eau. Ce sera un thème récurrent dans ses mélodies jusqu'à la fin de sa vie. La musique des trois derniers couplets est nettement plus originale que la plupart des couplets centraux de la ballade. La descente du cercueil par étapes (« der Sarg versinkt ») est rendue avec une grande précision, et même la répétition vocalement peu gratifiante de « mit dumpfem Geschwanke » oscille avec justesse tandis que la bière oscille et la cadence finale, malgré sa tessiture impossible, est d'une éloquence touchante.
Le langage lied du compositeur s'est formé au fil des ans, mais parfois, au milieu de ce qui est encore informe et confus, on devine la main partiellement formée du maître. C’est précisément parce que l’enfant est le père de l’homme que l’étude de ces œuvres de jeunesse est richement enrichissante pour les schubertiens.
Texte : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=58562
Der Vatermörder, D. 10
05 min.
Morceau de Franz Schubert
PiotrAakoun a mis 7/10.
Annotation :
D10 - 1811
"Le parricide"
Der Vatermörder raconte l'histoire d'un fils qui assassine son père. C'est une façon de résoudre ce qu'on aurait pu appeler, plus tard, le conflit œdipien. Il compose un poème tragique qui lui permet d'exprimer toute sa fougue et sa rage.
Der Vatermörder est la première des nombreuses mélodies de Schubert à empreinte mozartienne. La mélodie s'ouvre sur une longue introduction au piano où les syncopes et les arpèges de la main gauche citent l'introduction du premier air en si bémol de la Reine de la Nuit, « O zittre nicht ». Il est possible que Schubert ait connu cet opéra grâce à une partition vocale ancienne, mais la matérialité même de Der Vatermörder suggère qu'il l'a écrit avec le son du chant, dans une tessiture aiguë et audacieuse, qui résonnait dans ses oreilles. Il est étonnant de constater combien de fois le jeune Schubert extrapole à partir d'œuvres qu'il connaissait et admirait déjà, des analogies tonales pour des situations que l'on retrouve dans des ballades narratives de ce type.
Sa maîtrise est en devenir, et beaucoup de choses ici trahissent le jeune compositeur inexpérimenté : la tessiture (déraisonnablement aiguë et grave) rend la ligne vocale extrêmement exigeante, et l’écriture pianistique est en grande partie inerte. On se prive des subtilités de l’orchestration mozartienne, et le piano, dans cette ambiance, évoque un sous-Beethoven en mode Sturm und Drang. On cherche en vain l’humour, la fantaisie et la félicité de La Flûte enchantée elle-même. Au début du verset 3, on retrouve un écho des accords pointés lents qui ouvrent l’opéra et reviennent aux moments importants, et le quasi-fugato du verset 7 est sans doute inspiré par le contrepoint des deux hommes armés du finale de l’opéra. Le bégaiement du piano après les mots « stammeln liess » du verset 6 est une touche agréable et un moment de répit dans l’horreur. Certaines des figurations pianistiques, en particulier les ostinati qui visent à faire monter les émotions jusqu'à leur point d'ébullition, sont réutilisées dans Der Taucher, D77, une œuvre dans laquelle Schubert utilise avec beaucoup de panache toutes les astuces de mise en scène apprises dans ses ballades antérieures.
Texte : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=127303
Der Jüngling am Bache, D. 30
03 min.
Morceau de Franz Schubert
PiotrAakoun a mis 8/10.
Annotation :
D30 - 1812
"L'adolescent près du ruisseau"
Le poème est de Friedrich Schiller, célèbre poète de la période classique de Weimar, qui vécut de 1759 à 1805. Il peut donc être daté de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
Le poème décrit la mélancolie d'un jeune homme assis au bord d'un ruisseau, contemplant la fugacité de sa vie et de sa jeunesse. Dans le premier vers, il compare le ruban de fleurs déchiré qu'il avait tissé au bord du ruisseau à la rapidité de ses jours et à la disparition de sa jeunesse. Dans le deuxième vers, il ne demande pas à ses auditeurs la raison de sa tristesse. Il souffre, même si le monde qui l'entoure s'éveille et espère, seul son cœur est habité par une profonde tristesse.
Dans le troisième couplet, le jeune homme exprime son insatisfaction et son désir. Il ne ressent aucune joie devant la beauté du printemps, mais recherche plutôt une certaine « image fantôme », un être cher, ou une image idéalisée qu'il ne peut atteindre.
Dans le dernier vers, le « je » lyrique s'adresse directement à cette personne, fictive ou réelle, l'invitant à descendre de son « château fier ». Il lui promet les fleurs du printemps et présente l'harmonie de la nature et le confort d'une petite cabane comme suffisants au bonheur.
Le poème se compose de quatre strophes de même structure, chacune de huit vers, et présente une structure rimée claire (rime croisée). Le rythme est fluide et le ton est constamment mélancolique et nostalgique. Le langage choisi est sensible et vivant, avec de nombreuses métaphores de la nature qui reflètent les sentiments et les aspirations profondes du poète. L'utilisation du discours direct dans la dernière strophe confère au poème une touche personnelle et émotionnelle.
Dans l'ensemble, ce poème exprime la mélancolie et le désir juvénile. Il aborde la fugacité et le contraste douloureux entre la nature épanouie et pleine d'espoir et la tristesse intérieure et le désir inassouvi du moi lyrique.
Texte : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=47329
Totengräberlied, D. 44
02 min.
Morceau de Franz Schubert
PiotrAakoun a mis 9/10.
Annotation :
D44 -1813
"La chanson du fossoyeur"
Avec Ludwig Hölty, on assiste à une nouvelle collaboration. Schubert fera par la suite vingt-deux fois appel à des textes de ce grand poète du XVIIIe siècle.
Ce lieder marque le début de la fascination du compositeur pour ce que l'on pourrait appeler les chants du peuple ouvrier. Ces vignettes musicales nous transportent au-delà des salons et des palais viennois et nous transportent dans l'univers shakespearien de philosophes simples, naïfs et pauvres selon les critères de leurs maîtres, mais bien plus sages par leur appréciation pragmatique des vérités de la vie et des leçons à tirer de la simple observation.
Nous sommes habitués aux chants plaintifs et intenses des fossoyeurs chez Schubert, mais ici, grincements de dents et gémissements sont bannis, à moins que l'on puisse dire que cet homme peine à retourner son macabre butin. Le premier couplet est fait de fioritures gazouillantes au piano, comme si cette occupation n'était pas plus sinistre que celle de Papageno l'oiseleur. Le deuxième couplet commence en do majeur et passe en la mineur après trois lignes. Les corps sont évidemment enterrés à des endroits différents, et ce changement de tonalité illustre parfaitement la géographie du cimetière et le fait que le fossoyeur doit se déplacer sur son terrain pour nous montrer son trésor enfoui. L'interlude qui suit cette strophe comprend trois do d'octave puissants, profondément dans la basse, comme si une bêche heurtait soudain un os. Avec le troisième couplet, on retrouve des charmes féminins d'antan, qui initient un accompagnement séduisant en doubles croches d'une grande finesse. Dans l'interlude suivant, on identifie un pré-écho de l'accompagnement d'un chef-d'œuvre de 1825, Der blinde Knabe. On y retrouve des doubles croches exploratoires phrasées de la même manière à la main droite, et les mêmes croches staccato à la main gauche, comme si la canne d'un aveugle frappait le trottoir. La strophe finale est une répétition exacte de la première, incluant l'invocation ad libitum en mi mineur, et avec l'ajout de quelques mesures de doubles croches supplémentaires à la fin. Dans ces gruppetti en sol majeur précédés d'appoggiatures, on entend une autre chanson de 1825 prophétisée – cette fois Der Einsame. Ce motif, semblable à un rire discret, reflète le contentement d'un être extrêmement heureux de son sort.
Texte traduit : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=54584
Die Schatten, D. 50
02 min.
Morceau de Franz Schubert
PiotrAakoun a mis 9/10.
Annotation :
D50 - 1813
"Les ombres"
Dans Die Schatten, Schubert tente de jeter un pont entre ce qu'il a appris lors de ses exercices de composition en italien pour Salieri et le monde de la poésie allemande contemporaine. La perfection de Gretchen am Spinnrade n'a pas été atteinte sans pratique ; Die Schatten est l'un des premiers pas vers la culture de l'hybride que nous avons fini par accepter comme typiquement schubertien : la vieille déclamation allemande du Nord rigide est imprégnée de la chaleur du Sud. Voici une mélodie tout en courbes, en formes et en fioritures ; une ligne vocale souple est soutenue par des basses puissantes et un flux sensuel. Comme dans Der Parricide, la ligne vocale est dangereusement haute ; le compositeur n'avait pas encore suffisamment d'expérience des voix pour écrire avec attention pour elles.
Le compositeur de quinze ans se complique également la vie en choisissant comme texte un poème de circonstance pour la mort de son ami Charles Bonnet (1720-1793). Le vocabulaire inhabituel et la métrique saphique, difficile à traduire en phrases musicales de longueur égale, posèrent d'autres problèmes au compositeur. Dans l'ensemble, Die Schatten est une chanson étrange, qui possède néanmoins quelque chose de lyrique et d'éthéré grâce à une tessiture surnaturelle, de belles modulations qui commencent à être la marque de fabrique de Schubert et la forme asymétrique des phrases. Cette dernière caractéristique, fruit de la transformation de la poésie en prose, donne à la chanson un son improvisé et inventé sur le vif. Les croches fluides de l'accompagnement à la main droite, qui soutiennent et propulsent la ligne vocale, sont sur le point de sonner authentiquement schubertien. Le troisième couplet présente une section médiane plus rapide et plus forte, et une conclusion mélancolique où les mots « Himmlische Sehnsucht » ont une passion et une fin dignes du bel canto italien.
Texte : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=92422
Sehnsucht »Ach, aus dieses Tales Gründen«, D. 52
04 min.
Morceau de Franz Schubert
Annotation :
D52 - 1813
"Nostalgie"
Cette mise en musique de Schiller date de 1813, celle du Pèlerin D794 de 1823. L'écart entre les deux n'est que d'une décennie, mais le contraste musical entre le Sehnsucht du compositeur de seize ans et celui du Pèlerin de vingt-six ans est énorme. Il est également très instructif de comparer cette mise en musique de jeunesse du Sehnsucht, section par section, avec la remarquable deuxième version composée en 1821 (D636). Huit ans séparent ces deux mélodies. À l'exception de versions différentes de certaines paroles de Mignon (1815 et 1826), ces deux mises en musique sont séparées par un plus grand fossé de temps, d'expérience et de style que n'importe quelle autre paire de mélodies de Schubert partageant le même texte.
Texte : https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=47327
Erlkönig
04 min.
Morceau de Franz Schubert
Annotation :
1815 - op.1 (D.328)
Der Erlkönig (Le Roi des aulnes en français) est une adaptation musicale du poème Der Erlkönig de J.W. von Goethe.
Le personnage de l'Erlkönig est très représenté dans la littérature allemande, décrit comme une créature maléfique qui hante les forêts et entraine les voyageurs vers la mort.
Les thèmes développés dans le poème sont typiquement romantiques : la mort, la nuit, le fantastique, la peur, la forêt. La musique s'en ressent, en tonalité de sol mineur, sérieuse, profonde et tragique. Le caractère de la musique change pour chacun des personnages représentés.
Un seul et même chanteur interprète alternativement quatre personnages différents : le narrateur, aux première et dernière strophes, l'enfant, der Erlkönig et le père de l'enfant. Pour distinguer les différents personnages, le compositeur a joué sur le mode, le registre (hauteur de la partie chantée), ainsi que la nuance de chaque partie :
- le narrateur est chanté dans le registre du baryton, en mode mineur. C'est lui qui annonce la mort de l'enfant.
- l'enfant est chanté dans le registre du ténor (notes aiguës), en mode mineur, et toujours forte, pour signifier la détresse, la souffrance et la peur. Chaque nouvelle apparition se fait un demi-ton plus haut que la précédente, ce qui en accroît la tension émotive.
- Der Erlkönig est chanté dans le registre du ténor (notes moyennes, chantées presque en voix de tête), en mode majeur, sur une mélodie douce et suave, pianissimo, en accord avec les paroles séduisantes du personnage fantastique.
- le père chante dans le registre de la basse, en mode majeur et mineur. Il représente le lien à la réalité, le secours rassurant de l'enfant.
Le piano joue un rôle important dans l'œuvre : les octaves et les accords en triolets de la main droite figurent le galop du cheval, alors que les gammes ascendantes (de six notes seulement) de la main gauche figurent le vent dans les branches. L'accompagnement prend un caractère berceur lorsque l'Erlkönig tente de séduire l'enfant.
https://www.lexilogos.com/allemand_goethe.htm (paroles traduites)
https://www.youtube.com/watch?v=ebAZ6d5Q-ek
(Ernestine Schumann-Heink / Katherine Hoffmann, 1913 & 1929)
https://www.youtube.com/watch?v=PaBNUzVSnj8
(Dietrich Fischer-Dieskau / Gerald Moore, 1958)
https://www.youtube.com/watch?v=VjZRDHvncHU
(Jessye Norman / Phillip Moll, 1984)
Gretchen am Spinnrade
03 min.
Morceau de Franz Schubert
Annotation :
1814 - op.2 (D.118)
Gretchen am Spinnrade (Marguerite au Rouet) est tiré de la première partie de la célèbre tragédie dramatique Faust publiée par Goethe en 1808. Le poème constitue à lui seul une scène toute entière, intitulée Gretchens Stube (La Chambre de Gretchen). Au début de l’ouvrage, Faust ― qui a vendu son âme en échange des jouissances du monde ― rencontre la jeune Marguerite (Gretchen) et demande à Méphistophélès (Le diable sur terre) de la lui procurer. Les deux complices élaborent alors un plan pour séduire la jeune fille et finissent par la convaincre. Après quelques journées d’étreintes amoureuses, Faust se retire laissant dans le doute Marguerite. C’est là, seule assise à son rouet, qu’elle découvre les tourments du premier amour : «Mon âme est flétrie; Adieu, mes jours de paix, et pour la vie, et pour jamais! Mon coeur, las de se plaindre, vers lui veut bondir; Ne puis-je donc l’étreindre et le tenir, et l’embrasser à mon plaisir. Dans son baiser, dût-on mourir!». Dans son arrangement, Schubert restituera de façon mémorabe toute la mélancolie amoureuse ressentie par la jeune fille. La mélodie est accompagnée au piano par une succession d’accords arpégés joués à la manière d’un ostinato, rappelant le ronflement des roues actionnées par la pédale mécanique. Ce lied deviendra célèbre pour ce fameux accompagnement imageant d’une façon très ingénieuse le son du rouet.
https://www.lacoccinelle.net/257281.html (paroles traduites)
https://www.youtube.com/watch?v=3oxbVz26gLQ
(Elisabeth Schwarzkopf / Edwyn Fischer, 1952)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ud_Lt2kvSc
(Gundula Janowitz / Irwin Gage, 1976)
https://www.youtube.com/watch?v=KqR3nhBplp0
(Barbara Hendricks / Roland Pöntinen, 2018)
Der Tod und das Mädchen
03 min.
Morceau de Franz Schubert
Annotation :
1817 - op.7 n°3 (D.531)
Der Tod und das Mädchen (en français La Jeune Fille et la Mort) est un lied dont les paroles, en allemand, sont tirées d'un poème de Matthias Claudius.
Ce lied commence par une introduction en ré mineur ; les huit premières mesures sont en 2/2. Au piano, les deux mains jouent des accords ; la main gauche joue deux notes à la fois, la main droite trois. Cette introduction est calme (pianissimo), lente (moderato, mäßig) et a pour thème musical la mort.
La « jeune fille » entre à la huitième mesure sur une anacrouse. Cette partie [A] est plus agitée que l'introduction, Schubert y indique comme tempo un peu plus vite (etwas geschwinder) et comme nuance piano. La partie de piano, qui joue des croches en alternant la main droite et la main gauche, est syncopée. Un accord diminué sur « ich bin noch jung » donne une ambiance fantastique. À la huitième mesure de la chanson de la jeune fille, sur le mot « rühre » (« toucher »), les croches s'arrêtent et le rythme de l'introduction réapparait. Puis une demi cadence amène un silence avec un point d'orgue. Cette seconde partie dure 13 mesures.
Cette partie [B] est la chanson de la « mort ». On revient au tempo initial. La tonalité est également ré mineur, mais se termine par RÉ majeur. La mélodie devient quasiment monocorde et ne change que très peu de notes. Le rythme devient lent et monotone. La mort chante sans laisser apparaître la moindre émotion, créant un contraste saisissant avec la mélodie essoufflée et désespérée de la jeune fille.
La coda est une répétition de l'introduction si ce n'est qu'elle est plus courte d'une mesure et est en RÉ majeur.