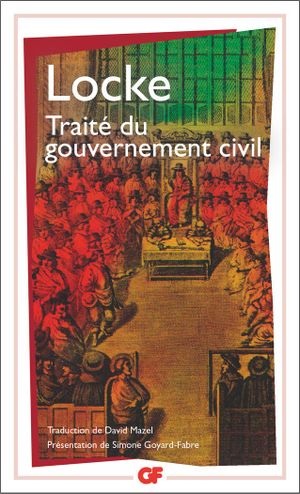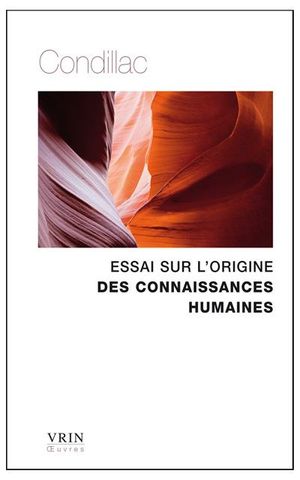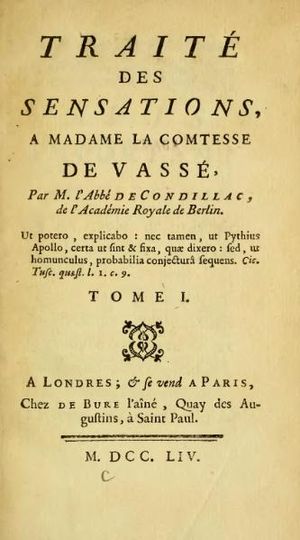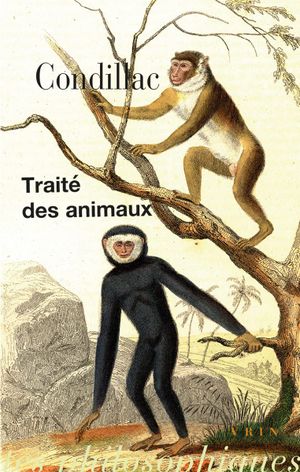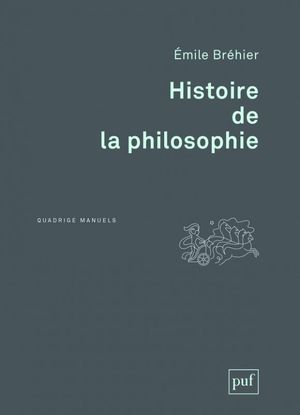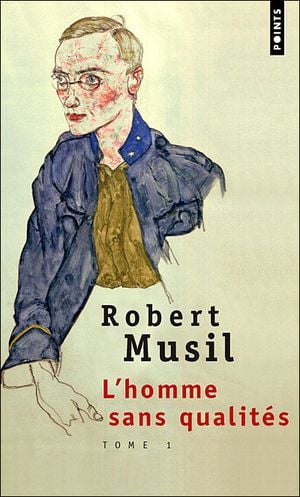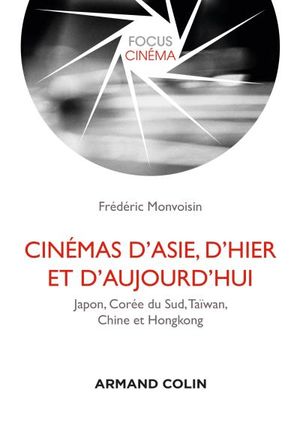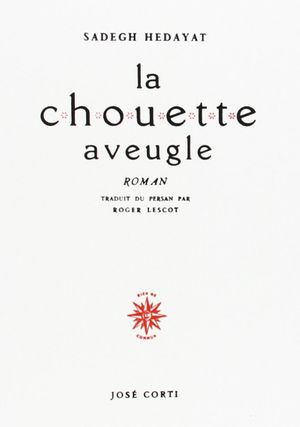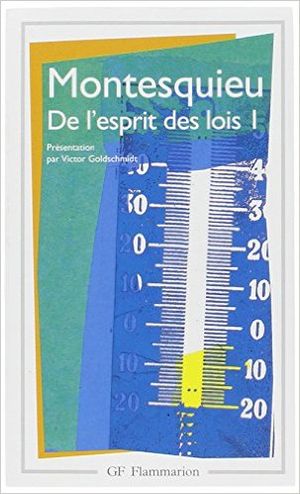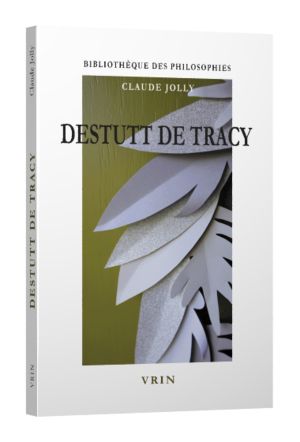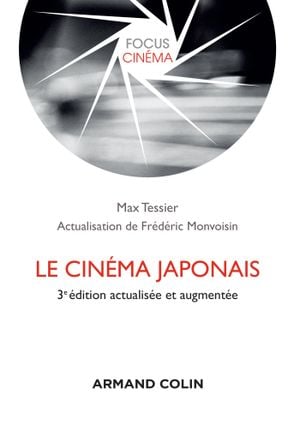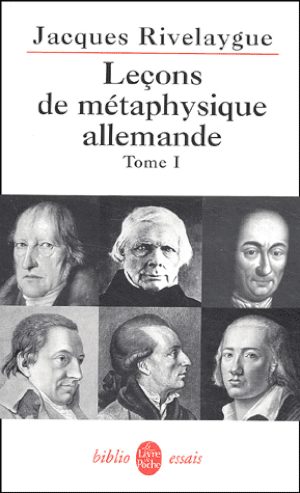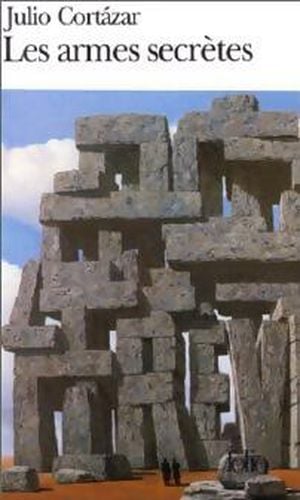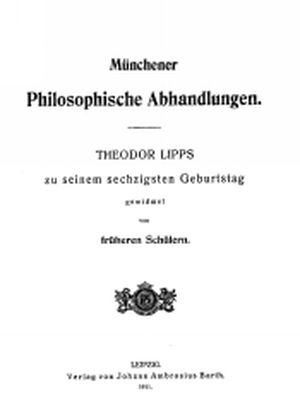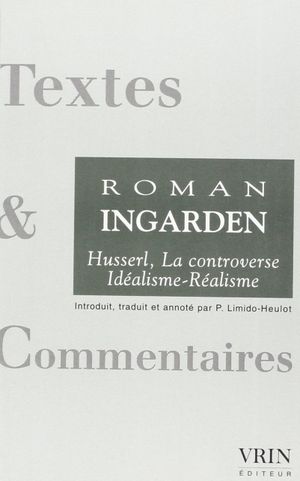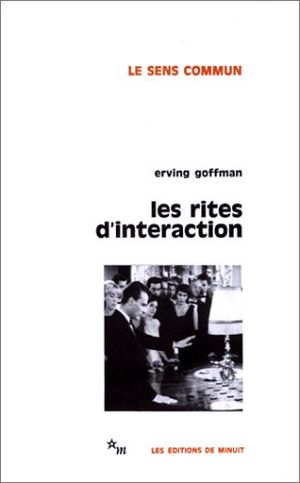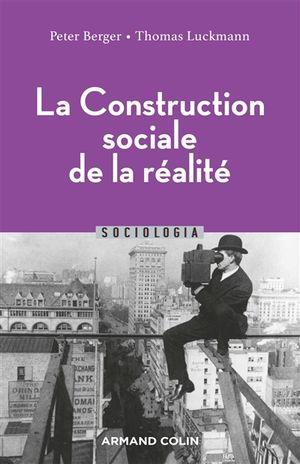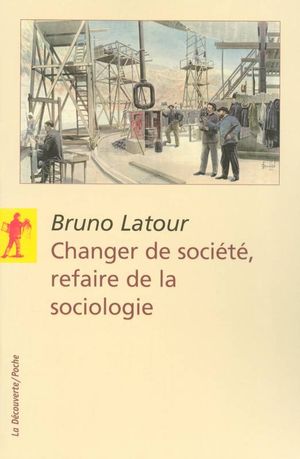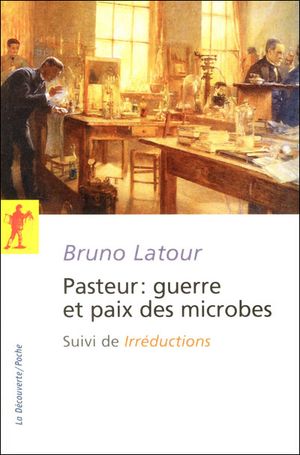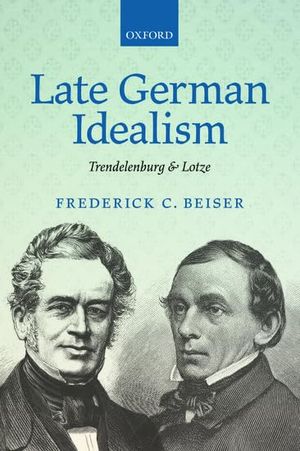App SC : moteur de recherche et partage d’œuvres améliorés. On vous en dit plus ici.
Lectures 2025-2026
Cette année : entrée en M1 à P1 en philosophie contemporaine avec un mémoire sur la question du réalisme dans l'oeuvre de Conrad-Martius. Deuxième année à Ulm. Moins de temps donc. Je fixerais la description à la fin de la période...
125 livres
créée il y a 6 mois · modifiée il y a 6 joursLocke
Sortie : 20 novembre 2000 (France). Essai
livre de Alexis Tadié
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Berkeley ne cesse de dialoguer avec Locke (voir liste précédente). Son oeuvre est un décalage assez subtil avec les grands principes de l'épistémologie lockienne. Grosso modo, il radicalise l'immanentisme lockien qui admet toujours un primat de l'idée.
Ce dialogue m'a poussé à me replonger dans Locke. Il y a toutefois un vrai problème avec l'EPEH, c'est un livre extrêmement long. On ne s'y plonge clairement pas comme cela. Sauf si on veut passer 2 semaines dedans, mais ce n'est pas mon cas. De plus, les éditions modernisées ne sont pas facilement trouvables en ligne, ce qui est assez étonnant. Etant en vacances, je me suis donc rabattu sur ce commentaire général de Tadié. Je suis souvent satisfait par les introductions des Belles Lettres.
Je pense que le livre remplit sa promesse. Il présente de manière relativement claire presque l'ensemble de l'oeuvre de Locke (il manque sur la question de l'éducation, et peut-être de la religion). Plus que ça, il propose une vision unifiée des deux aspects de la philosophie de Locke : l'épistémologie/métaphysique et la philosophie politique et juridique. Cette unification théorique est possible lorsque l'on se rend compte que Locke est avant tout un penseur de l'individu. C'est clairement ce qui fait sa modernité. Avec Locke, c'est le début du triomphe de l'individualisme.
Sur la philosophie politique, je ne trouve pas Locke très intéressant. Ce qu'il affirme, c'est clairement ce qui est devenu nos dogmes quotidiens. D'où un caractère assez évident et peu novateur pour nos yeux capitalistes. Je ne suis de toute façon pas très intéressé par la philosophie politique en général. Son contractualisme est clairement moins puissant théoriquement que celui de Hobbes. Il fait beaucoup moins peur. L'état de nature n'est pas un état de guerre... à partir de là, c'est moins drôle... Sur la tolérance, c'est sans doute plus aguicheur. Je trouve qu'on retrouve par bien des aspects le contractualisme faible de Rawls, qui admet toujours un primat de l'individu malgré le contrat. Ce qui implique de belles réflexions sur la désobéissance civile, le droit de résistance...
Sur l'épistémologie, Locke me parle bien plus. La recherche phénoménologique actuelle a bien saisi toute l'importance de la filiation entre empirisme classique et première phénoménologie. Ca constitue pour moi un très bon axe d'analyse pour la lecture de Locke, Berkeley et Hume, sans tomber toutefois dans l'anachronisme. Le retour au donné lockien est clairement prot
Traité du gouvernement civil (1690)
Two Treatises of Government
Sortie : 4 janvier 1999 (France). Essai, Philosophie
livre de John Locke
Holzfallen a mis 4/10.
Annotation :
Faute de pouvoir lire les EPEH, je me suis rabattu sur le second classique de Locke : le second traité du gouvernement civil. Honnêtement, j'ai rarement lu un livre aussi ennuyant et soporifique. Je n'ai lu que les chapitres qui me semblaient importants, et encore c'était franchement une purge. Ca ne m'a pas du tout intéressé. Sans doute parce que Locke délie complètement les questions anthropologiques des questions politiques, au contraire par exemple du Léviathan de Hobbes, bien qu'au final sa politique repose sur une anthropologie première. Mais celle-ci n'est pas explicitée.
Au moins, je pourrais dire que j'ai lu Locke...
Le Neveu de Wittgenstein (1982)
Wittgensteins Neffe
Sortie : 1985 (France). Roman
livre de Thomas Bernhard
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
Un peu plus du mal à rentrer dans celui-là. Pourtant il reste extrêmement similaire tant d'un point de vue narratif que stylistique aux autres romans des années 1980 de Bernhard. Ce n'est sans doute pas dû au livre mais à une lecture trop fragmentée et trop éparse. En tout cas, ça confirme pour mon hypothèse de la nécessité d'une lecture entière, en une fois, pour rentrer dans la dynamique de Thomas Bernhard.
Peut-être que le thème m'a aussi moins intéressé que dans Maîtres anciens et Le Naufragé. Si on a toujours deux artistes/philosophes ici, il est moins question de l'autorité intellectuelle et culturelle. Il s'agit moins de démonter des idoles. Je trouve le livre un peu moins anarchiste dans son propos que les deux autres que j'ai lu récemment. Mais, ça reste très bien.
Empirisme et métaphysique (2003)
L'Essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac
Sortie : 2003 (France). Essai, Philosophie
livre de André Charrak
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Lu un peu rapidement comme entrée en matière dans l'oeuvre de Condillac et plus particulièrement de l'Essai de 1746, dans ses décalages et ses continuités avec le tournant des années 1750. André Charrak semble être un très bon spécialiste de la philosophie du 18e siècle, c'est indéniable.
C'est un bon commentaire car il n'est pas aisé à lire. La plupart des commentaires de livres de philosophie visent simplement à faciliter la lecture de livres difficiles à lire pour des novices. Ces commentaires ne sont en réalité pas très féconds, c'est assez évident. Je préfère les commentaires qui complexifient, qui contextualisent vraiment les livres ou les auteurs dont ils traitent. Le Mauss de Karsenti en est un excellent exemple selon moi. J'ai du le lire deux fois pour bien saisir toute sa richesse. C'est un peu pareil ici. Charrak ne se contente pas d'un simple traitement liénaire des questions que posent l'empirisme sensualiste condillacien. Il remet en question sans cesse le propos de l'abbé. C'est ce qui fait la richesse mais aussi la difficulté de ce livre. Les vacances ne m'ont toutefois pas motivé à le lire une seconde fois en fichant. Je le referais plus tard...
Essai sur l'origine des connaissances humaines (1746)
Sortie : 1 octobre 2014 (France). Essai, Philosophie
livre de Étienne Bonnot de Condillac
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
J'ai donc enchaîné avec l'Essai sur l'origine des connaissances humaines. Ce qui plaît directement dans ce livre un peu obscur, qu'on connaît, mais qu'on ne lit plus trop, c'est vraiment, selon moi, la radicalisation du projet lockien. Il s'agit vraiment d'en finir avec les relents métaphysiques du premier empirisme anglais. La remise en cause de facultés humaines innées a quelque chose de plaisant et de rafraichissant. On retrouve un peu la même filiation qu'entre la phénoménologie transcendantale husserlienne et le kantisme des trois Critiques. Husserl opère une véritable dépsychologisation des facultés kantiennes. Condillac lui rejette l'innéisme tacite de Locke. Mais, cela ne l'empêche pas de rester dans une approche psychologisante.
En fait, je crois que de manière plus générale, j'ai vraiment lu Condillac d'un point de vue phénoménologique. Selon moi, on retrouve bien l'idée d'un retour au donné chez Condillac qui sonne très proto-phénoménologique. De même, sur l'idée d'une certaine neutralité métaphysique qui fait très Recherches Logiques. Condillac le répète à plusieurs reprises : il ne s'agit pas d'expliquer comment il est possible, physiquement parlant, que des sensations corporelles se "transforment" en idées cognitives. L'origine sensitive des idées est un fait brut qu'il s'agit simplement de décrire sans aucune adhérence à une vision idéaliste ou réaliste.
Condillac est aussi intéressant à lire en tant qu'il représente un peu un compromis bâtard entre représentationnalisme classique post-cartésien et un empirisme relativement radical. Ok, tout n'est que de la "sensation transformée" mais cela aboutit quand même à dresser une frontière entre moi et le monde, une image mentale au statut ontologique flou : l'idée. Cette fusion entre sémantique psychologisante et empirisme radical entraîne pas mal d'apories, plus encore que chez Locke. Sur ce coup là, je pense qu'il y aurait pas mal à tisser sur les liens entre la sémantique métaphysique de Bolzano, notamment sur le troisième livre de la WL et le sensualisme français... Reste une conception très instrumentale des signes et du langage qui n'est pas forcément compatible avec l'objectivisme sémantique du praguois...
Traité des sensations (1754)
Sortie : 1754 (France). Essai, Philosophie
livre de Étienne Bonnot de Condillac
Holzfallen a mis 6/10.
Annotation :
J'ai continué l'exploration de l'oeuvre de Condillac avec le Traité des sensations. Franchement plus aride, pour ne pas dire chiant, dans le style. Il s'agit vraiment de mettre en place une combinatoire analytique des cinq sens, ce qui n'est pas forcément le plus passionnant, du moins par moment...
L'entreprise reste relativement intéressante. L'idée d'un "Traité" des sensations est en fait très 18e siècle. Qui oserait affirmer maintenant pouvoir donner une vision synoptique et systématique des cinq sens. Il est clair que, face à la philosophie moderne, la philosophie contemporaine a renversé la polarisation de l'abstrait et du concret. Alors que pour Condillac c'est la division analytique des cinq sens séparés qui est le matériau le plus concret, la Gestalt la plus classique affirmerait que c'est la coordination circulaire des cinq sens qui est la donnée expériencielle la plus concrète.
L'expérience de pensée de la statue témoigne bien de cette recherche d'un concret abstrait ou d'un abstrait concret. Ce qui m'a pas mal plus, c'est l'idée d'immanence des quatre sens hormis le toucher. Il n'y a que le toucher qui permet une véritable transcendance, une véritable sortie de soi. Même la vue, comme dans la Théorie de la Vision de Berkeley, reste comme donnée simplement immanente. En résulte une nouvelle interpréter du problème de Molyneux, différence de celle de l'Essai. Alors que dans l'Essai, Condillac défendait une interprétation rationaliste du problème, il développe ici l'impossibilité d'un discernement des deux figures géométriques.
De manière plus oblique, les quelques paragraphes sur le bruit et le son m'ont aussi parlé, me rappelant vaguement ce qu'en disait Benoist dans Sans Anesthésie (je crois). La distinction du bruit et du son témoigne bien de la philosophie de la musique du 18e que les nouveaux réalismes d'aujourd'hui, anti-représentationnalistes, ne peuvent tenir.
L'ouvrage est quand même, sinon, assez chiant. J'ai abandonné au début de la troisième partie, j'avoue...
Traité des animaux (1755)
Sortie : 1755 (France). Essai, Philosophie
livre de Étienne Bonnot de Condillac
Holzfallen a mis 6/10.
Annotation :
Pareil pour celui-ci, j'ai fini par abandonner assez rapidement. Celui-ci m'a d'ailleurs posé plus de problèmes. J'ai eu plus de mal avec l'argumentation de Condillac contre Descartes et Buffon, et le réductionnisme mécaniciste en ontologie de l'animal. On voit bien quelles positions défend Condillac, mais j'ai trouvé son argumentation pas hyper convaincante.
Il faut toutefois bien voir en quoi cet ouvrage est un peu une oeuvre de percée. Contre Descartes et Buffon qui instaurent une séparation radicale entre l'animal et l'homme, Condillac restaure une continuité. En cela, on est plus proche de Leibniz. L'anthropologie philosophique pourra dès lors devenir une entreprise analogisante, qui pense l'humain comme l'animal différent, l'animal rationnel, l'animal plus un quelque chose. En cela, l'ouvrage est extrêment novateur. Reconnaître une âme aux animaux, ça reste très moderne.
Mobilisation totale (2015)
Mobilitazione Totale
Sortie : 17 août 2016 (France). Essai
livre de Maurizio Ferraris
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
Lire Ferraris m'a fait du bien après pas mal de lectures assez maussades... La stylistique philosophique du 18e siècle a en effet de quoi ennuyer certains, dont moi...
Ferraris écrit énormément depuis les années 1990. Il a pas mal évolué sur ces thématiques et ses positions donc c'est assez compliqué de savoir par où commencer son oeuvre. Je me suis porté sur Mobilisation totale pour plusieurs raisons : (1) Il est traduit en français et facilement trouvable sur Internet (2) Il fait partie de sa période néo-réaliste et il est censé illustrer les percées théoriques du Manifeste et de Documentalité (3) Il concerne la question du web et de son rapport à la réalité sociale. J'ai trouvé donc ça assez légitime comme entrée dans l'oeuvre de cet auteur qui est quand même une des grands stars de la philosophie actuelle...
Lecture aussi importante pour moi pour mon mémoire. J'espère en effet pouvoir faire toute une partie sur la confrontation entre la phénoménologie de la réalité de Conrad-Martius et les nouveaux réalismes de Benoist, Ferraris, Gabriel et autres (pourquoi pas Garcia et les ontologies orientées objets, le réalisme wittgensteinien de Conant et Diamond...). Je pense néanmoins que Ferraris ne sera pas l'auteur le plus facile à mettre en parallèle. La question de fond de son oeuvre récente porte quand même sur la réalité sociale, plus que sur la réalité comme thèse métaphysique, mais à voir...
Histoire de la philosophie
Sortie : 15 juillet 2004 (France). Essai, Histoire, Philosophie
livre de Emile Bréhier
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Sans doute LE manuel de philosophie en France. Ca fait plusieurs années que je travaille avec, lors de révisions, de découverte d'un auteur... Comme je suis sur le 18e siècle, je me suis dit que j'allais aller retravailler un peu le Bréhier.
Bréhier découpe la période en trois. 1700-1740, 1740-1775 et 1775-1800. Dans la première période, il range les sentimentalistes moraux (Shaftesbury, Hutcheson), Berkeley, Wolff, Vico et Montesquieu. Dans la seconde, on retrouve Condillac, Hume, Smith, Vauvenargues, les matérialistes français, Buffon, Diderot et les encyclopédistes, Voltaire et Rousseau. La troisième période est marquée par un déclin du rationalisme. On retrouve donc tous les sous-courants mysticistes, Lessing, Herder, mais aussi Thomas Reid et enfin un vaillant, qui continue : Condorcet. La période s'achevant en beauté dans l'oeuvre de Kant.
Bréhier est comme toujours très clair. J'ai pu cerner ce qui me donnait plus ou moins envie de lire dans ce que je n'ai pas lu. Je pense aller travailler très prochainement Thomas Reid, c'est vraiment l'auteur qui m'intéresse le plus sur cette période. Vico et Montesquieu m'intéressent aussi pas mal, mais entrer dans leurs oeuvres me semble plus compliqué que pour Reid, et aussi plus éloigné de mes thématiques de recherche...
Manifeste du nouveau réalisme (2012)
Manifesto del nuovo realismo
Sortie : 16 septembre 2014 (France). Essai, Philosophie
livre de Maurizio Ferraris
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Je voulais lire sur Thomas Reid mais le livre en question est introuvable ! J'ai donc continué avec la star de Turin de la philosophie.
Plus qu'avec Mobilisation totale, on a vraiment ici la meilleure introduction à l'oeuvre de Ferraris, en plus de lire une oeuvre extrêmement marquante pour l'histoire actuel et à venir de la philosophie européenne (et occidentale ?). Comme dans MT, le propos est très clair et structuré. L'arsenal conceptuel est toutefois moins développé. Il n'y ait pas encore question d'émersion... Le projet de Ferraris est en fait double : (1) Réfuter le "postmodernisme"dans toutes ses formes possibles (2) Proposer une philosophie réaliste relativement simple.
La réfutation du postmodernisme est assez convaincante, bien que mobilisant parfois des schèmes argumentatifs assez évidents ou déjà travaillés. Ce qui vraiment la richesse du réalisme de Ferraris, c'est qu'il en fait une réponse politique à un certain mal-être. Il s'acharne donc à montrer toutes les conséquences réactionnaires, conservatrices voire fascistes du postmodernisme le plus classique, pourtant développé par des intellectuels de gauche. Si le postmodernisme constructionniste/idéaliste mène à la guerre, il faut donc y renoncer, ou du moins le limiter.
A partir de là, Ferraris présente les grands traits de son "réalisme" : tripartition des objets entre naturels, sociaux et idéaux ; la distinction fondamentale de l'épistémologie et de l'ontologie ; le caractère absolument non cognitiviste de l'expérience esthétique et de la perception (inspirée par la gestalt italienne) ; réfutation de l'ontologie sociale intentionnaliste par une théorie de la documentation et de l'enregistrement... Sans revenir sur les thèses, le Manifeste présente donc un point de vue vraiment synoptique et programmatif sur les livres de Ferraris. Documentalité, Le monde extérieur, Âme et Ipad... sont largement cités.
Le livre reste parfois un peu rébarbatif, ça se répète un peu, surtout vers la fin et les arguments ne sont pas parfois les plus fins possibles. Mais, c'est normal, c'est un manifeste...
Le Monde extérieur (2001)
Il mondo esterno
Sortie : 2021 (France). Philosophie
livre de Maurizio Ferraris
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
J'ai continué Ferraris avec son premier livre véritablement réaliste de 11 ans antérieur au Manifeste. J'avais aussi dans l'optique que c'était celui qui pourrait être le plus proche de la perspective de Conrad-Martius. Et, en effet, il y a beaucoup de rapprochements à faire. Le traducteur Cyril Crignon affirme d'ailleurs qu'il y a filiation entre la philosophie autrichienne / le meinongianisme et la gestalt italienne qui est vraiment à la source de cet ouvrage. Bref, on a bien une filiation entre le néoréalisme de Ferraris et le meinongianisme tardif de Conrad-Martius. C'est encourageant comme rapprochement !
Comme le dit bien Benoist dans Réalismes anciens et nouveaux, ce qui fait la richesse de l'ouvrage, c'est la manière dont Ferraris prouve de différentes manières à quel point notre expérience perceptive est une expérience factive. C'est-à-dire que la perception est irréductible à toute prise doxastique ou conceptuel. Avant le concept, il y a le monde extérieur, dans toute sa facticité. D'où le titre de l'ouvrage. Le monde extérieur n'est pas une extériorité par rapport à une intériorié psychologique, comme le voudrait le réalisme un peu bancal de la philosophie moderne. C'est l'extériorité par rapport à nos schèmes conceptuels et à la science. Le concept d'extériorité me semble d'ailleurs être un point intéressant pour caractériser les nouveaux réalismes non spéculatifs. Gabriel, Benoist et Ferraris travaillent vraiment sur une refonte de la distinction de l'intérieur et de l'extérieur. Benoist par l'idée, mise en avant depuis Concepts, que le réel intervient autant en amont qu'en aval. Gabriel par une relecture de Frege qui essaye d'extérioriser et de publiciser encore davantage son objectivisme sémantique. Et Ferraris qui reprend un concept d'extériorité qui chercher à rendre compte de la différence irréductible entre épistémologie et ontologie...
Ce qui permet d'ailleurs cette différence, c'est ce que Ferraris nomme l'inamendabilité du réel. Concept tout à fait central, extrêmement intéressant, et encore une fois assez proche des vues de Conrad-Martius. L'auto-position décrite comme seconde condition du réel dans la Realontologie, n'est-ce pas à peu près la même idée ? Au contraire de la science, toujours révisable, qui se prend toujours dans une dynamique de tradition et d'innovation, de progrès en somme, Ferraris argue pour le caractère inamendable, non révisable de l'expérience du réel. Il s'appuie pour cela sur l'hyperréalisme gestaltiste de
La philosophie de Thomas Reid (2024)
Sortie : 2024 (France). Philosophie
livre de Angélique Thébert
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
Thomas Reid me fait de l'oeil depuis déjà bien longtemps. La sortie de ce Repères Vrin avait encore plus égayé mon intérêt pour la chose. Son utilisation pour penser le post-représentationnalisme (cf le séminaire de Benoist après la représentation) témoigne vraiment de la fécondité de Reid pour la pensée contemporaine... Bref, beaucoup de raisons pou lire ce Repères, malheureusement indisponible dans toutes les grandes bibliothèques universitaires parisiennes (hormis l'ENS, mais elle est fermée...). J'ai donc rusé : je suis allé à Gibert et j'ai dégainé mon téléphone pour scanner un peu subrepticement les 190 pages de cette excellente introduction...
Je suis très content d'avoir fait ça. L'introduction de Thébert est vraiment très bonne. Le format Vrin est très plaisant à lire je trouve avec cette tripartition entre vie / thèmes / oeuvres. Beaucoup de choses m'ont plu chez Reid, et je tarde de lire dans le texte les Recherches et les deux Essais.
Il y a tout d'abord la critique de la théorie représentationnelle / idéelle de l'esprit, théorie qui traverse absolument toute la philosophie moderne, des empiristes aux rationalistes. Il faut souligner le courage intellectuel de Reid de remettre en question ce lieu commun de toute la philosophie de son temps. Il faudrait d'ailleurs tirer une généalogie de cet anti-représentationnalisme car j'ai du mal à voir de qui Reid s'inspire (je n'ai scanné la première partie biographique sur Reid, faute de temps, malheureusement...). La théorie des idées est vraiment la grande erreur philosophique qui a éloigné pour très longtemps la philosophie occidentale d'un réalisme (non pas métaphysique mais interactionniste, au sens où l'homme est pensé d'une manière réaliste avec son environnement). Le transcendantalisme kantien et son versant hégélien n'est que l'enfant bâtard de la voie des idées. En ce sens, Reid est fondamental pour penser les nouveaux réalismes...
D'autres choses sont aussi extrêmement intéressantes. Son pluralisme incessant par exemple. Contre une tentative réductionniste de faire émerger ou survenir les facultés de l'esprit humain sur une seule base, par exemple sur le modèle de la perception externe et sensible chez Hume, Reid affirme sans cesse l'irréductibilité de nos différentes facultés. La mémoire n'est pas un type dérivé de la perception sensible, par exemple. Elle a son mode de donnée propre, ses compétences propres... Cette attention fine aux différents modes de données de la conscience a quelqu
L'Homme sans qualités, tome 1 (1930)
Der Mann ohne Eigenschaften
Sortie : 1957 (France). Roman
livre de Robert Musil
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
Je crois que je vais faire une pause, peut-être abandonner. L'homme sans qualités est vraiment un livre formidable. Mais sa richesse théorique, stylistique, narrative... me tue. C'est un roman vraiment difficile à lire, qui prend beaucoup de temps, qui est très long. J'ai lu 400 pages et j'ai trouvé cela formidable mais j'ai besoin de lire autre chose. J'espère reprendre dans l'année.
Certains passages sont vraiment magnifiques. Rien que le chapitre 4 est extrêmement intéressant en ce qu'il propose une sorte de phénoménologie des modalités, de la réalité (Wirklichkeit, encore que je n'ai pas vérifié le terme allemand traduit par Jacottet) et des possibilités. Théoriquement, ça m'intéresse beaucoup... Puis, tous les chapitres aux alentours des 60 sur la question de la vie idéale, utopique où l'homme excellerait dans sa vie comme l'on excellerait dans son métier, c'est aussi très beau.
La profondeur psychologique que met en place Musil est assez hallucinante. Par exemple sur la relation triadique entre Walter, Clarisse et Ulrich. Musil est le plus grands des philosophes de l'émotion. L'histoire incestueuse de Clarisse est vraiment extrêmement intéressante...
Cinémas d'Asie, d'hier et d'aujourd'hui
Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine, Hongkong
Sortie : 6 mai 2015 (France).
livre de Frédéric Monvoisin
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Lu ce petit manuel pour me reposer un peu. C'était sympathique, sans plus. Beaucoup de name-dropping, normal, c'est un manuel Armand Colin. Que demander de plus ? Ca m'a permis un peu de me rendre compte que les réalisateurs que j'estimais assez inconnus sont parfois des stars, et inversement...
Ce qui est intéressant avec le cinéma asiatique, c'est la continuité qu'il admet avec des formes d'art traditionnelles. Tout ce qui est spectacle de lumière, de lanterne magique, d'ombres... Cette continuité, où le cinéma apparaît comme prolongement technologique d'une tradition ancestrale, est beaucoup moins présente en Occident. Ca pose d'ailleurs de vrais questions ontologiques et esthétiques sur la matérialité du cinéma...
Recherches sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun (1764)
Sortie : 6 décembre 2012 (France). Essai, Philosophie
livre de Thomas Reid
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Reid a récemment été retraduit par les spécialistes des écossais : Malherbe, Le Jallé, Etchegaray, Thébert... Ici, c'est la traduction du patron, Michel Malherbe dans la belle collection Analyse et philosophie. J'aurais préféré lire les Essais sur les pouvoirs intellectuels mais la traduction tarde à être publié. Tant pis, l'Inquiry est plus courte et plus facile de lecture. C'est une bonne introduction à la méthodologie de Reid. Je lirais les Essais quand la traduction sera disponible (vraiment pas le courage de lire de l'anglais du 18e, même si ça se fait en vrai).
Reid se lit vraiment bien, mieux que Hume ou Berkeley je trouve. Je pense aussi que Malherbe a fait un très bon travail de traduction. C'était vraiment chouette à lire, très fluide. J'ai bien retrouvé tout ce que Thébert avait excellement présenté. La réfutation du "système idéal" comme Reid l'appelle, est vraiment bonne, même si on peut contester comme trop globalisante l'interprétation que fait Reid de toute l'histoire de la philosophie de l'esprit antérieure. Ce refus du système idéal s'accompagne toujours d'un refus du scepticisme (qui est sa conclusion logique) et d'un retour du sens commun. On trouve de belles pages qui confrontent la philosophie (qui s'absolutise dans le scepticisme) et le sens commun. Entre les deux, Reid veut signer un traité de paix perpétuelle - en faveur du sens commun, il faut bien l'avouer.
Depuis quelques temps, je m'interroge pas mal sur les implications politiques de la philosophie du langage ordinaire. C'est en fait en travaillant sur les éthiques de la vertu que j'ai compris à quel point le retour au sol raboteux de l'ordinaire pouvait avoir quelque chose de réactionnaire. Car il est clair que cela favorise clairement le non-interventionnisme, le quiétisme, la stagnation... voir le retour à un temps mythologique (MacIntyre, tu es visé). Je crois que c'est un peu pareil sur le sens commun. Même si j'admire vraiment le descriptivisme philosophique, on voit bien la liaison entre onto-théologie et retour au sens commun chez Reid. D'ailleurs, son utilisation chez les fondamentalistes analytiques (Plantinga, Wolterstorff) clairement un signe du caractère potentiellement réactionnaire de sa pensée.
Il est clair que le chapitre le plus fécond reste celui sur la vue. L'idée de la réalité des apparences visibles, de leur rapport géométrique avec la réalité tangible, l'idée d'un espace non euclidien de la vue rétinienne, tout cela est fort fécond...
La Chouette aveugle (1936)
Sortie : août 1989 (France). Roman
livre de Sadegh Hedayat
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Roman très intéressant, qui m'avait directemen fait de l'oeil quand je l'ai découvert dernièrement. Le jeu sur le lien entre hallucination et réalité m'intéressait notamment, d'un point de vue théorique.
Le roman est manifestement très porteur. Mais j'ai été un peu dérangé par un symbolisme un peu extrême. L'inceste, le meurtre, l'enfance, les thématiques religieuses, j'ai trouvé ça un peu lourdingue par moment comme une sorte de tableau de Gustave Moreau kitsch à outrance.
Même si la bipartition du récit est très intéressante, tant d'un point de vue stylistique que philosophique, je trouve qu'elle n'aide pas à sortir de ce symbolisme un peu kitsch. Les systèmes de renvois entre les symboles m'a un peu gonflé. Oui, l'oncle ressemble à un Indien, oui le corps est enterré vers un cyprès et un ruisseau, oui tiens cette bouteille de vin reçue en héritage... Bon...
Montesquieu
Liberté, droit et histoire
Sortie : 1 avril 2010 (France). Vie pratique
livre de Céline Spector
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
Très bonne introduction à L'Esprit des Lois de Montesquieu par une lecture à peu près cursive. Je n'ai quasiment rien lu sur Montesquieu mais à chaque fois que je lis des choses de Céline Spector, je trouve ça très clair, très détaillé, très rigoureux... Je n'ai pas été déçu par cette introduction.
Spector propose de plus une structuration de l'ouvrage qui permet de s'orienter bien mieux dans les multiples livres qui composent l'Esprit des Lois. Il y a un vrai travail d'ordonnancement qui peut être très utile pour s'introduire à l'oeuvre.
De l'esprit des lois
Sortie : 22 septembre 1995 (France). Essai, Philosophie
livre de Montesquieu
Holzfallen a mis 6/10.
Annotation :
Face à la déconnexion de l'idéalisme allemand, Montesquieu semble être un des penseurs les plus importants pour penser le politique dans toute sa réalité. Il y a beaucoup de choses admirables dans l'Esprit des Lois. Tout d'abord, la mobilisation d'une masse énorme de faits empiriques. Alors oui, sans doute que la rigueur des sources n'est pas digne des travaux actuels, mais il faut saluer l'honnêteté intellectuelle d'un retour à l'empirie. Son contextualisme, son relativisme, son "sociologisme" sont vraiment séduisants par rapport à la philosophie de l'histoire franchement absurde de l'idéalisme allemand. Son naturalisme faible qui englobe lois de la nature et lois normatives a aussi de quoi plaire. Sa définition de la liberté par l'équilibre, la modération a quelque chose de beaucoup plus fécond qu'une simple liberté contractualisme. Montesquieu est vraiment un précurseur des communautaristes (Taylor, Walzer) et c'est plaisant de retourner au texte lorsque l'on vit dans l'ère John Rawls de la philosophie politique. La philosophie politique sera anti-contractualiste ou elle ne sera pas.
Et pourtant, c'est assez chiant à lire. La masse d'exemples est assez pénible. A l'époque, cela devait être assez fou d'avoir autant de faits géographiques regroupés dans un même ouvrage. Pour nous, contemporains, c'est moins fun. Résultat, on lit à peine 10 % des livres qui nous donnent envie et on abandonne bien vite car oui au fond, on était pas venu pour entendre parler de la jurisprudence mérovingienne.
J'ai travaillé et lu seulement quelques livres : livre I, II, III, VIII, IX, X, XI, XIV et XVIII.
Ce qui m'a finalement vraiment le plus plu, c'est la rupture très nette avec toute perspective volontariste en philosophie politique. Non, la politique, ce n'est pas une affaire de volonté nue, comme le voudrait le contractualisme le plus sommaire. C'est avant tout une affaire de prudence, de modération et de convenance. Il s'agit de reconnaître que l'homme n'est pas un empire dans un empire, et que c'est l'étude de ces faits socio-démographiques qui va permettre de mettre en place les meilleurs lois possibles. De cette rupture avec le modèle volontariste résulte aussi une rupture avec tout universalisme. Reste que, le relativisme a parfois des conséquences quand même assez réactionnaires. Les pages sur la théorie du climat le montrent bien. Non, les Indiens ne sont pas que des gros flemmards...
Destutt de Tracy (2024)
L’Idéologie rationnelle
Sortie : 2024 (France). Philosophie
livre de Claude Jolly
Holzfallen a mis 5/10.
Annotation :
J'ai un peu tendance à survaloriser les auteurs oubliés. Je me dis toujours : on a oublié ce philosophe alors que ça doit être vachement bien !!
Sur Destutt de Tracy, je crois que je me suis un peu trompé. Honnêtement, c'est pas ouf. C'est vraiment la philosophie orthodoxe de la révolution française. D'un point de vue historique, c'est indéniablement intéressant. D'un point de vue philosophique, pas trop. C'est certes une certaine radicalisation de Condillac, mais ce n'est franchement pas si éloigné. Alors certes, DT est assez exemplaire dont la manière dont il tient ensemble 18e siècle et 19e siècle. Les Elements d'idéologie ressemblent quand même pas mal aux grands systèmes de l'idéalisme allemand tout en restant dans le sillage empiriste et naturaliste des Lumières. Mais, sur l'originalité, ça ne fonctionne pas. Pour le coup, je pense que l'idéologie physiologiste (et non plus rationnelle) de Cabanis est plus originale, se démarque plus par rapport au sensualisme mainstream de l'époque. Quant à Maine de Biran, on cerne bien chez lui une vraie originalité que l'on a du mal à retrouver chez DT... Enfin bon... c'est toujours bien d'être solide sur le père de l'Idéologie !!
Le Cinéma japonais (2008)
3e édition actualisée et augmentée
Sortie : 2 mai 2008. Essai, Cinéma & télévision
livre de Max Tessier et Frédéric Monvoisin
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Lu rapidement. De bonne facture, un peu plus intéressant que l'autre, avec une focalisation plus fine sur les festivals, les studios de production, les metteurs en scène. Reste que l'enjeu premier, pour moi, c'était de découvrir des réalisateurs et/ou des films que j'avais complètement oublié (depuis mes années cinéphiles lycéennes) ou dont je n'avais jamais entendu parler. Sur la période 1990-2010, j'ai découvert pas mal de nouvelles choses qui me donnent bien envie. Avant, ça m'a surtout permis de restructurer chronologiquement la vision que j'avais de l'âge d'or et des nouvelles vagues. Puis, ça m'a permis de enfin comprendre ce qui clochait avec la Ballade de Narayama : le film existe dans la version de Kinoshita et de Imamura. D'où cette incessante confusion depuis quelques années...
Leçons de métaphysique allemande, tome 1 (1990)
De Leibniz à Hegel
Sortie : octobre 1990. Essai, Philosophie
livre de Jacques Rivelaygue
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
Relu juste la sous-sous-partie sur les idéalismes allemands et la transition Kant-Hegel pour me remettre en mémoire les débats entre Jacobi, Reinhold, Schütze, Fichte, Maïmon avant que Hegel ne fasse son entrée explosive sur la scène philosophique avec sa Phénoménologie... RIvelaygue est vraiment extrêmement pédagogue... Bravo à lui et à mon professeur d'hypokhâgne de me l'avoir conseillé. Sans ce livre, je ne serais sûrement pas le même !!
Les Armes secrètes (1959)
(version augmentée)
Las Armas secretas
Sortie : 1963 (France). Recueil de nouvelles
livre de Julio Cortázar
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
Super recueil de nouvelles (j'ai lu la version non augmentée). Je ne connaissais vraiment pas du tout Cortazar et ce fut vraiment une agréable surprise. On retrouve vraiment l'esprit mystérieux, un peu iréel de Blow-up (il faudrait dire l'inverse, mais j'ai découvert Blow-up avant...). J'ai adoré surtout les deux premières nouvelles. Le jeu qui se met en place entre quotidienneté, puissance symbolique et irréalité donne vraiment à réfléchir. On est finalement pas si loin de la Chouette aveugle. Je ne pensais pas l'influence du surréalisme aussi forte dans la littérature mondiale. C'est assez intéressant.
Je pense d'ailleurs que la question philosophique du réalisme devrait davantage s'aborder par ses aspects littéraires et artistiques, ce que commence à faire Benoist avec les arts contemporains et musicaux. Mais, la littérature, elle aussi, n'a cessé de déployer, dans ses réflexions sur les genres et les mouvements, la question du réalisme. Du réalisme non naturaliste, du réalisme magique, du surréalisme... Il y a ici matière à réflexion. L'article le plus célèbre de Barthes ne s'appelle-t-il pas "l'effet de réel" ?
Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee (1921)
Sortie : 1921 (Allemagne). Philosophie
livre de Jean Héring
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
LECTURE DE MEMOIRE. Certes, c'est un peu tôt, mais autant prendre de l'avance. Et, de toute façon, je ne savais pas trop quoi lire. On est donc sur des lectures hautement techniques, dont jamais personne n'a entendu parler. J'ai passé quelques jours, après avoir bien travaillé le superbe article de Salice sur la Stanford Encyclopedia, à vraiment approfondir ma connaissances des grandes têtes de la phénoménologie de Munich et de Göttingen, en essayant de bien saisir la différence entre les deux courants, qu'on a tendance à assimiler sous l'étiquette un peu malsaine de phénoménologie réaliste. J'ai surtout travaillé sur les phénoménologues assez généraux qui ont travaillé sur des questions épistémologiques, ontologiques et grosso modo ont abordé la problématique du réalisme, via la phénoménologie. J'ai donc exclu de cette phase d'études Walther, Hildebrand, Gallinger, Schapp, Stavenhagen.
J'ai surtout lu sur Alexander Pfänder, Moritz Geiger, Johannes Daubert, Edith Stein, Jean Héring, Roman Ingarden, Max Scheler et Theodor Conrad. J'ai laissé de côté pour l'instant HCM. Et je n'ai pas retravaillé Adolf Reinach que je connais déjà bien. J'ai surtout lu des articles introducteurs à leurs oeuvres, la plupart des ressources étant en allemand, c'était bien trop fatigant de commencer par une lecture directe.
C'est quand même ce que j'ai fait pour Hering car son article m'intéressait vraiment beaucoup. Le seul français de la bande (du moins alsacien) et il écrit en allemand... oh misère. C'était très long à lire. J'ai un peu passé sur la troisième partie. Mais cet essai paru dans le Jahrbuch IV est extrêmement intéressant pour l'histoire de la phénoménologie réaliste. Ce qu'on peut dire, c'est que Hering réinterprète complètement le tournant transcendantal de Husserl (déjà amorcé depuis 1905-1907) pour permettre à la phénoménologie de prendre un tournant que l'on pourrait dire platonicien. En 1921, Hering fonde donc un nouveau genre de réalisme phénoménologique, qui est avant tout un réalisme des essences, dans la continuité de la première partie des Ideen. Ce réalisme des essences n'est pas nécessairement un réalisme de la perception, du langage ou de la pensée. Il affirme simplement qu'il existe (mais le terme exister est-il le bon) des essences et des légalités eidétiques qui permettent de répondre aux grandes questions métaphysiques. C'est clairement ce réalisme des essences qui va influencer grandement les oeuvres ultérieures de Conrad-Martius, Stein et In
Münchener Philosophische Abhandlungen (1910)
heodor Lipps zu seinem sechzigsten Geburtstag gewidmet von früheren Schülern
Sortie : 1910 (Allemagne). Philosophie
livre de Alexander Pfänder
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
LECTURE DE MEMOIRE. J'ai continué ces lectures avec un papier franchement introuvable de Theodor Conrad sur la différence eidétique entre représentation (Vorstellung) et perception (Wahrnehmung). A noter que ce papier figure dans le recueil édité par Pfänder en hommage à Lipps de 1911 (c'est moi qui ait log le livre sur SC mais il y a eu un bug, ça a mis 1910...). L'article est franchement dur à lire en allemand, j'ai pris plusieurs jours pour 25 malheureuses pages... M'enfin, c'était très intéressant, même si Conrad se traînait un peu. On retrouve il me semble dans ce papier les bases d'un réalisme naïf ou ordinaire relativement proche, bien qu'il subsiste des différences, dans les réalismes de Travis et de Benoist. Ce serait tout l'enjeu d'un rapprochement avec certains nouveaux réalismes.
Un des buts centraux de cet article est en fait de montrer que nos perceptions n'ont aucune valeur épistémique. Elles nous confrontent seulement avec une certaine réalité (Realität, non Wirklichkeit) qui se remarque par son caractère factif. Au contraire, la représentation elle est avant tout une entité flottante qui ne possède pas ce pouvoir de facticité. On retrouve donc bien les réflexions de Benoist quant à la différence grammaticale entre vérité et réalité. Mais Conrad va plus loin et propose de même de dire que la perception ne nous indique en rien sur l'existence (Existenz) de telle ou telle entité, de parce qu'elle est totalement dénuée de valeur épistémique. C'est un point nodal, extrêmement intéressant dans une théorie non cognitiviste et réaliste de la perception. On retrouve en fait une position intermédiaire, que l'on pourrait nommer neutralisme, et qui anticipe finalement le transcendantalisme husserlien. Comment réussir à concilier non cognitivisme et engagement réaliste ?
Dans une très longue note de bas de page, Conrad démonte aussi, dans la même mouvance que Reinach, Pfänder et la première phénoménologie réaliste (celle de Munich) le dispositif intentionaliste qui caractérise les Recherches Logiques. A partir du concept de perception sourde ou perception mate, Conrad montre que la perception ne se caractérise pas forcément par l'intentionalité, de même pour les représentations...
A noter que ce recueil édité par Pfänder abrite de grands textes de la phénoménologie : la théorie du jugement négatif de Reinach, Motive und Motivation de Pfänder, cet article de Conrad, la conscience du sentiment de Geiger...
Husserl, La controverse Idéalisme-Réalisme
Sortie : 2000 (France). Philosophie
livre de Roman Ingarden et Patricia Limido-Heulot
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
LECTURE DE MEMOIRE. Avec Ingarden, on entre clairement dans un autre versant du réalisme phénoménologique. Je pense que c'est vraiment cette dualité du réalisme phénoménologique qui ressort pour l'instant le plus de mes lectures. D'un côté, on a un réalisme psychologico-ordinaire, caractéristique de Munich et du post-lippsisme. On y trouve Daubert et Pfänder en chef de liste. Suivent Geiger, Conrad et Reinach, dans une certaine mesure. En fait, Reinach, Conrad-Martius et Conrad semblent faire la liaison avec le réalisme de Göttingen, qui sera malgré tout largement influencé par le tournant idéaliste de Husserl et qui proposera un réalisme de continuation avec le tournant des idées directrices. Dans ce réalisme des essences, le manifeste est l'article de Hering (1921), commenté plus haut. Stein et Ingarden héritent clairement de ce modèle. Pour Conrad-Martius, je trouve que la situation est un peu plus complexe. C'est aussi pour cela que je suis content de travailler sur elle. Elle me semble vraiment être à l'entre-deux, comme Reinach mais avec quelques années de décalage avec avec une moindre influence de l'objectivisme sémantique néo-brentanien.
J'avoue ne pas être hyper convaincu par les différents textes de Ingarden recueillis dans ce livre de Limido-Heulot. Son hyperréalisme des essences ne me convainc pas totalement. Son interprétation du problème idéalisme-réalisme reste extrêmement dualiste, dans sa manière de poser le problème. En effet, pour Ingarden, la question du réalisme doit se reformuler ainsi : quelles sont les liaisons eidétiques entre la région ontologique de la conscience et la région ontologique du monde extérieur. Selon sa lecture, le Husserl de 1913 fait du monde extérieur un corrélat intentionnel de la conscience, annihilant ainsi toute autonomie eidétique et existentielle au monde extérieur. Pour résoudre ce problème, il faut donc montrer, de manière purement possible (c'est le sens de ce que Ingarden nomme ontologie que d'étudier les structures possibles de l'être, d'un point de vue existentiel, formel et matériel) que le monde extérieur ne dépend pas de la conscience, qu'il est en soi. Cette manière de poser le problème me semble finalement extrêmement cartésienne. Les objections sont nombreuses face à ce modèle. Notamment la suivante. Pourquoi ne pas admettre que la réalité psychique est une réalité comme une autre ? Ingarden fait de la vie égotique l'opposé de la réalité, ce qui est manifestement bizarre. Scheler ira plus loin
Les Rites d'interaction
Interaction Ritual
Sortie : 1967 (France). Essai, Culture & société
livre de Erving Goffman
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
PAUSE SOCIOLOGIQUE. Après avoir bien travaillé les grandes contributions "réalistes" de la phénoménologie munichoise et göttingéenne, je me suis accordé une petite pause "sociologique". Je reste encore assez branché sur la sociologie, son actualité et ses grandes inflexions. Je n'avais jamais lu Goffman dans le texte, malgré en avoir discuté. C'est chose faite.
La traduction extrêmement foireuse des traducteurs bourdieusiens des années 70-80 n'aide clairement pas à lire correctement le livre. C'est franchement mal traduit. Ca se lit quand même, et c'était très bien.
Ce qui est vrraiment fécond avec Goffman, c'est clairement sa précision phénoménologique. Il s'agit de donner à chaque chose qui peuple la réalité quotidienne, interactionnelle, un nom. Goffman déplie vraiment lentement la grammaire de l'interaction en y montrant toutes ses potentialités et ses fragilités. La notion d'embarras est par exemple très féconde. C'est là tout le sens du réalisme de Goffman. Montrer que tout ne va pas de soi. Son interactionnisme est vraiment très anti-métaphysique, si l'on considère le leibnizianisme bourdieusien comme le summum de la métaphysique sociale.
La dialectique de l'engagement et du désengagement inhérent à toute interaction est extrêmement bien restituée, avec des exemples précis...
Reste peut-être un point de vigilance : je pense que malgré cet oeil phénoménologique, Goffman part avec un présupposé : le caractère absolument moral de la face de l'individu, de son individualité... C'est sans doute le seul, mais très imposant, présupposé qui traverse cet oeuvre et c'est parfois dommage.
La construction sociale de la réalité
Sortie : 6 avril 2022 (France). Jeunesse
livre de Peter Ludwig Berger et Thomas Luckmann
Holzfallen a mis 4/10.
Annotation :
PAUSE SOCIOLOGIQUE. Ce que la sociologie peut faire de pire est tout entier inclus dans cet ouvrage ! Je ne veux même pas faire de critiques. C'est de la merde. De la pseudo-phénoménologie sociale, de la pseudo-sociologie, sans aucune source empirique, complètement polluée par des mythes en toute genre, subjectivistes, dialectiques, individualistes... C'est un livre qui ne rend absolument pas hommage à Schütz, à l'anthropologie philosophique et à tout le monde. C'est d'une simplification grossièrement abusive.
Changer de société, refaire de la sociologie (2007)
Sortie : septembre 2007. Essai
livre de Bruno Latour
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
PAUSE SOCIOLOGIQUE. Je ne m'attendais à rien et j'ai été bien loin d'être déçu. Après avoir trifouillé dans la littérature latourienne, j'ai enfin que ce livre au titre extrêmement soporifique, que je voyais passer depuis 4 5 ans, contenait en fait le résume de toute la première pensée de Latour, avant les réflexions sur la nature, la modernité et la religion. C'est donc la parfaite introduction, surtout que Latour est pédagogique et drôle.
Reste que le livre est un peu touffu et très répétitif et surtout vachement long. Donc j'ai lu rapidement. Mais quelle puissance de frappe. Latour est un vrai penseur, quoi qu'on ne pense, on ne peut pas dénier son extrême originalité par rapport à une littérature sociologique souvent ennuyante et un peu nauséabonde. Latour propose des choses extrêmement concrètes, essaye véritablement de changer les sciences sociales. On ne peut que saluer cet engagement, qui change clairement de l'itérabilité infinie de la doxa bourdieusienne.
Ce livre restitue donc les grands principes de la théorie de l'acteur-réseau de Guerre et paix des microbes à La Fabrique du droit : principe d'une science de l'association, empirisme des matters of concerns, disputes et épreuves, symétrie entre humains et non-humains, refus d'une "matière" sociologique... Tout cela est très dense dans le texte et j'aurais intérêt à le relire.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le refus clair et net de toute métaphysique sociologique au profit d'une sociologie que j'aimerais qualifier de nietzschéenne. Il me semble en fait que Latour réitère l'argument nietzschéen contre l'arrière-monde métaphysique des platoniciens. Il n'existe pas, nous dit Latour, d'arrière-monde social qui viendrait expliquer les faits que l'on a envie de qualifier de sociaux. Non, il faut rester sur un plan d'immanence, le plan des réseaux et de leur assemblage constant et incertain. Ca, je trouve ça très fort.
Contre l'image constructiviste que l'on a "construit" de Latour, on voit bien aussi à quel point celui-ci se veut "réaliste" ou au moins empiriste/matérialiste. Il est clair que les pourfendeurs du constructivisme n'ont sans doute pas bien lu Latour.
Pasteur : guerre et paix des microbes (1984)
Suivi de Irréductions
Sortie : 6 octobre 2011 (France). Essai
livre de Bruno Latour
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
PAUSE SOCIOLOGIQUE. Pour illustrer concrètement le livre précédent. Très intéressant sur l'agentivité des microbes si on veut résumer en une proposition le livre, parfois un peu ennuyant. Ca reste une enquête. En bon philosophe, je préfère la spéculation...
Late German Idealism (2016)
Sortie : 2016 (Royaume-Uni). Philosophie
livre
Holzfallen a mis 5/10.
Annotation :
2 semaines de rentrées un peu débordantes et débordées.
LECTURE DE MEMOIRE. Après une petite discussion avec mon directeur de mémoire sur la question des influences de Conrad-Martius et d'une inclusion - ou non - de la phénoménologie munichoise et göttingéenne dans la longue histoire de de la philosophie austro-allemande (de Bolzano à Wittgenstein et Husserl), je me suis dit que, sans lire et relire tous les proto/post brentaniens, je devais au moins avoir des connaissances de base sur Lotze. Lotze est assurément un des pères de la phénoménologie. C'est maintenant un fait établi, sans doute même de manière trop dogmatique. C'est l'un des précurseurs, avec Bolzano, de la question de l'idéalité eidétique husserlienne.
Mais Lotze avait un acolyte encore moins connu : Trendelenburg. Et, j'ai l'intuition que le tournant néo-finaliste/aristotélicien de Conrad-Martius dans les années 1930 a quelque chose à voir avec la réhabilitation d'Aristote par Trendelenburg dans ses propres Recherches Logiques. J'ai donc lu ce livre de référence sur ces deux penseurs que l'on classe souvent sous le joli nom d'idéalisme tardif. Ou parfois sous le nom plus barbare d'idéalisme téléologique.
En soi, le livre est pas terrible, je trouve mais il offre des ressouces de base sur Lotze et Trendelenburg. Et, pour Trendelenburg, c'est très utile étant donné le vide historiographique qui l'entoure.