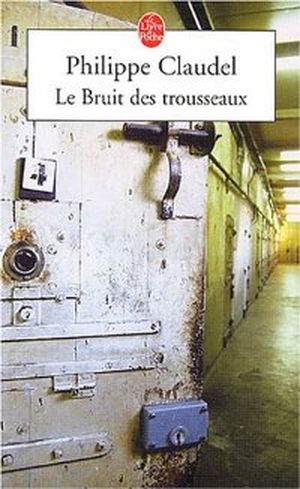Il s'agit d'un texte de la première partie de la carrière de Philippe Claudel, juste avant qu'il n'atteigne la célébrité avec Les Âmes grises (qui sera son livre suivant).
Le Bruit des trousseaux n'est pas un roman, ni même un récit. Ici, aucune narration, aucune histoire. Le texte, très bref (80 pages peu remplies), est une compilation de courts paragraphes, chacun étant indépendant, clos sur lui-même. L'unité du texte provient de sa thématique : la prison.
Agrégé de lettres, Philippe Claudel a donné des cours en prison. Et dans Le Bruit des trousseaux, il nous donne à voir, à ressentir, la vie quotidienne d'une maison d'arrêt (en l'occurence, même si ce n'est jamais précisé explicitement, il s'agit sans doute de la prison Charles III, en plein coeur de Nancy, démolie en 2009 ; au détour d'un paragraphe, Claudel évoque le Pont des Fusillés). Chaque paragraphe va évoquer soit une anecdote, soit une rencontre, une brève description d'un lieu ou d'une personne, une réflexion, une observation, une analyse rapide, etc. Et ainsi, par petites touches, va se dresser le tableau pointilliste de la vie quotidienne en prison.
Ce qui touche vraiment dans ce texte, c'est son humanité. Claudel va nous parler du côté humain de la prison. Il va en décrire l'humanité qui l'habite, y travaille ou juste la traverse : les détenus et leurs surveillants, bien sûr, mais aussi l'aumônier, le vaguemestre, des bonnes soeurs qui viennent donner des cours, les familles qui viennent au parloir ou les copines qui, depuis la rue, crient leur amour, etc. On croise la fille d'un directeur de prison, qui chaque matin sort de l'établissement pour se rendre au collège. Claudel décrit ce maire d'une petite ville, qui malgré son incarcération continue d'assurer sa fonction. On rencontre Michael Lonsdale qui vient faire une lecture aux détenus, ou un juge d'instruction souriant en pensant qu'il a contribué à envoyer certains prévenus dans cette prison, et cela lui donne le sens du devoir accompli.
Les petites histoires, anecdotes ou observations consignées ici sont simples mais donnent une image humaine, plurielle et sensible. Claudel évoque ces prisonniers qui, chaque matin, sortent les bacs de poubelles et qui, de ce fait, se retrouvent, pour quelques secondes, de l'autre côté du mur, dans la rue; que peuvent-ils bien penser alors ? Il parle de ce prisonnier qui se suicide juste la veille de sa libération, de peur de l'accueil qui lui sera réservé dans le village où il devra retourner. Il mentionne aussi le médecin, dont la prescription se traduit invariablement par "deux Doliprane", quelle que soit la douleur pour laquelle on vient le consulter (y compris des problèmes psychologiques ou moraux). Il y parle de la chaleur insupportable, des étés où toute activité cesse, des surveillants, du langage de la prison avec son vocabulaire que même Le Robert ignore, des camions de livraisons avec leurs énormes palettes, des tatouages, de la messe, de la hiérarchie sociale, de l'usage de la Ricorée, etc.
En tout, cela constitue un livre plein d'humanité. Une humanité paradoxale, fleurissant dans un lieu où les conditions de vie sont souvent inhumaines. Claudel, bien évidemment, ne dresse pas un tableau tout rose de la prison : il y a parle aussi des viols, de la violence (y compris de celle des surveillants), etc. Un joli texte.
"Je me souviens de ces deux surveillants accueillant un détenu qui revenait des assises, et qui, sonné par le verdict qui l'avait condamné à dix-huit ans d'emprisonnement, avançait comme un automate. Ils l'entouraient et lui parlaient avec une douceur dont peut-être l'équivalent est à chercher dans celle que l'on trouve chez une mère parlant à son fils qui pleure. Les deux gardiens murmuraient des mots simples, des mots de réconfort. Ils tutoyaient le détenu et leur tutoiement était alors la plus grande preuve de leur bonté."