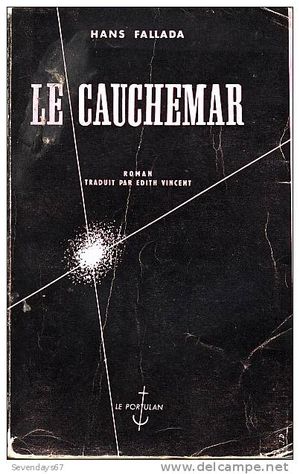Plus faible que ses romans précédents, les écrasants "Le buveur" et "Seul dans Berlin" comme si toute parole de trop était devenue exténuation au sortir d'une guerre immonde qui laisse au peuple allemand, l'âme vide et les yeux creux. Il y a toujours cette acuité à dépouiller, à fouiller l'humain pour arriver jusqu'à l'os mais le récit est lourd, le sentiment de déperdition contamine le roman. Cette sensation d'inéluctabilité, de fatigue, à le mérite de l'honnêteté. Immense dégout de ceux qui sont restés englués au fond de l'entonnoir, errants entre les ruines, se disputant les restes. Il ne reste plus alors qu'à se tourner vers les paradis artificiels et la morphine, véritable petite mort, disparition de la conscience, que s'injectent et dispensent comme une manne, nombre de médecins, apparus tels des spectres. Les maisons de repos, les asiles d'indigents comme dernier refuge aux rues fouettées par des vents gelés, voici l'invite à cet ultime roman de Fallada. Et la voix de l'auteur transparait et se confond aux dits du personnage. Un auteur qui devait disparaitre peut de temps plus tard, en février 1947, épuisé d'une vie à sillonner les marges profondes.