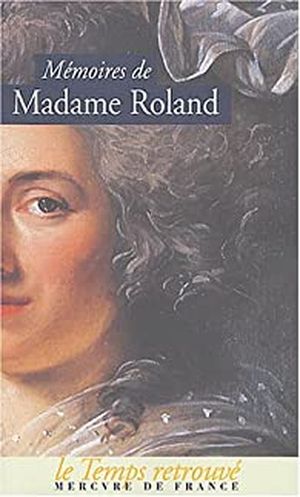Manon Roland (Marie-Jeanne Phlipon de son nom de jeune fille) écrit ses Mémoires alors qu’elle est emprisonnée en 1793, sur ordre du Comité de Salut Public dirigé par Robespierre. C’est donc un témoignage de l’intérieur de la période la plus sombre de la Révolution qu’elle nous livre, celle de la Terreur, durant laquelle les Montagnards règlent leurs comptes avec les Girondins en les pourchassant et les exterminant. La France, elle, est attaquée par les puissances étrangères et sombre même dans une guerre civile, plusieurs grandes villes de province se soulevant contre le Gouvernement Révolutionnaire de Robespierre, qualifiée à juste titre par Manon Roland de « tyrannie ». Dans la 1ère partie de ces Mémoires, elle nous raconte d’abord dans quelle famille elle vit le jour en 1754, son enfance heureuse auprès de parents bourgeois, ses études variées qui la font se passionner pour de nombreux sujets et la faire s’ouvrir aux ouvrages des penseurs des Lumières (Voltaire, Rousseau…), elle s’intéresse à tout et dévore les livres qui lui tombent sous les mains : « (…) dans mes lectures, je me passionnais pour les réformateurs de l’inégalité ». Cette partie, la plus longue, s’achève par son mariage avec Jean-Marie Roland. D’autres textes ont été ajoutés pour compléter cet ouvrage, écrits aussi en prison, sous le nom de « Notices historiques ». Elle nous raconte le début de la Révolution, ses idées républicaines, son mari devenant rédacteur des cahiers de doléances en 1789 puis député à l’Assemblée Constituante. Roland, proche des Girondins, finit par devenir ministre de l’Intérieur sous la Monarchie constitutionnelle, au départ enthousiaste, persuadé que Louis XVI respectera la Constitution, la séparation des pouvoirs et les libertés acquises. Sa femme, elle, en est beaucoup moins certaine…Le portrait qu’elle dresse de celui qui était encore roi est lucide, sans concession : « Ce n’était ni l’imbécile abruti qu’on exposait au mépris du peuple, ni l’honnête homme bon et sensible que préconisaient ses amis ». Au final, un personnage qui serait passé inaperçu dans des temps normaux mais que « sa médiocrité (perdit) dans un temps difficile ». Un roi entouré de ministres eux aussi dépassés par les évènements et voulant étouffer les révoltes au lieu d’y apporter des solutions par des réformes limitant les inégalités. Necker en fait partie (« Un homme médiocre dont on eut bonne opinion parce qu’il en avait une très grande de lui-même, et qu’il l’annonçait hautement »). Dans cette 2ème partie, elle cherche surtout à défendre point par point son mari accusé de « conspiration » par les Montagnards, elle-même étant mise en cause comme « instigatrice de la conspiration ». Elle se défend courageusement, sans retenir ses coups sur les hommes au pouvoir, à commencer par Robespierre : « Je crains qu’il n’aime aussi la domination (…), je crains qu’il n’aime beaucoup la vengeance, et surtout à l’exercer contre ceux dont il croit ne pas être admiré », au final « (…) un être bien atroce ». Manon accuse aussi Marat et elle prend la défense de Charlotte Corday ! « Une femme étonnante, ne consultant que son courage, est venue donner la mort à l’apôtre du meurtre et du brigandage », en regrettant tout de même que ce meurtre fasse de Marat un martyr. Mais celui vers qui sa haine se déchaîne est Danton, qui revient pendant plusieurs pages, lui qui « combine, arrête et fait exécuter des plans capables de frapper de terreur, d’anéantir beaucoup d’obstacles, de recueillir beaucoup d’argent et d’égarer l’opinion sur toutes ces choses », « plus scélérat qu’aucun, mais plus avisé ». Des portraits sans concession d’hommes qu’elle a connus, un témoignage de 1ère main et dont on sait aujourd’hui, grâce au travail des historien(ne)s, qu’il est réaliste. Une femme qui a longtemps eu confiance en la Justice et en la République : « (…) Je suis incarcérée parce que j’appartiens à un homme de bien qui s’est avisé de se conserver vertueux dans une révolution, et de rendre des comptes rigoureux étant ministre ». Sa défense courageuse ne servira à rien (elle devra se taire durant tout son procès devant le Tribunal Révolutionnaire), pas plus que sa lettre à Robespierre lui demandant des explications à son acte d’accusation (restée sans réponse). Cette lettre est reproduite à la fin du livre. La description qu’elle nous fait de la France sous la Terreur est terrible mais juste, elle n’en a été qu’une des (nombreuses) victimes, une des plus célèbres. Elle ne mâche pas ses mots dans ses « Dernières pensées », sachant qu’elle va être condamnée à la guillotine, contre les « (…) infâmes prédicateurs du carnage » qui « (…) subissent presque toujours le châtiment qu’ils ont mérité ». Manon Roland a été guillotinée en novembre 1793. Quelques mois plus tard, ce sera le tour de Danton et en juillet 1794 de Robespierre. Parmi les derniers écrits de cette femme extraordinaire, on peut lire ceci : « Quand l’innocence marche au supplice, où la condamnent l’erreur et la perversité, c’est à la gloire qu’elle arrive ». Cette femme fait aujourd’hui partie des programmes d’histoire au lycée, son mari est lui oublié. Ses mémoires sont très intéressantes, mais il vaut quand même mieux avoir une bonne connaissance de la Révolution Française, de sa chronologie et de ses personnages centraux.