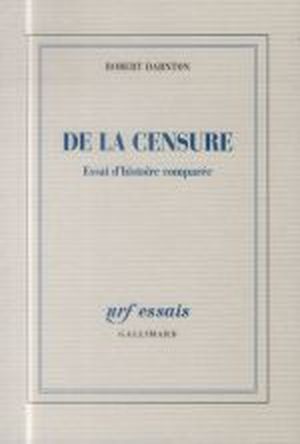Une histoire de la censure, note Darnton, peut s'opérer de deux manières. Celle d'une manière naïve, qui opposerait les ténèbres de la censure à la lumière de la liberté d'expression, et celle plus complexe qui étudierait les processus de censures (auto censures, pression économiques). Darnton choisit cette deuxième approche, avec un accent mis sur la censure d'Etat. En effet dit il dans la conclusion, on risque de ne pas percevoir l'essentiel à se focaliser sur la "censure" par les pairs, par autrui, ou simplement en désignant toutes formes de modérations.
Il étudie trois terrains : la France de la fin du XVIIIème siècle, l'Inde sous domination britannique, et la RDA.
A chaque époque, ses problèmes spécifiques. Plus à l'aise en terrain conquis (la France des Lumières, qu'il a bien étudié), Darnton rappelle que la société d'Ancien Régime était une société d'ordres, et de privilèges. L'idée que l'on naisse "libre et égaux" paraît absurde à l'époque : toute action, entreprise, était soumise à un réseau de ce qu'on appellerait aujourd'hui des contacts, c'est à dire plus privilégiés que soit (nobles par exemple) susceptible de protéger les dites actions. Le livre est soumis à une censure préalable, par ailleurs très mal organisé (les censeurs n'ont pas de bureau propre, exercent depuis chez eux ou autre, sont très mal rémunérés). Cette censure préalable signifie concrètement, qu'un livre doit passer par les plumes des censeurs avant impression. Ces derniers ne se contentent pas d'ailleurs, de commentaires sur la nature politique ou (ir)religieuse des propos : certains livres sont jugés sur des critères esthétiques, théologiques, scientifiques, etc. Flatter le pouvoir ne suffit pas : par exemple une simple mention du jansénisme (y compris pour le critiquer), lorsque la crise était au plus haut, pouvait valoir refus d'impression. De même la censure s'adapte aux exigences de la politique étrangère du moment.
Face à cette censure, pas d'organisation héroïque des libres esprits. Le livre est un commerce comme un autre, et les "Rousseau des ruisseau" (pour reprendre une expression de Darnton même), qui publient textes philosophiques, libertins, voir pornographiques, le savent très bien.
Le commerce illégal du livre se fait lui même dans un cadre spécifique : le Palais Royal. Sous la protection du duc d'Orléans, les libraires vendent sous le manteau des brochures vaguement critiques du pouvoir, le grand scandale mentionné dans ce livre étant celui d'un conte de fée qui est une allégorie (très soft il faut bien l'avouer) de la vie sexuelle de Louis XV.
Le second cas étudié, celui de l'Inde sous domination britannique, est différent. En effet, la censure préalable n'existe plus en Grande Bretagne depuis le XVIIème siècle, et les Britanniques, se targuant d'apporter la "civilisation" en Inde, ne peuvent se permettre une censure trop brutal, puisqu'ils se présentent comme garant des principes libéraux. Aussi on voit apparaître un délit, celui de "sédition" qui condamne de facto toute oeuvre qui inciterait à la révolte contre le pouvoir. En plus de l'habituel délit de diffamation s'entend. La sédition est souvent difficile à établir, les textes en bengali étant souvent remplis d'allusion à la mythologie hindou, ce qui amène à des véritables combats herméneutiques entre avocats de la défense et procureurs.
Le dernier cas, celui de la RDA, beaucoup plus récent, tente une sociologie des censeurs. Darnton, les voit comme avant tout croyant (dans un sens quasi religieux) à l'efficacité du système politique en RDA. Ce dernier est bien plus bureaucratique que ses prédécesseurs : un nombre de commissions et de sous commissions de censure, d'organisations d'écrivains, chargés de contrôler la littérature, mais aussi d'attribuer les stocks de papiers, le nombre d'impression.