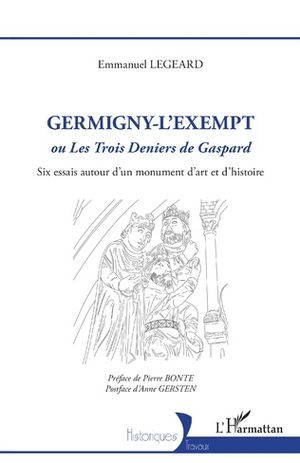* Le premier essai rappelle l’origine du Bourbonnais, les guerres qui opposèrent, à la fin du haut Moyen Âge, Landry comte de Nevers à Archambaud, «prince» de Bourbonnais pour la domination du territoire «entre Loire et Allier». Germigny-l’Exempt est né à cette époque de l’encastellement d’une antique villa appartenant à l’Église d’Orléans qui avait déjà été fortifiée par un seigneur mérovingien chez qui Austrégésile, allant prendre possession du siège épiscopal de Bourges, avait entendu des voix angéliques. De là nous survolons la conquête par Louis VI du domaine royal pour nous arrêter longuement sur les détails d’une affaire qui fut effectivement décisive dans la forme que prit le pays de France à sa naissance: la querelle des investitures de Bourges qui opposa le pape Innocent à Louis VII, affaire encore compliquée par les frasques insensées d’Aliénor d’Aquitaine. Le problème est celui-ci: héritier de la potestas impériale, Louis VII pense que la nomination de l’évêque de Bourges relève toujours de ses prérogatives régaliennes. Mais la réforme grégorienne est passée par là, et le pape Innocent – brutal, dominateur et n’ayant rien d’in-nocent – qui comptait sur le très jeune âge et la formation ecclésiastique de Louis pour le manipuler enrage de constater que celui-ci rejette la tutelle pontificale. Louis ne cédant pas et maintenant son candidat sur le siège de Bourges, Innocent l’excommunie, et la guerre commence. Elle ne prendra fin qu’avec la mort d’Innocent, la reconnaissance par Louis VII de l’archevêque désigné par Rome et le départ en croisade en pénitence. Germigny-l’Exempt, ville royale, est alors donnée à l’archevêque de Bourges. Enfin nous voyons comment la chasse aux hérétiques, et notamment aux Bougres de la Charité, secte manichéenne responsable du meurtre du seigneur de Germigny, Hervé IV de Donzy, a influencé l’iconographie. L’examen détaillé de la première campagne, qui n’avait jamais été fait, est très intéressant, avec un narthex qui figure «la nuit du tombeau» et une chapelle haute dédiée à saint Michel évoquant le «paradis retrouvé».
* Le second essai montre, dans un épisode totalement ignoré jusqu’ici de l’histoire de France, comment les Bourbons sont entrés dans la famille capétienne au XIIe siècle. A la mort de son frère Archambaud IV, Aimon II, dit «Vaire-Vache», devient le tuteur de son neveu, héritier de la «principauté» de Bourbonnais. Cette principauté, constituée de bric et de broc au hasard des conquêtes féodales, n’a aucune légitimité et n’est pas la vassale du roi des Francs. Aussi, quand le second mari de la veuve d’Archambaud vient se plaindre à Louis VI le Gros qu’Aimon Vaire-Vache a spolié son neveu et a profité de la faiblesse de son pupille pour le dépouiller de son héritage, le roi des Francs saute-t-il sur l’occasion. Il a en effet besoin d’un «grand larron féodal» à «camper face à l’Auvergne». Alors le Capétien organise une démonstration de force pour vassaliser Aimon et le mettre à son service. Il se sert pour agir d’un prétexte, la paix de Dieu, qui lui donne un pouvoir d’intervention supra-territorial, et lance une expédition contre la forteresse réputée imprenable où Aimon s’est réfugié: le castrum Germiniacum. Suger raconte alors comment, loin de restaurer le pupille spolié dans ses droits, Louis fait d’Aimon son vassal et marie sa belle-sœur au fils du Bourbon à l’issue d’un siège truqué dont la description dans la Vita Ludovici n’est pas loin de rappeler certaines scènes des Visiteurs. Beaucoup d’éléments frappants dans cet essai très riche, entre autres le parallèle inédit (comme le reste) entre la Vita Ludovici et la Pharsale de Lucain, et la démonstration que le clocher-porche de Notre-Dame (35 m.) fut construit en contrepoint du donjon de la citadelle, afin de montrer que la «paix de Dieu», dont le bras armé est le roi des Francs, domine la «loi de la faide».
* Le troisième essai porte sur l’exégèse iconographique très savante et détaillée du «portail de cathédrale miniature», grande originalité de Germigny. Cet essai, impossible à résumer, est cependant étonnamment digeste et captivant pour un travail de ce type. Comme le dit Jean Wirth, c’est la «remarquable connaissance du contexte» de l’auteur combinée à une passion certaine pour le sujet qui permet ce tour de force assez impressionnant. On ne peut que partager, de ce point de vue, l'avis de Marcia Rickard.
* Le quatrième essai est le cœur du volume et lui donne son titre: Les Trois Deniers de Gaspard. Il relate comment un roi mage, figure de roi croisé au tympan de Germigny, en est arrivé à faire ce don insolite: l’oblation des trois deniers d’or à la Vierge-Eglise trônant au centre, hiératique et impassible. Deniers de la rédemption prélevés sur les Arabes d’une Terre sainte reconquise, ils fusionnent le psaume préfigurant l’adoration des rois mages parlant d’«or d’Arabie» et l’ambition pontificale de reconquête du tombeau du Christ. L’image est donc une métaphore monétaire de la transsubstantiation. L’or «rouge» d’Arabie, rouge du sang des pèlerins du Christ – idée déjà défendue par Luciana Travaini à propos des monnaies en général –, est béni par l’Enfant Jésus quand il est remis à l’Église (la Vierge) à son retour triomphal de Terre sainte.
* Le cinquième essai, également fascinant, attaque le sujet de Germigny sous un angle tout différent. Il s’agit de reconstituer la fonction liturgique du clocher-porche à travers une légende étrange: celle née d’un foudroiement du clocher qui a provoqué l’incendie de l’église un peu avant la révolution française. On racontait localement que les cloches de Germigny avaient été précipitées dans un marécage voisin, et englouties dans la font (la source) «saint Espin». Elle feraient depuis entendre leur carillon aux Rameaux. L’auteur alors montre que si la légende des cloches englouties pour punir une paroisse d’un péché est très banale, on ne trouve en revanche nulle part de carillon aux Rameaux. Les carillons souterrains ont lieu à Pâques, à Noël, ou aux Saint-Jean, mais jamais aux Rameaux. Il s’agit là d’une exclusivité germinoise due à la fonction liturgique du clocher-porche qui prenait tout son sens aux Rameaux. Mais de là, l’auteur va plus loin, et mettant en rapport la légende des cloches avec saint Espin, il montre, preuves à l’appui, que saint Espin était un saint céphalophore (imaginaire) de Touraine importé au VIIIe siècle en Bourbonnais, qu’il passait pour avoir été décapité par des païens, son martyre faisant naître une source, et que les légendes de saints décapités et les légendes de cloches englouties avaient toujours été interchangeables en vertu d’une vieille métaphore qui fait de la tête du saint décapité ou de la cloche envolée des symboles strictement analogues de la voix de Dieu perdue. Plus loin, donnant pour la première fois une étymologie acceptable à la ville de Saint-Epain en Indre-et-Loire, il explique que vraisemblablement Epain (Expennus) est tiré du Gaulois penn(o), qui veut dire «tête». Ce chapitre insolite et foisonnant est un véritable feu d’artifice fulgurant dans toutes les directions, à l’image de l’incendie de Notre-Dame.
* Le sixième essai… je ne l’ai pas trouvé. Est-ce celui de Mme Gersten? Je pense que c’est ce qu’il faut comprendre. Peu de points communs avec les essais de l’auteur, avec qui Mme Gersten ne semble partager que cette idée, capitale il est vrai, en conclusion: «Même si la figure mariale consciemment «construite», n’appartient qu’à la religion chrétienne, elle « fonctionne » sans doute aussi comme un des archétypes majeurs de l’inconscient collectif». L’idée exprimée par Mme Gersten que Notre Dame appartient à nos structures mentales et qu’en tant que «maîtresse des fauves», elle peut être mise en relation avec Daniel dans sa fosse ouvre une perspective très intéressante, et à ma connaissance inexplorée jusqu’à présent.
En tout et pour tout, donc, un ouvrage remarquable, très dense, qui donne beaucoup à méditer, mais qui requiert tout de même un certain niveau de connaissances pour en retirer tout le profit.