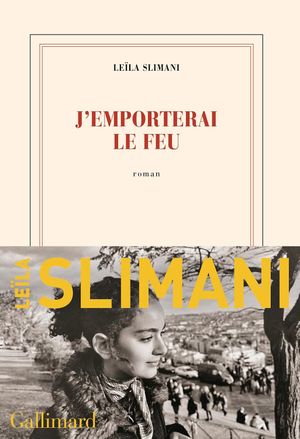Il y a tellement de choses que j’aime dans la douceur et la fluidité d’écriture de Leïla : les thèmes contemporains qu’elle aborde, l’entrée qu’elle offre dans la petite élite marocaine, ce mélange subtil entre l’Occident et l’Orient, cette plongée historique dans les hauts et les bas du Maroc, ou encore ces contrastes sensoriels entre l’odeur de sang de l’Eid et les notes de cannelle des biscuits de Noël de Mathilde.
On développe très vite un attachement pour tous ses personnages, tous habités d’une complexité profonde mais aussi d’une grande simplicité dans l’amour qu’ils portent à leur famille et au domaine Belaj.
Pourtant, dans chacun des livres de cette trilogie, persiste une forme de condescendance envers cet “autre Maroc” auquel ses personnages ne s’attachent jamais et sur lequel ils portent souvent un jugement. Cela transparaît, par exemple, lors du mariage de Leïla et Mehdi, dans les réflexions de Mathilde à son arrivée à Meknès, ou encore dans le regard que Mia porte sur le passé en revenant sur "l’île".
Et on ne peut pas en vouloir à Leïla : elle raconte son histoire, celle que ses ancêtres ont vécue, et elle ouvre ainsi une autre porte sur le Maroc, toujours agréable à ouvrir. Elle ne s’en cache pas : elle ne cherche pas à exposer ce Maroc “archaïque” que certaines institutions françaises fantasment de lire. Mais, lorsqu’elle décrit certains pans du Maroc paysan de l’époque, ce n’est pas toujours avec la neutralité qu’il aurait été, à mon sens, plus juste de conserver.
Dans sa manière de décrire et de relier les personnages à leurs ancêtres, il est difficile de ne pas penser à la série des Rougon-Macquart de Zola. C’est d’ailleurs ce qui rend intéressant le fait de lire ces trois volets : un regard tourné vers le passé, mais toujours ancré dans un présent contemporain.