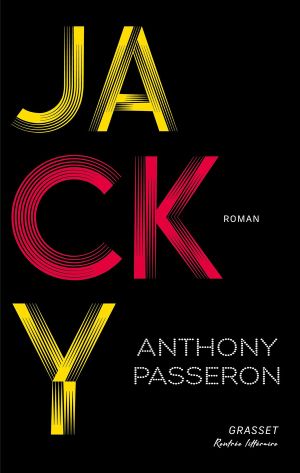Ma critique complète (attention spoilers importants) : https://sospoilogie.wordpress.com/2025/10/14/jacky-danthony-passeron-2025/
Rebelotte. Après Les enfants endormis, Anthony Passeron reprend exactement la même structure pour son nouveau roman. Son très bon premier roman alternait les chapitres autobiographiques sur son oncle et sa cousine, morts du SIDA, et les chapitres plus encyclopédiques sur l’histoire des recherches médicales pour comprendre et tenter de soigner cette maladie. Ça fonctionnait très bien. Ici, il s’agit de lier ensemble la petite histoire de la disparition de son père d’une part et la grande histoire des Jeux-Vidéos d’autre part. C’est assez facile et plaisant à lire, mais ça me semble à la fois du réchauffé et beaucoup moins réussi que Les enfants endormis. Passeron ose des souvenirs beaucoup plus autobiographiques ici : les relations houleuses entre ses parents et leur séparation, la mort du SIDA de son oncle et de sa cousine, la mort par suicide de son autre oncle. Surtout, l’abandon du père.
Le style est le même que dans le roman précédent, très simple, à l’os, souvent naïf. Mais il y a ici des envolées et elles me semblent assez ratées. Le pire, c’est lorsque l’auteur fait des métaphores vidéoludiques sur sa propre biographie : ses parents attendent des jumeaux, il écrit “Two players game”. C’est non ! Quand sa cousine meurt du SIDA, on sent qu’il hésite à écrire “game over” - d’ailleurs il ne résiste pas à intituler le dernier chapitre ainsi. On peut lire ce genre de phrases, au premier degré : “De même que la progression technique des consoles de jeux permettait à nos machines de dessiner des paysages de plus en plus nets, il semblait que ma vision du monde des adultes s'affinait peu à peu. Elle ouvrait de nouvelles perspectives qui libéraient sans cesse des interrogations auxquelles je me promettais de trouver un jour une réponse”. Dans le paragraphe qui suit, on peut voir le style de ce roman, un paragraphe sur Space Invader avec une anecdote historique (la pénurie des pièces de 100 yens) suivi d’un paragraphe sur le père qui ouvre la boîte de la console avec une anecdote biographique (“souffler dans la cartouche si le jeu ne fonctionnait pas”).
Surtout, les chapitres sur l’histoire des Jeux-Vidéos sont à peine de la littérature. Nous avons le droit à des résumés paresseux des articles wikipedia sur l’Atari, la NES, la Mega Drive, le jeu raté E.T., la naissance de Space Invaders Super Mario Bros ou de Zelda! L’histoire de ces jeux-vidéos est assez intéressante en soi, cette innovation technologique, qui est passée en une génération des pixels de Pong aux décors magnifiques de Street Fighters. La bulle des consoles Atari qui explose et devient un krach lorsque des centaines de jeux sortent, avec une qualité déplorable. Les invendus enterrés dans le désert, les réponses des grands studios (par exemple imposer une licence pour éviter la multiplication des jeux de mauvaise qualité), les fusions entre éditeurs, l’évolution technologique avec des microprocesseurs plus petits et plus puissants, la concurrence entre Nintendo et SEGA, etc. C’est une histoire du capitalisme du 20e siècle à travers un exemple sympa. A la limite, ça serait un bon chapitre de mon cours sur la croissance ou un bon TPE. Mais de la littérature ? C’est quand même assez limité.
L'essentiel de ce roman (plutôt de ce récit?) est cette dissection de la figure du père. C’est une histoire assez classique, celle de la masculinité en milieu populaire. Le père est issu d’une lignée de bouchers, mais reprendre la boutique n’est pas un choix évident : son frère s’est jeté dans l'héroïne et il le fait à reculons. Il est donc en déclassement, a peur de trahir ses ancêtres. Le personnage du père est assez complexe : c’est lui qui transmet à ses jumeaux la passion des jeux-vidéos, mais il s’en éloigne également très vite. Il y a de belles pages, lorsque l’auteur montre à quel point sa relation avec son père s’est détériorée. D’abord, ils sont heureux de jouer ensemble à l’Atari, puis son père essaye de jouer à Mario avant de tout envoyer balader, le père refuse de toucher à nouveau à une console, d’ailleurs il vend l’Atari et les cartouches à un brocanteur.
En quelques années, la vie du père s’est détériorée, les rêves enfouis sous les sombres difficultés de la vie. La boucherie de ses parents ne marche pas à cause de la concurrence des supermarchés, son frère et sa nièce meurent du SIDA, son couple bat de l’aile, sa maitresse ne veut finalement pas s’installer avec lui, son jeune frère se suicide… Il va se mettre en couple avec une collégienne de 16 ans et abandonner complètement ses enfants. Lorsqu’il essaye de comprendre cette disparition, Passeron met tout sur le dos de la masculinité. Les “hommes de sa famille” ne savent pas gérer leurs émotions, ne savent pas les montrer, refusent de pleurer, d’en parler et lorsque la coupe est pleine, ils explosent (suicide, drogue, abandon). C’est intéressant, mais c’est assez grossier. “Ma mère était d'autant plus ennuyée que, comme à notre habitude, nous avions, mon frère et moi, simplement enregistré cette information sans exprimer de ressenti - fidèles aux hommes de notre famille, enfermés dans leur inaptitude à exprimer leurs sentiments.” Par ailleurs, l’auteur souligne la différence entre ces pères et camarades hyper virils et lui et son jumeaux plutôt sensibles (ce sont des “pédés”?). On retrouve les pages habituelles sur ces garçons qui ne sont pas bons en sport (remplaçants et incapables de mettre un but au handball), à la bagarre ou dans les vestiaires. Un jour, les jumeaux se font tabasser en rentrant du collège et l’auteur pense que son père a honte qu’ils aient été incapables de se défendre.
Finalement, à travers ce court roman, Passeron se demande de quoi son père est-il le nom ? En tous cas, le prénom Jacques devenu Jacky est devenu une antonomase, un symbole de ces hommes des milieux populaires des années 80. Ceux que certains appellent les beaufs. Passeron ne masque pas la dimension stéréotypée de son père (le goût pour les voitures et leur bricolage, la survalorisation de la virilité et de la bagarre, la domination adulte et masculine). Mais il propose un portrait de son père bien plus nuancé : un homme fasciné par les innovations technologiques, par le cinéma et la liberté.