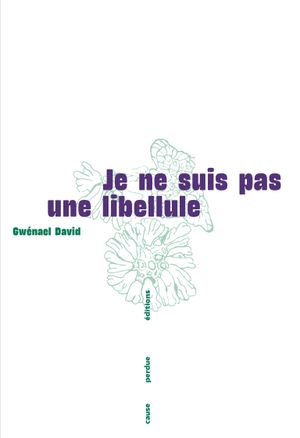Gwénaël David titre qu’il n’est pas une libellule. Il aurait pu déclarer l’inverse. Comme on déclare être quelque chose pour manifester une empathie avec la chose, un devenir commun, une solidarité. Nous sommes la Terre qui se soulève, disent les Soulèvements. David n’écrit pas de mots d’ordre. Son premier souci est d’être précis. Précisément, David n’est pas une libellule.
Anax ephippiger dont j’ai déjà parlé avec tendresse, voyageuse maghrébine soumise aux bourrasques du sirocco. Celle-ci a l’abdomen tordu, ça arrive, mauvaise position lors de la séance de tatouage.
On apprend donc au dernier chapitre qu’il en a plein tatouées sur le corps. On apprend tout au long du livre qu’il en sait beaucoup sur elles, que ce savoir décuple sa sensibilité. Mais Gwénaël David n’est pas de la famille des odonates. Ce n’est pas vraiment parce qu’il est un homme et qu’il y aurait des divisions immuables, plutôt parce qu’il y a des mots et qu’ils fonctionnent. Que ces mots peuvent se référer à plein de petites choses très précises, des libellules bien sûr, mais aussi des humeurs, des affects, de la végétation, de la matière inerte, des actions (forcément la méticulosité de l’auteur échappe à une énumération qui tente de la synthétiser). Et ce n'est qu’en saisissant ces petites choses qu'il est possible d'aborder leurs rapports, leur entremêlement complexe.
La caractéristique la plus évidente de cette manière d’écrire est la mention systématique des noms scientifiques de chaque espèce de demoiselles et de libellules. Anax ephippiger - des noms scientifiques comme des prénoms d’insectes. Mais cette manière d’écrire ne s’y restreint pas.
Le réel de cette famille surexcitée existe évidemment puisqu’elle est venue à vélo sur une route, conduite par une appli de smartphone jusqu’au saule où des objets (Playmobil, géocoin) ont été cachés par d’autres.
Même vis-à-vis de ce qu’on imaginerait irriter l’auteur, celui-ci prend le temps d’être précis. Il n’y a pas de points de suspension dans la parenthèse : David indique l’ensemble des objets recherchés par la famille surexcitée. Il a pris le temps d’inclure, par son observation et la restitution de cette famille, un réel qui a priori n’est pas le sien. La précision de l’auteur, dans ce cas-ci, aurait pu ne se traduire que par un simple énoncé. Mais David façonne une phrase aussi dense et efficace que pour le reste. Il fait usage de la même poétique pour retranscrire ce réel-ci. Il fait usage de cette poétique sans discriminer ses objets, qui sont ainsi mis à totale égalité.
David s’efforce de maintenir l’équation entre les mots et les petites choses, les mots et la vraie matière. Il tente de tout traiter de la même manière. Il se désole lorsqu’il échoue. Alors qu’il suit un ruisseau pour observer et lister des odonates, il croise un chasseur. Tandis qu’ils s’observent, l'auteur restitue ses propres pensées.
Je pense au Styx qui se substitue au ruisseau. Je suis du côté terrestre et le chasser de celui de l’Enfer avec sa pétoire et sa sexualité morbide. Ça me fait ricaner à l’intérieur mais voilà, ça y est, j’ai perdu, car le cours d’eau H2O et ses milliards de cellules avec ou sans noyau s’estompent au profit d’autres ondes, cérébrales. J’ai lâché ma matière pour des images, les vies pour du sens, j’ai recouvert l’eau d’un drap intellectuel, d’un récit j’ai quitté les mondes pour le mien exclusif.
Les idées prennent le devant et font monter l’auteur en métaphores, alors que lui voudrait rester au plus près de ce qu’il voit, de ce qu’il perçoit de tous les éléments l’entourant. Seul un effort pour rester micro permet de se rendre perméable à d’autres mondes, d’autres régimes de sensibilité. Le drame ne serait pas l’existence du chasseur, mais son effet sur le rythme de David, sa disponibilité interrompue. Le macro évacue la possibilité du micro. Le macro impose des généralités, minore l'acuité de l’entomologiste et les mots de l’écrivain. Il est étranger au délicat équilibre qu'exige de n'être qu'à ses sens.
A force de mouliner, de penser à des conneries, de penser tout court, de batailler pour revenir, je rate les vies.
Le livre est un ensemble de scènes vécues par l’auteur, où se croisent et interagissent des animaux, des rivières et d’autres personnes dont les objectifs ne sont pas toujours l’observation. Leurs intérêts sont parfois opposés à ceux de David. Mais ces personnes ne sont pas jugées. Le chasseur n’est pas jugé, pas plus que le conducteur de travaux ayant comblé un ruisseau, l’agriculteur d’abord hostile aux naturalistes qui foulent son champ. L’auteur lui-même ne se juge pas lorsqu’il attrape une libellule avec son filet, qu’il la prive un instant de liberté. Au contraire, les mondes de chacun sont ressaisis avec précision. Tout est à égalité, le texte pourtant court fait droit à tous les affects, toutes les sensations. Il se laisse habiter. David parle de dissolution. Lecteur, on se dissout avec lui et on se surprend donc à tout comprendre. Le vrai et faux embarras du conducteur de travaux devant les naturalistes, les dilemmes d'un attaché d’administration, la propriétaire qui montre son enthousiasme pour le serpent qu'elle a par ailleurs tué au rotofil, le chien qui mord. On se surprend à s’émouvoir de toutes ces situations.
Par des phrases précises, denses, savantes, la saisie de tous les mondes et de toutes les vies participe à la construction d’une sensibilité chez le lecteur. Au diapason de celle de l’auteur. On prend le temps de voir l’entremêlement des choses, on s’en délecte. Le style de Gwénaël David, au ras du sol, méticuleux, refrénant les envolées mais subjectivant tout de la même manière, nous le permet. Le style de Gwénaël David est une éthique. Pas parce que ce style préconiserait des actes. Parce qu’il est la traduction textuelle d’une pratique et d’une façon d'être au monde, parce qu’il donne à en ressentir la joie.