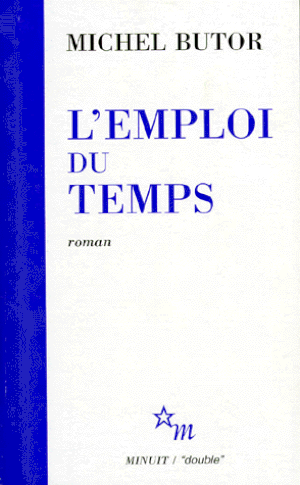De ce moment littéraire insignifiant que fut le Nouveau roman, Butor seul restera peut-être dans les mémoires. D’abord parce que de nombreux lycéens français étudient la première page de La Modification pour préparer le bac. Ensuite, parce que, moins imbu de lui-même que l’imbitable Robbe-Grillet, il apparaît comme un bien meilleur écrivain (le défi n’est pas bien grand).
L’Emploi du temps, s’il est loin d’être un chef d’oeuvre, part quand même d’un projet plutôt intéressant. Il s’agit, dès les premières pages, et par plusieurs moyens littéraires, de perturber le lecteur dans ses habitudes de lectures. Et cette destabilisation ressentie par le lecteur sera en imitation de celle éprouvée par le protagoniste, Jacques Revel, lorsqu’il débarque dans cette ville anglaise imaginaire, Breston.
Cette entreprise de destabilisation est le coeur même du projet du roman. Pas de narration au sens classique du terme, pas d’action (dans le sens que, finalement, il ne se déroule rien ici), pas de psychologie. Butor crée un lieu déconnecté de la réalité pour y développer une sorte de jeu littéraire.
Le lecteur est d’autant plus troublé qu’en apparence, le roman semble prendre une forme classique : nous serions donc en terrain conquis. 300 pages, divisée en 5 parties, elles-mêmes divisées en chapitres, eux-mêmes connaissant des entrées chronologiques, comme un journal (1er mai, 2 mai, etc.).
Sauf que, très vite, on s’aperçoit que quelque chose ne va pas dans cette organisation chronologique. D’abord parce que, si on change de jour dans le chapitrale, passant, par exemple, du 1er au 2 mai, on ne change pas de jour dans l’action, qui semble se poursuivre. De plus, dans les premières pages, le chapitrale annonce le mois de mai, alors que la narration affirme que l’action se déroule en octobre.
Ce décalage trouve vite une explication : la date indiquée n’est pas celle de l’action, mais celle de l’écriture du texte. Or, généralement, l’action d’écriture romanesque est cachée, dissimulée derrière des la narration qui, depuis le XIXème en particulier, se doit d’être réaliste. Or, c’est bien ce réalisme, ces effets de réel qui sont démontés ici par Butor. En notant ces dates à intervalles réguliers, l’auteur veut que l’on garde en mémoire que nous sommes dans un texte artificiel, un roman inventé et déconnecté de la réalité du monde. De plus, ces changements de dates, qui se font très régulièrement (toutes les deux ou trois pages en moyenne) saucissonnent le récit, coupant parfois en plein milieu d’une action.
Butor voudrait que l’on s’éloigne de la narration, de l’action racontée, qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
Autre élément intéressant : la description de la ville. Le roman se déroule dans une ville britannique imaginaire, Breston. Butor nous en fournit un plan en début de roman, et le narrateur va nous la décrire en longueur, puisqu’il va déambuler dans ses rues à la recherche d’un logement.
Or, ces descriptions sont faites de telle façon qu’elles nous rendent la ville incompréhensible. C’est un petit tour de force de la part de Butor : alors qu’il nous fournit un plan de la ville (comme son narrateur, qui possède également plusieurs plans de Breston), il parvient à nous y perdre, transformant la cité en un labyrinthe noir, enfumé et inextricable.
Là aussi, il est possible d’y voir un jeu avec les codes romanesques : fournir un plan de la ville devrait permettre plus de clarté, tout en conférant un certain réalisme, une réalité tangible à la ville. Or, ici, c’est l’exact opposé. Non que la narration contredise le plan : elle se contente de rendre la ville « illisible », son enchevêtrement de rues incompréhensible.
Au début du roman, les phrases sont simples, claires. Mais plus on va avancer, plus Butor va faire des phrases complexes, dans le sens grammatical de l’expression (les phrases vont se rallonger considérablement, au point qu’une phrase va recouvrir tout un paragraphe) ; mais l’adjectif « complexe » s’y applique très bien car ces phrases vont encore embrouiller le propos. Ainsi, le sujet principal de la phrase va se perdre dans une profusion de détails qui empêchent de se faire une idée exacte de ce que le narrateur veut décrire.
Pour reprendre ce que je disais au début, tout ces procédés finissent par déstabiliser le lecteur, pour le mettre dans un état proche de celui que ressent le personnage. Mais aussi, par son refus de l’action, sans cesse avortée ou rendue incompréhensible, L’Emploi du temps semble renvoyer à un simple jeu avec les codes littéraires. Le but affiché est de rompre avec le réalisme littéraire en vogue dans le roman depuis le XIXème siècle (ce qui est l’objectif revendiqué par le Nouveau roman en règle générale, si je ne me trompe pas). En cela, il faut admettre que Butor le fait de façon plus réussie, plus supportable que ses camarades, mais aussi que tout cela est très vain.