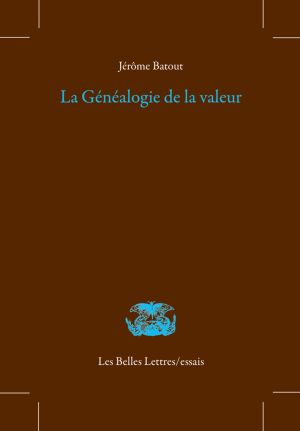Le texte suivant n'est pas une "critique" mais une fiche de lecture personnelle que je me permets de partager afin d'éventuellement donner envie à certaines personnes de lire La Généalogie de la valeur. Les formulations sont donc parfois approximatives et les transitions lapidaires voire inexistantes.
***
La Valeur est l’axe d’une société. C’est à partir d’elle que la puissance, l’autorité et le pouvoir dans ces sociétés se sont historiquement définis. Elle est une sorte de cadre culturel à toute société.
Volonté de constance, volonté d'abondance, volonté de croissance : il s’agit là de trois rapports à la valorisation de la Valeur dans les sociétés humaines, (et non de trois modes de production au sens marxiste), donc trois cadres culturels (et non « économiques ») qui expliquent trois grands modèles de société :
I - Société de la reproduction (sociétés premières – « primitives ») : reproduire la Valeur telle qu’elle est identifiée aux ancêtres. Reproduire le Passé Pur. Le pouvoir est ailleurs, en dehors de la société, situé dans le passé. Le chef est celui qui est reconnu comme étant le plus proche de la Valeur (des ancêtres), mais il ne détient pas vraiment le pouvoir (cf. Big man). Il n’y a pas de production car cette catégorie implique une visée pour l’avenir. Or, ces sociétés visent le passé et non l’avenir. Ils valorisent les mêmes choses que nous (guerre, puissance…), mais autrement, sur un autre mode, ce qui rend ces sociétés difficiles à comprendre pour nous.
II - Société hiérarchique (Anciens). Différence radicale entre ceux qui travaillent, et les autres. L’esclave pro-duit (c’est-à-dire : présente « auprès de », au sens de « produire » une preuve devant le juge, dans le contexte d’un procès) la Valeur auprès du maître qui s’en revendique. Dimension symbolique de la valeur, donc ? Le maître comprend l’englobement et doit se présenter comme le premier qui a englobé, l’englobement est la valeur et doit se calquer sur la Nature qui est elle-même englobante. L’englobement hiérarchique (social) est lui-même englobé par la Nature (hiérarchique également), la hiérarchisation est valorisée en tant que telle, elle est axe de la société.
Critique personnelle : cela me paraît très large et en fait assez flou. Il me faudrait des exemples concrets pour que je puisse saisir ces enjeux.
Sur le commerce dans ces sociétés, elle se base sur un prix définie par la valeur par nature de l’objet, le prix n’est pas défini par un marché auto-régulateur. L’économie n’est nullement au centre de la société dont l’axe reste la hiérarchisation et l’englobement. Le chef dit la valeur des objets, valeur qui n’est pas fixée par un marché auto-régulateur (économie).
Les Phéniciens, peuple commerçant de l’Antiquité, sont des marchands qui naviguent d’empires en empires. Ils servent de sas entre ces empires qui n’ont pas de contacts entre eux par le commerce ; la Valeur de chacun de ces empires est donc respectée puisque les mettre en concurrence la « diminuerait » en quelque sorte. Le prix est fixé comme précisé ci-avant et dépend du chef de l’empire hiérarchique auprès duquel le marchand se présente ; les unités de mesure sont différentes dans chaque empire, ce qui démontre par ailleurs leurs manières différentes de valoriser la Valeur.
Les sociétés de la Grèce, de Rome et du Royaume Juif (Antiquité) sont successivement étudiées, mais cela vaut visiblement aussi pour la Chine et d’autres royaumes/empires d’Orient (?). Ce n’est jamais tout à fait précisé.
Crise de la société hiérarchique et trois réponses à cette crise :
- Concernant Athènes, ils ont trop de groupes sociaux aux intérêts différents, la hiérarchie est brouillée par l’économie entre les cités et Athènes répond par l’inversion de la hiérarchie : la démocratie, et cela afin de chercher à arbitrer parmi tous ces intérêts, mais ce modèle ne tient pas la route (dure environ qu’un seul siècle) puisque contraire en soi au caractère hiérarchique de cette société.
Sparte répond inversement à la crise par la rigidification du système hiérarchique et l’abandon du commerce. La Cité tend vers l’égalité mais garde une classe sociale exclue afin de justifier la hiérarchie : les Hilotes.
- Pour des raisons historiques (ils conquièrent d’anciens alliés), les Romains prennent quant à eux conscience (réflexivité) du caractère temporaire (dynamique) de la Valeur, ils cherchent à s’étendre tout en reconnaissant une valeur (en potentiel) chez les chefs des conquis, ce qui explique l’étendue et la stabilité de l’Empire. Les Romains prennent conscience de la Force (au sens large de dynamique de l’action humaine et de sens donné à ces actions) comme moteur de la Valeur (dialectique Force – Valeur) et de l’importance de la reconnaissance de l’autorité. L’auteur met manifestement en avant les avancées historiques de la société romaine en ce qu’elle aurait compris de nombreux éléments importants relatifs au fonctionnement de la Valeur.
- Les Juifs se retrouvent sans État ni territoire pour des raisons historiques. La religion les fait tenir de manière tout à fait exceptionnelle alors que la religion n’est censée servir qu’à expliquer les aléas de la Valeur (perte d’une guerre qui provoque une baisse de la reconnaissance du chef, etc.). Leur réponse à la crise de la Valeur est donc une réponse religieuse, ils inventent la Loi et le Dieu tout-puissant (monothéisme) qui la prononce depuis les Cieux. Cette omnipotence religieuse compense l’absence total de pouvoir terrestre au sein du peuple Juif. Le Dieu est puissance, autorité et pouvoir.
Le schème de la Fin se met en place aux alentours du 1er siècle afin de répondre à l’émergence de la production (la Force en tant que dynamique qui donne lieu à la conquête romaine). Il faut axer cette Force.
L’analyse de la « cause à effet » émerge, elle n’existait pas chez les Anciens. La Valeur devient petit à petit instrumentale, utilitaire. On vise des buts moraux (écrits de Cicéron), historiques (Jésus – la Fin chrétienne de l’Histoire), géographiques (Auguste délimitant le territoire fini de l’empire)…
Il y a par ailleurs une dialectique Force – Production depuis deux millénaires environ (depuis Rome ?). La Force doit être comprise dans un sens large (c’est le sens donné au monde, c’est l’agir humain…). La production est dynamique et engendre un surplus de conscience de la production.
III - Société de la production (Modernes). A compter de l’an Mil environ, la « pro-duction » devient « production » (utiliser la force dans un rapport de cause à effet, viser l’avenir...) : la guerre (production par la rapine) puis la production dans les champs (paysannerie) deviennent « force de production » (cf. G. Duby).
La puissance se mesure à sa proximité avec la Valeur dans les sociétés premières et hiérarchique, ce qui permet l’autorité qui donne le pouvoir de dicter la loi. Dans la société Moderne, les termes ont été inversés : la Valeur se mesure à la puissance (Force, devenues forces de production). Marx est le point final de ce renversement : l’Histoire est forces de production. La puissance n’est donc plus mesurée (elle l’était auparavant par sa proximité avec la Valeur), elle est puissance pour la puissance (croissance pour la croissance), désaxée, sans but, donc sans mesure (mesure qui permet aussi de « contenir »). Et le pire peut advenir, sans mesure.
On commence à parler de « valeurs » (au pluriel) lorsque la Valeur a disparu, dans la seconde moitié du XIXe siècle. La crise de la Valeur mature pendant cette période, puis « explose » (mon interprétation) au XXe siècle qui se joue alors comme un concentré « d’épreuves de force » de modèles d’axes de société qui cherchent à s’imposer, ce qui explique ce siècle si mouvementé, violent, troublé.
Basculement pendant la seconde guerre mondiale vers la société de la croissance (économique) pour la croissance. Il n’y a plus de fin assignée à la société, plus d’axe si ce n’est un axe négatif (valeur négative qui ne peut être considérée comme une Valeur puisqu’elle est sans contenue).
La Valeur est normalement un lieu, un topos, et non une chose. Elle est devenue une chose (l’Argent ?) dans les sociétés Modernes ?
Généalogie et analyse de la valeur = Axiologie, c’est de ce point de vue que la société en tant qu’ensemble doit être analysée, selon l’auteur. Quelle Valeur fait tenir notre société ? Aujourd’hui, plus aucune puisque la Valeur a été identifiée à la Force qui tourne sur elle-même.
Cette crise finale de la Valeur se retrouve au niveau individuel dans le rapport des individus à la mort, qui devient un phénomène impossible à comprendre pour eux. Dès lors, l’allongement de la vie devient un but en soi afin de simplement préserver des « potentialités de puissance » (Force) impossibles à déterminer de manière précise. Il faut vieillir bien et tard sans raison apparente. On veut faire plus de choses, sans précisions.