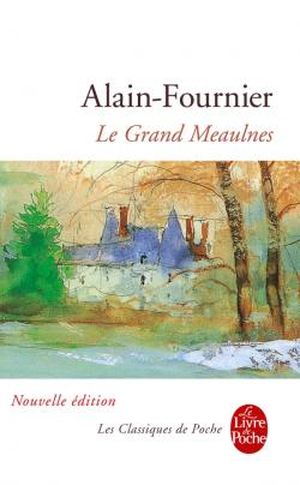Un roman qui souffre d'excès de sentimentalisme, de mièvrerie. Et ce n'est qu'aidé par la mort tragique de son auteur, que le Grand Meaulnes put être admis au Panthéon de la littérature française. Le récit baigne dans une mélancolie excessive, grossière autant par le style que le fond ; l'esthétique se veut dixneuvièmiste, elle est – à l'heure où paraît La recherche du temps perdu, où Joyce commence à travailler son Ulysse, où Apollinaire s'essaye à la poésie visuelle – tout juste vieillotte.
L'épisode des noces dans le pays perdu contraste disproportionnellement : du réalisme de l'école et du village, on passe au conte de fée, au quasi-fantastique (déguisements, musiques suspendues, brouillage de l'espace et du temps). Et c'est là, précisément, le nœud du problème. Tout le projet d'Alain-Fournier se dévoile par son déséquilibre : ses influences se massifient en un patchwork hétérogène, comme s'il n'avait su qu'écrire une caricature réunissant à la fois les vestiges décatis du romantisme et du symbolisme, les poncifs naïfs du roman d'aventure et d'apprentissage et l'onirisme enfantin de certains romans fantastiques. Planent simultanément les ombres de Stevenson, de Sand et de Rousseau – mais affadies, dépouillées de leur souffle originel. Il y a, en somme, chez Alain-Fournier une sorte de crédulité esthétique : un palimpseste où se mêlent, sans hiérarchie ni mise à l'épreuve, plusieurs mythologies (celles de l'enfance, des amours perdues, du vagabond mélancolique, du souvenir, de la ruralité...).