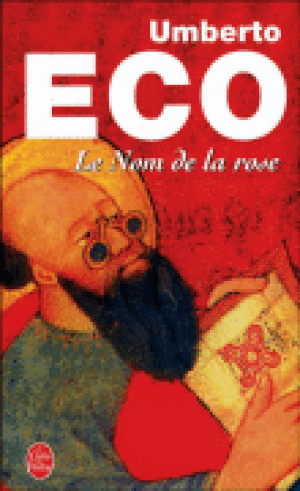Au débouché des Apennins, dans les derniers sursauts montagneux que borde la vaste plaine lombarde, toisant d'un regard dédaigneux le petit amphithéâtre marin de Ligurie, l'édifice imposant d'une abbaye que tout désignait à la sérénité d'une vie hors du Siècle, darde vers les cimes nocturnes le feu qui dévore ses pierres et ses livres. Près de vingt ans plus tôt, loin vers l'Ouest, bien au-delà des domaines provençaux du Saint-Empire, du siège pontifical fraîchement installé en sillon rhodanien, loin encore des coteaux languedociens où vignes et pins partagent désormais une incontestable souveraineté avec la dure royauté capétienne, tenant à flanc gauche les champs bosselés du Lauragais et les solitudes de la Montagne Noire, petit pays de Sabarthès encastré dans les premiers contreforts pyrénéens, le village de Montaillou livre lui aussi sa belle charpente d'habitants à la torche implacable des hommes du Comte de Foix et à la pompe incendiaire de l'Inquisition carcassonnaise. Deux dates, 1327 et 1308, deux grands théâtres, l'Italie septentrionale et l'Ariège, deux auteurs, Umberto Eco et Emmabuel Le Roy Ladurie, deux best-sellers monumentaux de la seconde moitié du XXème siècle.
Il est en effet tentant de rapprocher les deux œuvres, tant elles présentent de thématiques communes : l'Inquisition, les hérésies méridionales, les éclatements de l'orthodoxie, la ruralité et ses sociabilités particulières, telles sont les convergences les plus saillantes. Plus tentant encore serait de les comparer sur ce qui les oppose radicalement. Deux différences retiennent mon attention : la plus évidente tenant à leur nature (un livre d'histoire chez le premier, un roman chez le second), l'autre, plus intéressante, tenant au prisme particulier qui grève la narration : Emmanuel Le Roy Ladurie s'est appuyé principalement sur les registres d'inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers et futur pape Benoît XII, pour ressusciter Montaillou médiéval. Partant, et c'est là la grande critique retenue contre lui, l'auteur s'est laissé prendre au piège d'une source qu'il croyait à bon droit exceptionnelle, mais qui exigeait de lui un regard critique, une mise en perspective qui aurait dû l'empêcher d'y puiser à chaud les éléments d'une photographie sociale et politique du village. Point de Maury en effet, de Pierre Clergue, ni Bélibaste qui ne soit narré autrement que par un inquisiteur dont la perception est guidée par les missions de son office. Témoins ou déposants dans le cadre d'une procédure d'enquête, les humbles montalionnais n'apparaissent jamais dans leur vérité nue, comme semble nous le promettre l'introduction, mais dans une débâcle judiciaire où se jouent en réalité leur identité religieuse et leur survie.
La démarche d'Umberto Eco, quant à elle, est un parfait contrepied, puisque le point de vue de l'Inquisiteur est sans cesse écarté, ostracisé, caricaturé à l'extrême pour mieux tenter de voir au-delà du voile projeté par ses obsessions. Le récit est constamment guidé par la Libido Sciendi qui attise chez Guillaume de Baskerville l'appétit du vrai, tant dans l'enquête dont l'abbaye lui a confié la charge que dans les arts libéraux où sa verve de débatteur semble puiser toute la matière argumentative. Le mode narratif du Nom de la Rose procède ainsi d'une subjectivité pleinement consciente, là où Montaillou, Village occitan, en se livrant corps et âme au discours de l'inquisiteur, procède d'une subjectivité feinte ingénument. Une fracture d'autant plus étrange et paradoxale que Le Roy Ladurie écrit un livre d'histoire là où Umberto Eco produit une œuvre de pure invention.
Qui suis-je toutefois pour distribuer bons et mauvais points à deux auteurs qui resteront de toute façon des monuments chacun dans leur littérature ? Mal m'en aurait pris. Je me plais seulement à les confronter pour mieux tirer du Nom de la Rose ce qui me semble être le propos essentiel, celui du rapport au vrai. Le Moyen Âge d'Umberto Eco est en effet peuplé de discours plus ou moins autoritaires sur la Vérité, qui s'accordent ou s'entrechoquent selon les circonstances et les intérêts de ceux qui les portent. La vérité de l'Inquisiteur est sans conteste la plus avide d'obéissance forcée, se résumant aux garanties d'efficacité dont l'institution a besoin pour se légitimer, que son fonctionnement soit, ou non, une offense au sens commun. La condamnation du pauvre cellérier Remigio de Varagine est éloquente à ce sujet, qui permet à l'infâme Bernard Gui de faire d'une pierre deux coups : donner une résolution expéditive aux crimes commis dans l'abbaye en condamnant un hérétique fabriqué de toute pièce. Ne donnant en réalité aucune solution concrète aux incidents qui secouent la communauté, sa mission auprès de l’Église conserve malgré tout sa justification, qui est de préserver le clergé de la déviance ennemie, de l'élément hétérodoxe et subversif. Peu lui chaut que ces hérésies soient projetées arbitrairement sur les brebis galeuses du grand troupeau des fidèles, puisque ce petit édifice de vérité va tout seul de son petit équilibre, Saint Irénée et Saint Augustin tirant de part en part leur canonique fil à plomb.
La vérité de Jorge de Burgos est elle aussi trempée dans l'autorité de sa puissance agissante, et ne vaut pour autant qu'elle conforte l'idée d'une grande prophétie eschatologique. Cette conviction qu'il a de vivre un temps de décadence et sa prétention exclusive à la pureté doctrinale, le conduisent non seulement à ne pas détruire le second tome de la Poétique d'Aristote, mais à laisser ses frères s'y abreuver et s'y damner comme des bêtes au seuil d'une lavogne empoisonnée. La vérité d'Ubertin de Casale est d'un ordre presque équivalent, mais ne l'engage pas sur les voies de l'hécatombe et du fratricide. Celle de la légation de Michel de Césène, antagonique mais figée elle aussi dans un monolithe de certitudes absurdes, est celle qui confère à l'ordre franciscain un monopole de prédication, renvoyant le clergé séculier à ses juteux marchés urbains, et la papauté à ses simonies et son goût pour le sacrilège, quand elle ose ceindre ses tiares d'une troisième couronne d'or ou flanquer le Christ de bourses rutilantes. C'est d'ailleurs pour l'auteur (encore et toujours) matière à rire, lorsque, remonté par les prétentions réformatrices de Jean XXII en matière pastorale, l'évêque de Caffa s'exclame : « Et que raconterons-nous alors aux pécheurs, si nous ne pouvons les menacer d'un enfer immédiat, dès l'instant où ils meurent ? » Umberto Eco s'amuse des sentiments contradictoires qu'une époque et des mœurs éloignées peuvent exciter chez son lecteur. Ainsi de cet ordre franciscain dont les combats contre la papauté d'Avignon nous attirent tantôt la sympathie, mais dont la morale archaïque confine également au risible.
Dans cet embrouillamini d'acteurs, inquisiteur, abbé, légats du pape, spirituels, franciscains et bénédictins que les circonstances ont tous conduit à former « d'étranges alliances », seule semble surnager la vérité de Guillaume de Baskerville, qui ne sert aucun dessein particulier, aucun intérêt supérieur, et surtout ne se déploie pas à travers un discours dominateur, asservissant. Il est le seul à ne pas s'enfermer dans une conception monolithique du monde, seul à reconnaître à la Vérité une polysémie qui la rend précisément insaisissable. C'est cette relativité des croyances avant la lettre, qui lui permet de se conformer à l'idéal apostolique de son ordre, sans toutefois mépriser les conceptions de ses hôtes bénédictins, dont la Règle s’accommode volontiers de l'éclat du mobilier liturgique, ou de ces perles scintillantes qui ornent les crucifix de l'abbatiale. C'est aussi ce qui lui permet de faire sienne la théologie du dogme sans pour autant rejeter dans les caves de l'hérésie l'apport des « auteurs païens », Quintilien, Tacite, Pline le Jeune, mais surtout Aristote et derrière lui, Saint Thomas d'Aquin et le syncrétisme de sa Somme théologique. Guillaume de Baskerville avance dans le contexte troublé de son époque sans dispenser de jugements expéditifs, reconnaît aux savants une hauteur de vue, la noblesse du travail intellectuel, mais leur reproche de trop souvent « se perdre à la recherche des lois les plus générales ». Il reconnaît aux simples « une intuition de l'individuel », mais leur reproche aussi de verser souvent dans une violence irréfléchie. Il n'est pas pour lui d'orthodoxie ou d'hérésies qui ne sache enfin se définir par rapport aux pouvoirs qu'elles servent : la première, une papauté dont l'autorité spirituelle ne souffre aucun partage, les secondes des empereurs, des seigneurs et des princes qui arment les bras des simples au nom d'obscures combinaisons politiques.
En somme, Guillaume de Baskerville se méfie des mots, des noms que l'on attribue à tout ce qui compose la réalité sensible, le monde matériel. Tout au contraire, son seul plaisir, qui est aussi sa seule source d'orgueil, est de briser le sceau des apparences, lever le voile que les mots jettent sur les choses, affûter sur elles un regard condamné à "mieux voir", et non les voir telles qu'elles sont, deviner ce cheval dissimulé sous des empreintes laissées dans la neige, « démêler un bel écheveau bien enchevêtré » pour reprendre sa propre parabole. En cela, l'ingénieux franciscain n'est pas seulement l'alter-ego du célèbre détective d'Arthur Conan Doyle, mais un homme dont l'esprit fougueux et indépendant l'attache bien plus à notre propre modernité, où la religion depuis longtemps sécularisée ne coule plus sur les consciences individuelles une chape de plomb monumentale. Ainsi les problématiques philosophiques et religieuses que ce XIVème siècle pré-schismatique lui opposent presque constamment sont pour lui, comme pour nous, autant d'obstacles terribles où achoppe une Common Decency délicieusement anachronique. Conscient de ne pas détenir les clés d'une Vérité universelle, Guillaume de Baskerville se contente d'un monde qui, somme toute, n'a peut-être aucun ordre prédéfini. Et la Rose, justement, peut-être se garde-t-il tout simplement de la nommer pour ne point la souiller.
Jean Giono, dans son admirable Triomphe de la Vie, avait lui aussi son petit refrain sur les roses et les noms qu'on leur donne. Un bref extrait me permettra de conclure sous la forme d'une apostille à l'apostille :
J'ai souvent écrit devant quatre roses. Elles sont des quatre espèces que j'ai dans mon jardin. Il y a une « Marie-Angélica », une « Anna de Diesbach », une « Blanche Flow », et une « Deuil de Paul Fontaine ». Elles ont des noms de femme, et même le nom d'une affection. Cependant, rien n'est plus différent de moi qu'une rose. Elle me touche à un endroit que ni une femme, ni une affection ne touchera. Car, si la femme ou l'affection me touchent à cet endroit-là, ce sera par comparaison, c'est-à-dire par reflet de la rose [...]. Élément de richesse, la rose est tout ce qu'elle veut, sauf moi ; elle n'est personne d'autre que la rose. Et j'ai beau lui donner le nom de rose, ce n'est pas son nom ; ce n'est qu'un moyen arbitraire de me souvenir d'elle ; son nom c'est exactement : ce qui n'est pas l'homme.