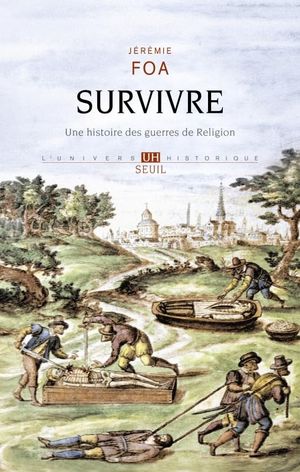Lucien Fèbvre se désolait dans ses propres pages que le XVIe siècle fût encore de son temps une "page vierge (…), un grand manque, un grand abîme de notre connaissance des hommes et des choses de ce temps." Il n'entendait guère par là que le XVIe siècle manquât d'historiens prolixes pour passer au peigne fin des dossiers maintes fois ouverts et refermés, poncés, vidés jusqu'à la lie, depuis la Réforme et les premières Guerres de Religion, jusqu'aux écrits de Luther, Calvin, Zwingli, en passant – tant qu'à faire – par les Guerres d'Italie, la Renaissance intellectuelle et artistique, quelques charrettes encore de biographies princières, de philosophie humaniste, le tout rutilant déjà en 1942 sur des kilomètres de bibliothèque. Non bien sûr, il y eut de très bonnes plumes pour tracer à tout cela de belles épures, élégantes et abstraites. Ce que Lucien Fèbvre voulait pour son XVIe siècle, c'était comprendre en profondeur les sociétés et les individus, descendre dans l'abîme des mentalités et des habitudes quotidiennes, des structures conscientes et inconscientes, se mêler réellement à la vie du siècle, à tout ce que son ciel abritait sous une arche épaisse et qui nous est à nous, citoyens du XXIe siècle, totalement étranger. L'appel du pontife des Annales a depuis longtemps levé de beaux régiments, mais il est encore aujourd'hui des historiens pour amener leur pierre à l'édifice. Survivre de Jérémie Foa en est une, n'en doutons pas, qui se propose de faire des Guerres de Religion (1562-1598) une histoire par le bas, ayant tout à la fois le souci profond des hommes, des milieux, des choses et des discours.
C'est au bras de Montaigne que l'exposé commence, en 1572, cheminant le cœur anxieux en compagnie d'un homme que les apparences faisaient bon sous tout rapport, et dont l'écrivain découvre incontinent qu'il était « du parti contraire », c'est-à-dire protestant :
Je n'en sçavois rien, écrit-il, car il se contrefaisoit tout autre ; et le pis de ces guerres, c'est que les cartes sont si meslées, vostre ennemy n'estant distingué d'avec vous de nulle marque apparente, ni de langage, ny de port, ny de façon, nourri en mesmes loix, mesmes meurs et mesme foyer qu'il est malaisé d'y eviter confusion et désordre.
On pourrait dire que le livre est tout entier contenu dans cet exergue, car il importe à Jérémie Foa d'explorer une société que la guerre civile a jeté dans un océan de duplicité, une France certes divisée entre protestants, catholiques et ligueurs, mais qui est également restée la même en apparence, pure de tout champ de bataille, d'armée levée tambour battant, une France que la guerre ne fracture pas entre « le front et l'arrière », où les acteurs déploient des prodiges d'efforts pour dissimuler au commun leur obédience, ou mener sur le voisin, le proche, le frère, des enquêtes si récurrentes qu'elles en deviennent des habitudes acquises. Le monde des Guerres de Religion est un monde du doute permanent et de la paranoïa sociale où il est toujours question de dissimuler, paraître, débusquer pour survivre.
Une atmosphère de stasis – la guerre civile dans le langage savant – baigne ainsi le quotidien des villes et des campagnes. Bourgeois et paysans, clercs et nobliaux y vivent sous l'injonction nouvelle du « Qui vive ? », l'ordre intimé de se découvrir, de dévoiler son camp, sa foi, et dont l'auteur s'empare pour saisir sur le vif ce XVIe siècle de vigilance maladive. Baisser la garde, céder aux apparences, ne point se questionner ni traquer chez l'autre l'indice extérieur qui pourrait le trahir, c'est prendre le risque de périr sous le poignard ou le mousquet dissimulé dans la casaque de l'honnête gentilhomme, les braies du laboureur, sous le capuchon de l'itinérant, ces oripeaux de l'ordinaire que nul désormais ne considère sans inquiétude. Combien de villes huguenots et royalistes n'ont-ils pas assiégées grimés en paysans à charrettes, prétextant le ravitaillement pour franchir aisément un pont-levis ? Combien d'innocents percés de carreaux pour avoir ignoré le « Qui vive ? » La presse du temps rapporte quantité de nouvelles montrant
combien les corps, les postures, les émotions sont épiés par les voisins, qui guettent sur les visages le moindre indice suspect et sont prompts à noter la rougeur naissante ou le sourire crispé. Un monde de suspicion où partout « l’œil doit se faire serrure, restreindre les circulations, douter du passant.
Lorsqu'un gibet flanque le tympan d'une maison ou lorsqu'au seuil, un rameau d'olivier chasse la statue de Saint Pierre, quand au jour des processions de la Fête-Dieu, des quartiers entiers refusent d'encourtiner les façades pour honorer le Saint-Sacrement ou, au contraire, lorsque des familles s'affairent les jours chômés, chantonnant des psaumes en langue vulgaire, quand elles font liesse et bombance en plein carême, alors le catholique sait que là est sa pâture. Nul refuge dans la chaumière, cible des perquisitions célèbres et redoutées de Guillaume Duchemyn, commissaire au Châtelet à Paris, si récurrent sous la plume de l'historien. « La perquisition est l'arme de l'explicitation, le rêve de transparence en acte ». D'où la nécessité partout où les affrontements font rage, voire sourdent simplement en lame de fond, de se cacher, de disparaître :
Rien ne dit mieux l'expérience spatiale de la guerre civile que ce méchant jeu de cache-cache citadin (…). Aux yeux des catholiques, les réformés sont des tireurs embusqués contre la vraie religion. Il faut mettre à bas les huis de leurs demeures, enfoncer les portes dérobées, interdire à l'espace de se dédoubler. Faire transparence. Pour les protestants de Paris, à l'inverse, le danger vient de la rue, et la maison avec ses cavités offre un refuge.
Dans la langue même, les journaux, les écrits, les textes de loi, la tonalité sourde du lexique a le parfum de guérilla. Les protestants ne sont point encore protestants mais « Ceux de la Religion Nouvelle » selon le premier édit de tolérance (1562), rapidement balayé, puis « Ceux de la Religion Prétendue Réformée ». Dans ses « Qu'ils appellent », ses « prétendues », « soi-disant », ses « comme ils disent », le registre catholique prend le parti d'une distance sans cesse marquée avec un vocabulaire certes commun, mais relégué dans le domaine de l'étranger, car parler du réformé, sous quelque forme que ce soit, c'est avant tout parler d'une bête curieuse et inintelligible. Dans les nombreux réquisitoires cités au long de son enquête, Jérémie Foa remarque d'ailleurs que le regard des catholiques et ligueurs sur les protestants est par bien des aspects similaire à celui des colons européens sur les tribus indigènes d'Amérique ! Pire, l'injure domine complètement l'espace littéraire, entre les « huguenots » et « papistes » que se donnent les uns et les autres, une ronde folle de quolibets rabaissant excite en permanence la raillerie et l'agression, guisards, maheustres, malcontents, bigarrats, némouriens, maroquins y fusent comme des poignards fielleux.
Le sens des mots est continument brouillé, détourné, d'où ce besoin une fois proclamé l'édit de Nantes de réintroduire une forme de sérénité, de sécurité sémantique. La création de l'Académie Française (1635), la multiplication des dictionnaires dans une ère de pacification et de coexistence religieuse ne tiennent pas du hasard, ni le succès d'hommes de lettres comme Malherbe, qui revendiquent dans la langue une forme de purisme plat. Michel de l'Hospital déjà au concile d'Orléans (1560), tentait bien vainement d'apaiser les rapports entre chrétiens des deux obédiences en les rassemblant tous dans le « cives », le citoyen sujet du roi. C'est cette idée de concorde et d'amitié un poil forcée qui avait présidé tous les édits de pacification entre 1563 et 1572. Au XVIIe siècle, les rhétoriqueurs bravaches, les plumes ensauvagées seront pour cela mis au ban de la société des Lettres, car le risque de ranimer les conflits par le seul effet d'un verbe tendancieux et putassier effraie désormais une société épuisée par les guerres civiles.
Voilà un rapide survol du livre qui, on l'aura peut-être deviné, mêle l'histoire à de véritables méthodes de sociologie et de sémiologie. Jérémie Foa n'y fait pas tant appel à d'anciens pairs défricheurs, comme Lucien Fèbvre, qu'à de grands auteurs des sciences sociales du siècle passé, Michel Foucault, Roland Barthes, Erwin Goffman entre autres. C'est un livre « écrit », à n'en point douter, avec un certain talent, mais que l'ambition pluridisciplinaire émaille tout de même de boursouflures. Non que l'auteur soit maladroit ni même contestable dans l'emploi de ses concepts, il les a de toute évidence acquis et fort bien digérés, mais ils ne sont jamais mobilisés sans cette pompe, goitreuse et infatuée, qui bien souvent déroule des évidences dans un jargon inutilement sophistiqué. Était-il bien nécessaire, pour souligner que l'espace urbain est progressivement divisé entre appropriation protestante et catholique, de parler « d'intentionnalité de l'être-là », de « sur-sémiotisation de l'espace public » , voire de « reconfigurations du montré et du caché » ?
Une sur-technicité du discours parcourt ainsi l'ouvrage dans son ensemble, qui donne l'impression, pénible à la longue, que l'auteur aime à dresser pour des cabanes à oiseaux de sublimes plans d'architecte. Ainsi des « non-humains » substitués à l'indélicate et barbare notion d'objet, « l'implicite supposable dans un état de non-déploiement » qui mâtine d'une exquise sophistication la bête tension urbaine en contexte de guerre civile, et que dire encore « des tactiques de délégation de survie aux objets et des réflexes de régression vers le corps » à quoi sont renvoyées les correspondances de huguenots en exil... Le florilège pourrait durer longtemps, de développements qui traînent sur 30 pages ce qui pouvait être dit en 15, avec cette emphase, cette décharge verbeuse qui bien souvent n'a rien à dire de bien extraordinaire. Une tendance que je crois déceler aussi chez d'autres auteurs actuels, tel Patrick Boucheron, qui loin d'usurper les qualités qui font d'eux d'excellents historiens, contractent bien souvent aux fleurs de la sociologie une dilatation de leur personne qui me laisse un peu las.