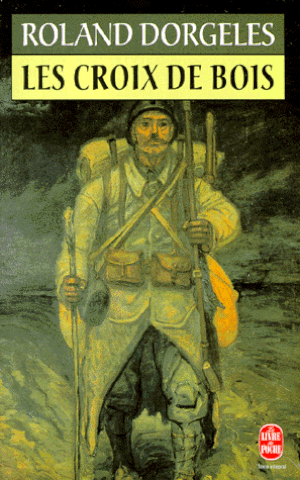On poursuit l’exploration de la Première Guerre mondiale avec Les Croix de bois de Roland Dorgelès, un roman écrit par un engagé volontaire, publié en 1919 alors que la guerre vient tout juste de s’achever. Pour moi, c’est une œuvre à mi-chemin entre Le Feu de Barbusse et La Peur de Chevallier : du premier, on retrouve la vie des simples poilus, leur langage, leur quotidien, mais sans la syntaxe pesante et militante de Barbusse, ce qui rend la lecture bien plus agréable. Du second, on retrouve la critique de la guerre et de l’arrière, mais cette fois portée davantage par les personnages que par le narrateur lui-même.
Le contexte de publication mérite d’être rappelé : Les Croix de bois faillit obtenir le prix Goncourt 1919, battu d’une voix par Proust avec À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Cette anecdote illustre bien la tension entre deux visions de la littérature : celle du témoignage brut, immédiat, et celle de la littérature pure, tournée vers l’esthétique. Dorgelès, lui, était au plus près du vécu collectif, et c’est aussi ce qui explique le succès immédiat du livre, mais sa postérité moindre par rapport à Le Feu ou à Proust.
La narration est double, voire triple. Double d’abord, car elle alterne entre les dialogues des soldats, souvent pleins d’humour, de lassitude ou de fatalisme, et les commentaires sobres du narrateur, qui vient affiner la scène sans jamais l’alourdir. S’y ajoute la voix du jeune Gilbert, bourgeois engagé volontaire, qui joue le rôle de témoin initiatique : c’est par lui que le lecteur entre dans cet univers, découvre ses codes, ses peurs, ses illusions. Lors de sa mort, Dorgelès prend le temps de nous faire partager sa douleur, rare moment d’émotion directe dans le roman, presque fusionnel avec le narrateur.
À travers les échanges entre poilus, le livre parvient à créer un véritable attachement : chacun incarne un archétype, le râleur, le poltron, le rêveur, le romantique. C’est tout l’inverse de L’Orage d’acier où les hommes semblaient réduits à des fonctions ou des statistiques. Ici, les pertes se ressentent, la mort laisse une empreinte. Il n’y a pas de dates précises ni de repères géographiques clairs : la guerre est partout, indistincte, comme un climat.
Les passages obligés de la guerre, les tranchées, la boue, l’attente, les obus, sont bien présents, mais Dorgelès se distingue par les moments à l’arrière ou dans les hôpitaux. Il y décrit avec justesse le décalage entre les blessés et la société civile. Les journaux glorifient les combats, si bien que les poilus, pour ne pas passer pour des faibles, enjolivent leur propre souffrance. Une forme de compétition dans la douleur s’installe, révélant l’absurdité d’une société qui transforme la guerre en fierté.
Le personnage de Sulphart incarne parfaitement ce désenchantement : réformé après de longues blessures, il découvre à son retour que sa femme est partie, que le monde a continué sans lui, que son uniforme n’a plus de valeur. L’armée lui a donné un cadre, la paix le lui retire. Livré à lui-même, il erre dans un pays qui a tourné la page. Et puis, avec le temps, tout s’efface : les souvenirs s’adoucissent, les douleurs s’estompent, et l’on finit par dire que “c’était le bon temps”, comme si la mémoire, pour survivre, devait trahir la vérité.
Le titre, Les Croix de bois, mérite d’être souligné. Ces croix, plantées à la hâte sur les tombes provisoires, symbolisent la mort anonyme, la disparition de l’individu dans la masse. C’est une image poignante de la guerre moderne, où chaque vie se fond dans la boue et l’oubli. Dorgelès en fait un motif récurrent, presque une obsession, qui donne au roman sa gravité silencieuse.
Enfin, contrairement à Barbusse ou Genevoix, Dorgelès n’écrit pas un simple témoignage mais bien un roman construit. Il invente des personnages, façonne des trajectoires, joue sur les émotions. Cette liberté romanesque lui permet de dresser une galerie de portraits attachants et cohérents, d’autant plus marquants qu’ils portent l’universalité du vécu collectif. C’est peut-être ce qui fait de Les Croix de bois l’un des livres les plus accessibles de la période, mais aussi l’un des plus équilibrés entre réalisme, émotion et fiction.
En somme, Les Croix de bois offre, dans un format plus court et plus direct que Le Feu, une vision humaine et complète de cette période. Moins militant, plus sensible, Dorgelès réussit à capter l’essence du quotidien des hommes de troupe. Le livre reste pour moi un bon témoignage, solide, émouvant parfois, mais sans atteindre la force ou la profondeur d’autres chefs-d’œuvre du genre.
Classement à date :
1. La Peur
2. À l’Ouest, rien de nouveau
3. Ceux de 14
4. Les Croix de bois
5. Orages d’acier
6. Le Feu