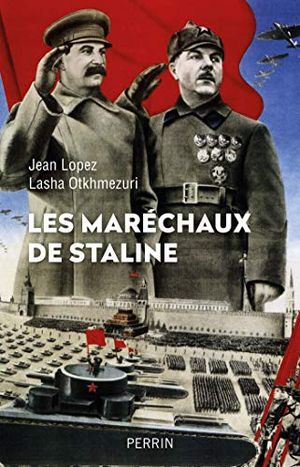Il était salutaire de mettre enfin des noms et une histoire sur ces visages graves et ces poitrines couvertes de médailles, anonymes pour les spectateurs occidentaux qui les percevaient simplement comme les Nazgûls rouges de Staline. On découvre avec intérêt comment les grandes purges ont brisé des hommes de fer, combattants émérites de la Première Guerre mondiale, de la révolution russe et de la guerre d'Hiver, jusqu’à les transformer en courtisans serviles. Pourtant, leur talent et leur force de caractère ressurgiront au moment décisif : l’invasion de l’URSS.
On distingue trois groupes principaux : les compagnons de la guerre civile, les vétérans de la guerre d’Hiver, et enfin les "maréchaux de la Victoire", avec le plus célèbre d’entre eux, Joukov.
Le livre s’ouvre avec Vorochilov, le commissaire politique, une des figures les moins sympathiques (non que ces hommes soient particulièrement aimables, habitués qu’ils sont à négliger la vie de leurs subordonnés et à espionner leurs collègues et supérieurs dans l’espoir de prouver leur fidélité). Il est le plus politique d’entre eux, et ses limites apparaîtront rapidement après la guerre civile. Malgré la piètre estime que Staline porte à ses compétences militaires, jusque dans la cérémonie de ses funérailles , c’est lui qui conservera la prééminence symbolique sur les autres, emblème du primat du Parti sur l’armée.
Boudienny, le "Murat rouge", figure romanesque, mi-serf mi-Cosaque, gardera une réputation pittoresque acquise pendant la guerre civile avec la 1ère armée de cavalerie, dite "Konarmia", (véritable ENA de l’Armée rouge, puisqu’y graviteront Staline, Vorochilov, Egorov, Tymochenko, Koulik et Meretskov), bien que son anachronisme face à la Wehrmacht ternira son image.
Egorov, ancien officier du tsar, passera l’essentiel de sa carrière à tenter de faire oublier son passé encombrant, mais son imprudence à revendiquer sa juste part de la victoire contre les Blancs le conduira devant le peloton d’exécution.
Bliouker, véritable proconsul de l’Extrême-Orient, mourra sous la torture en criant son nom et sa fidélité à son bourreau.
Toukhachevski, l’aristocrate révolutionnaire chéri de Lénine, penseur et théoricien de génie, verra sa mort sceller sa légende tout en inaugurant les grandes purges.
Timochenko, fils de paysans, est l’un des rares commandants à s’être illustré au plus haut niveau pendant les deux premières épreuves (la guerre civile et la guerre d’Hiver). Il sera finalement éclipsé par les succès initiaux des armées allemandes, puis par la carrière fulgurante de son subordonné, Joukov.
Chapochnikov, autre grand théoricien, colonel d’ancien régime élégant et distingué, tranche avec les autres maréchaux de Staline. Il réussira l’exploit de conserver la confiance de ce dernier tout en maintenant une intégrité personnelle dont la plupart de ses collègues semblent dépourvus. Génial chef d’état-major, davantage stratège que chef de terrain, il sera l’un des artisans du redressement après la guerre d’Hiver et au début de la Seconde Guerre mondiale (dont la maladie l’empêchera de voir la fin), épaulé par son brillant successeur Vassilevski, fils de pope devenu stalinien fanatique.
Koulik, le Vorochilov de terrain, paysan à l’apparence de brute prolétaire, s’imposera à la tête de l’artillerie soviétique. Rapidement discrédité pour ses carences militaires, il servira de bouc émissaire pour expliquer certaines défaillances de l’Armée, mais sera surtout exécuté pour son manque supposé de loyauté envers Staline, ayant osé critiquer ce dernier en privé.
Joukov, le plus célèbre, dont le nom sonne comme une trompette annonçant la victoire, est peut-être le plus proche de Staline par la personnalité, et pourtant le plus éloigné par les affinités. Koniev, son génial adjoint, restera dans son ombre après avoir perdu, à quelques heures près, la course à la libération de Berlin. Il sera agité comme contrepoids pour limiter l’influence de Joukov.
Govorov, l’exception : le seul, parmi les nombreux anciens officiers du tsar à avoir servi dans les armées Blanches. Il jouera un rôle majeur dans la défense de Leningrad.
Rokossovski, le plus stalinien de tous, dont les origines le prédestinaient à être un des bourreaux de la Pologne.
Malinovski, qui gagnera dans le sang le titre de "libérateur de Budapest", finira par anéantir l’armée japonaise en Mandchourie.
Tolboukhine, le plus discret, s’illustrera dans la libération de l’Ukraine puis des Balkans, et arrêtera la dernière grande offensive d’Hitler (Frühlingserwachen) avant d’entrer dans Vienne.
Meretskov, battu et humilié pendant les grandes purges pour avoir appartenu à une "filière espagnole" fictive, en ressortira traumatisé, solitaire et dépressif, mais miraculeusement libéré pour reprendre un commandement au bord du lac Ladoga.
Enfin, Sokolovski, qui aura peu de temps pour s’illustrer sous Staline, mais s’imposera comme théoricien après la Seconde Guerre mondiale.
Une étonnante galerie de portraits, marquée par le contraste saisissant entre la volonté, le talent et l’opportunisme dont ils ont su faire preuve (au moins à certains moments), et la soumission mêlée de crainte qui semble avoir été le fil conducteur de toute leur carrière — la plupart ayant profité des vides créés par les grandes purges tout en tremblant de ne pas y survivre.