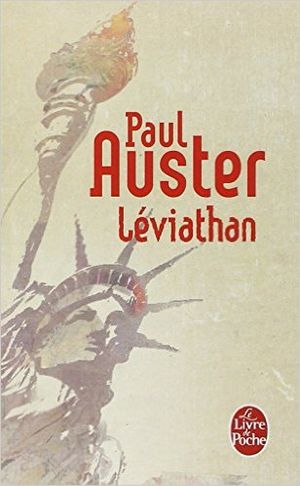Je ressors de cette lecture un peu plombée, disons-le franchement. Léviathan, c’est ce genre de roman qui commence comme un épisode de Sex and the City, version Brooklyn 90s : coucheries en cascade, artistes torturés, écrivains en panne d’inspiration, verres de vin rouge à la main. Alors oui, Auster écrit bien. Très bien, même. Il a un style, un sens du rythme, un jeu narratif fluide et maîtrisé. On ne peut pas lui enlever ça. Mais à force de glisser sur cette belle surface, on finit par se demander : et au fond, il y a quoi ?
L’impression persistante d’un roman hanté par une mélancolie ashkénaze, une errance identitaire sans résolution. Ça sent le Woody Allen asséché, les névroses citadines en roue libre, ce « juif errant » new-yorkais qui passe de femme en femme comme d’une idée à une autre, sans jamais s’y ancrer. Et si c’était ça, la thèse du livre ? Peut-être. Mais alors pourquoi ce sentiment de vide ?
Plus on avance, plus on s’enfonce dans une sorte de morosité existentielle où tout devient fuyant, lâche, presque inconsistant. Et malgré le talent évident de l’auteur, je n’ai jamais ressenti la profondeur psychologique à laquelle je m’attendais. Tout semble s’éparpiller. Ce n’est pas hermétique, non — c’est confus. Et derrière l’élégance du verbe, il manque un corps, une densité, un souffle.
Je ne dis pas que ce n’est pas intelligent. Je dis que ce n’est pas habité. Pour moi, on est loin du souffle de Jack London ou de l’opacité fiévreuse d’un Faulkner. Ici, tout est cérébral, désincarné, comme si l’émotion avait été dissoute dans l’ironie ou dans un désespoir trop poli pour être vrai.
Bref : j’en ressors vidée, plus triste qu’éclairée. Et un peu agacée, aussi, devant tant de virtuosité mise au service du flou.